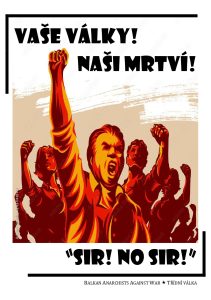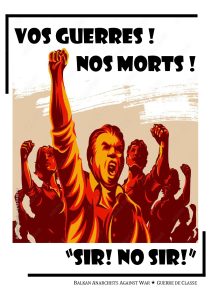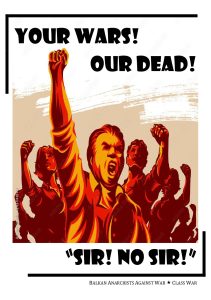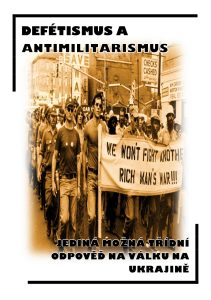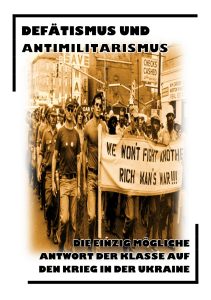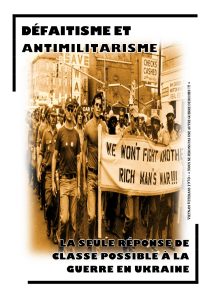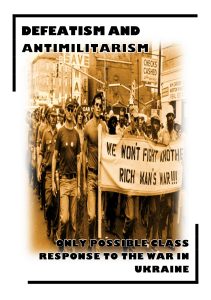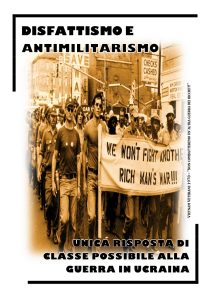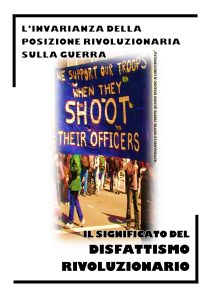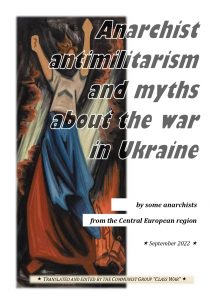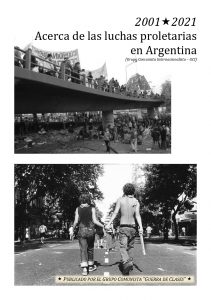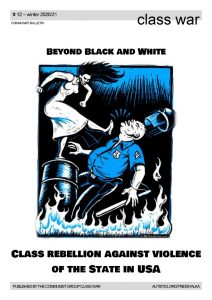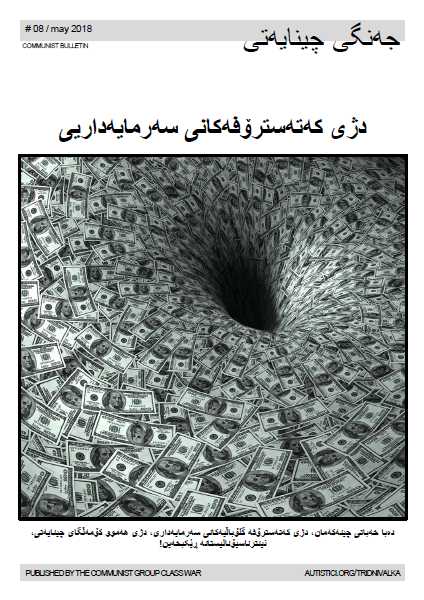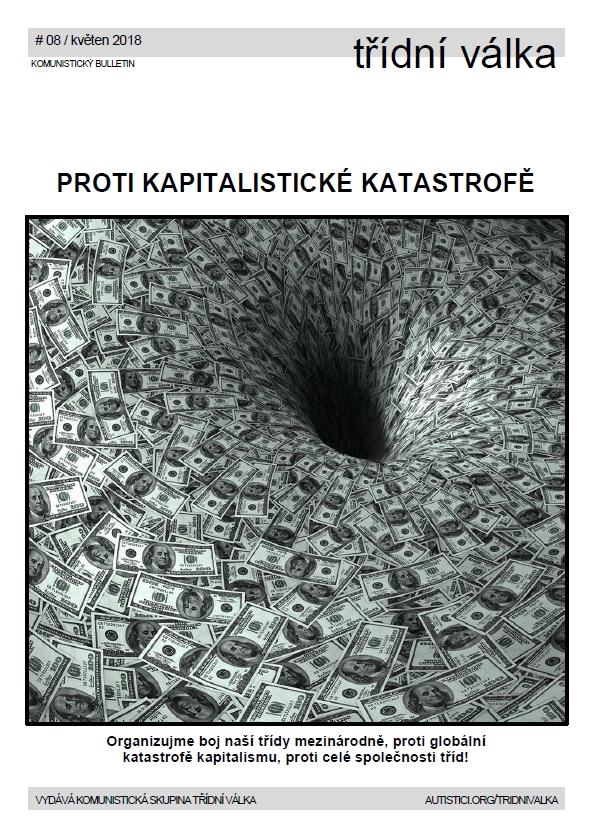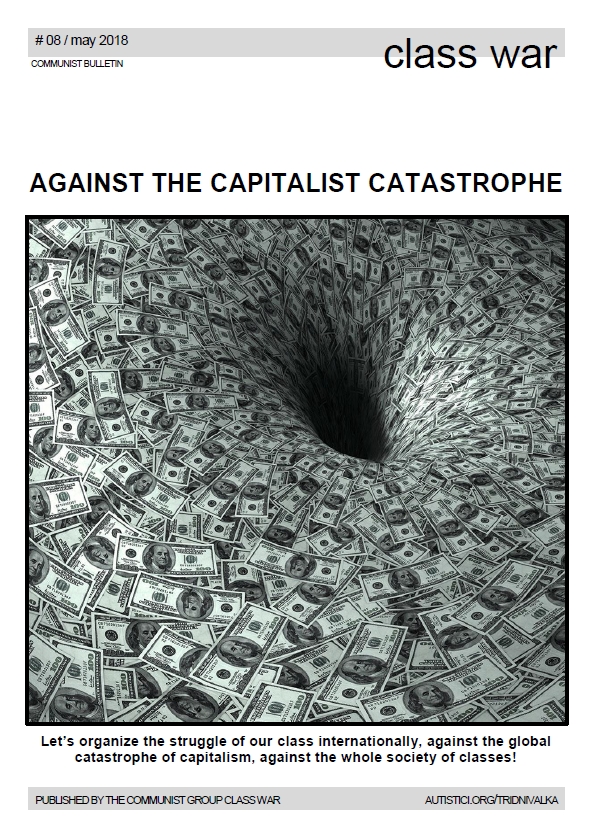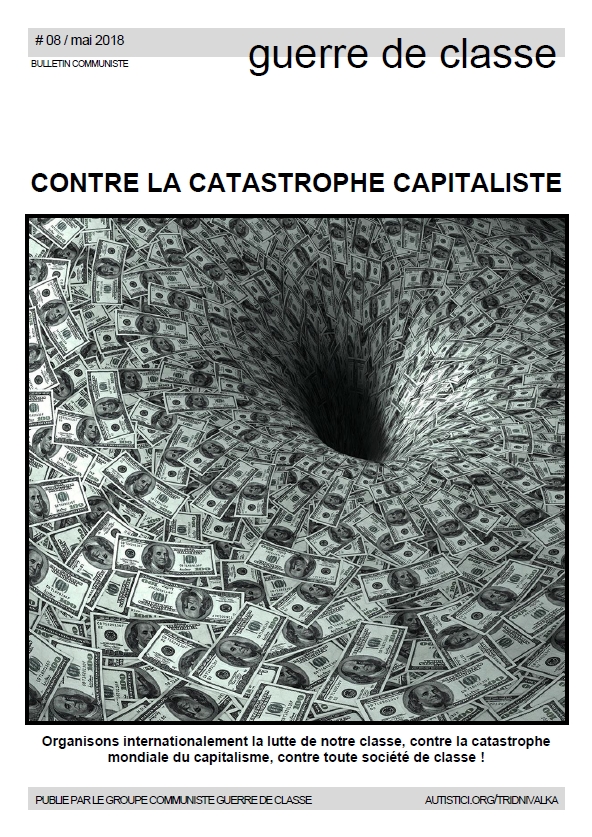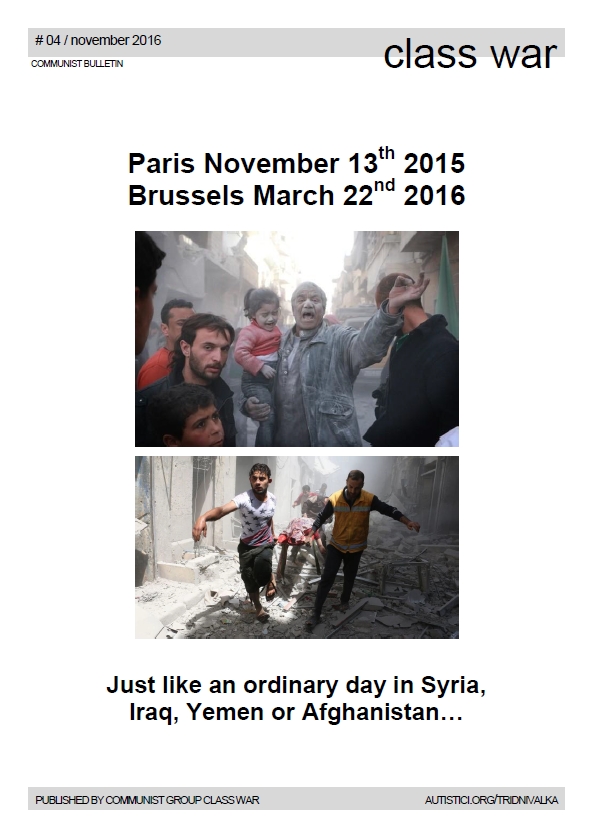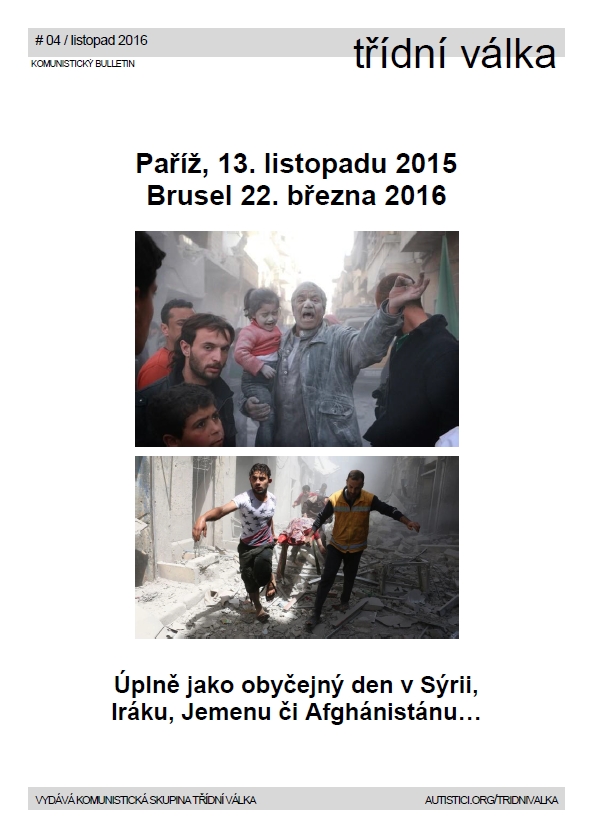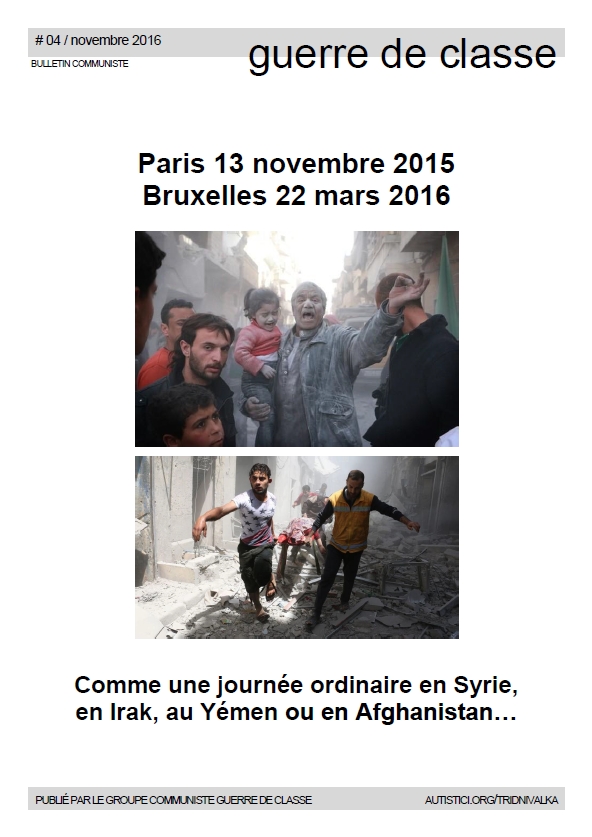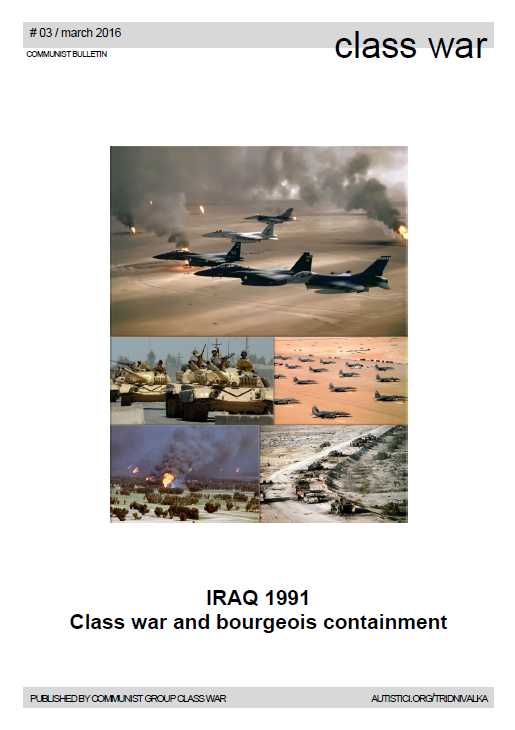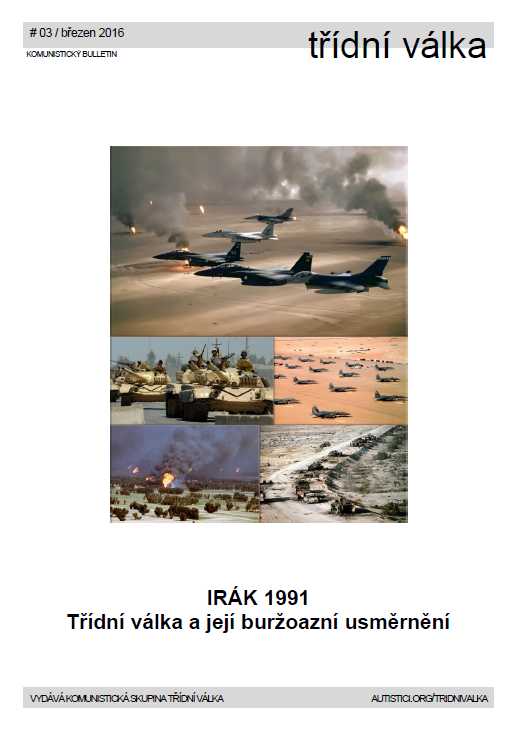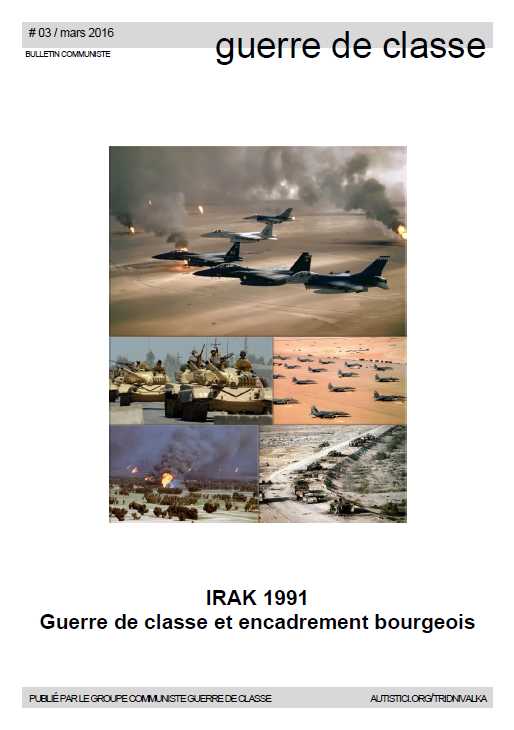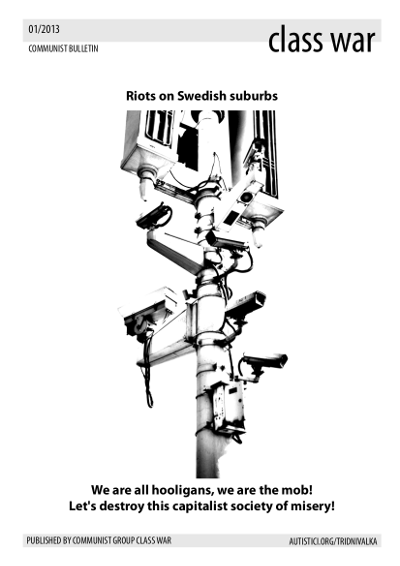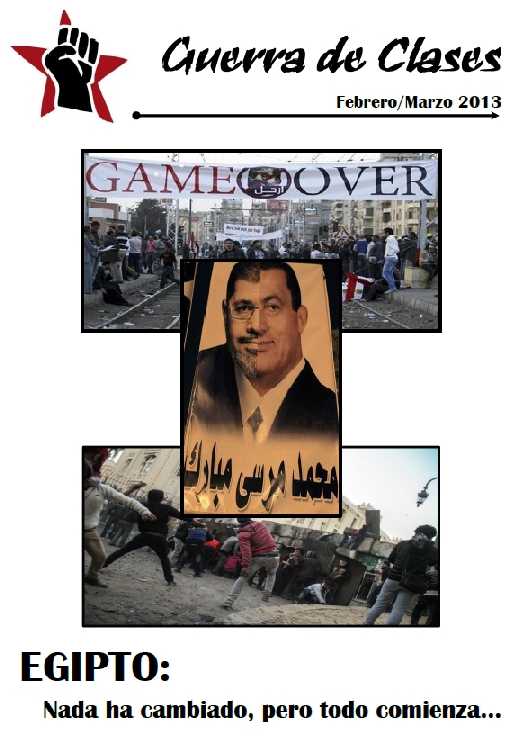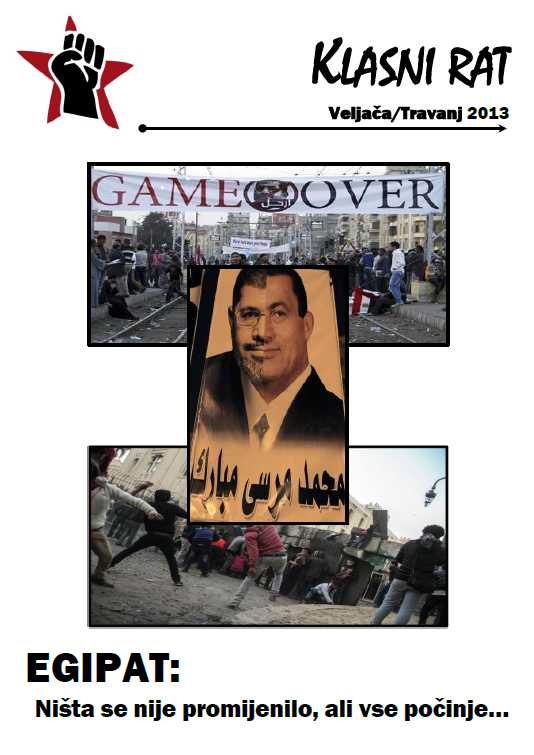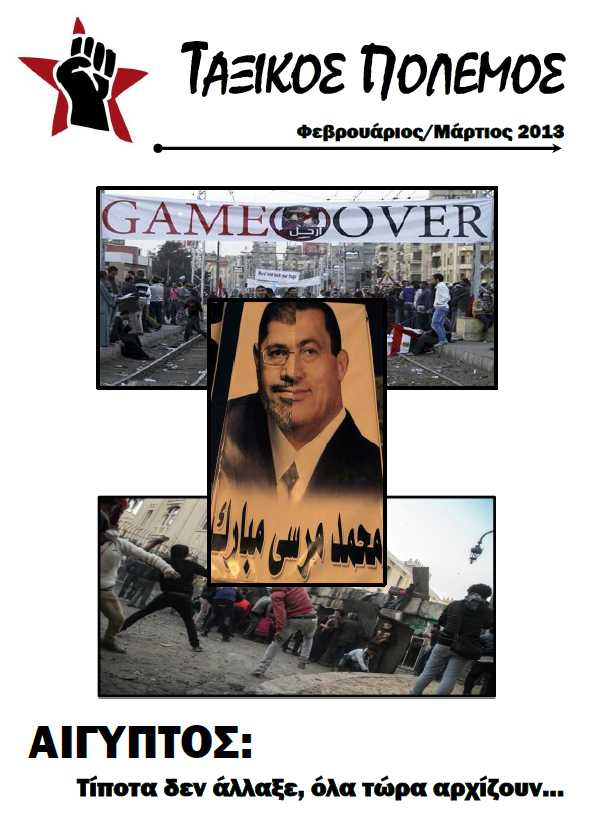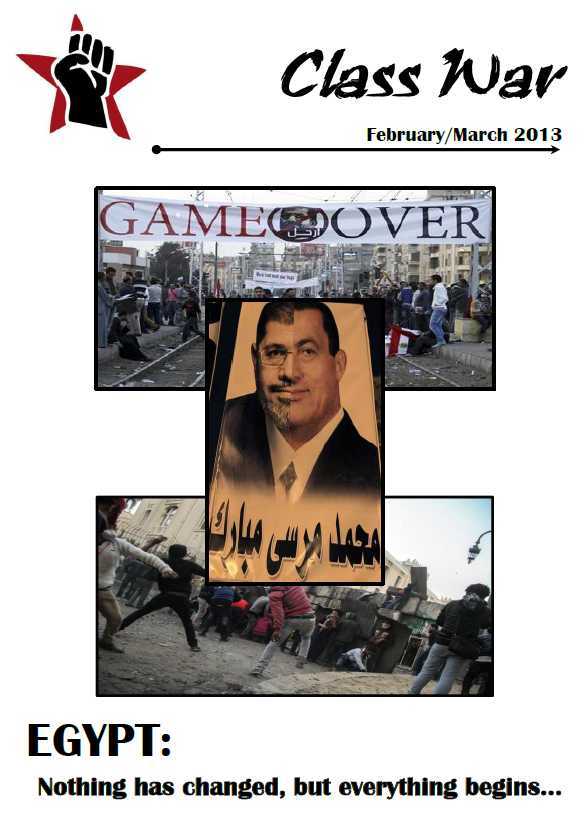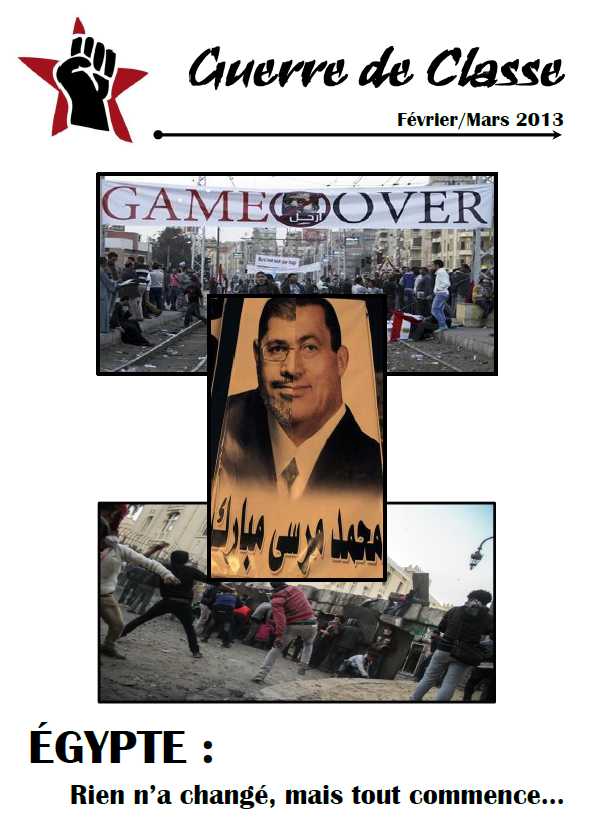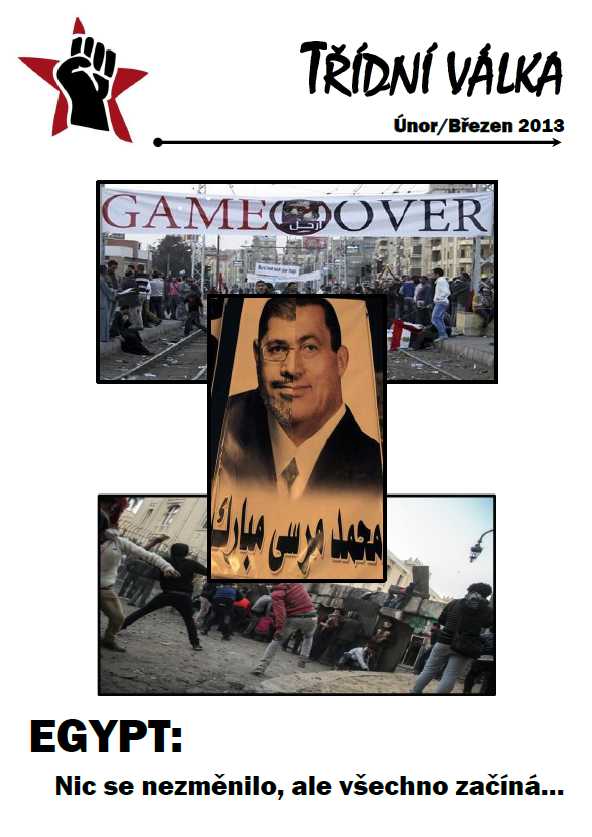ǀ Español ǀ Français ǀ English ǀ Deutsch ǀ

Source en espagnol : http://barbaria.net/2021/09/27/pandemia-y-control-social/
Traduction française : Los Amigos de la Guerra de Clases
Le capitalisme est constitué de disjonctions impossibles. Il divise ce qui, dans d’autres sociétés, était perçu comme un tout organique et il crée un antagonisme entre les deux pôles, nous obligeant à choisir l’un et à renoncer à l’autre dans une mesure plus ou moins grande. La pandémie a eu cet effet sur la santé et l’économie. Ainsi, le prolétariat s’est retrouvé face à un choix aberrant : mourir du covid ou mourir de faim. Au niveau individuel, puisque sous le capitalisme il est plus sûr de mourir de faim si vous n’avez aucun revenu que de mourir du covid, en réalité il s’agit d’un faux choix. Ce n’est rien d’autre que du chantage. Au niveau social, la situation est plus complexe et elle explique le comportement des États depuis le début de la pandémie.
Mais derrière ce dilemme entre santé et économie s’en cache un autre qui est au cœur des débats de la critique sociale depuis le début : liberté ou santé, une imitation de la vieille dichotomie entre liberté et sécurité, elle-même expression de l’opposition originelle dans le capitalisme entre l’individu et l’État. Ainsi, dans les médias radicaux, la préoccupation pour un État qui semble avoir été renforcé par la pandémie au détriment de nos libertés individuelles exerce une forte pression. Les discours sont variés. L’existence du virus est admise ou non, on lui accorde plus ou moins de gravité le cas échéant, on donne plus ou moins de poids à la surveillance numérique ou aux médias. Mais dans tous les cas, tous ces discours partagent une base commune : le covid est un écran de fumée qui nous empêche de voir le vrai problème, l’augmentation du contrôle social. L’État revêt un masque et profite de l’occasion pour attiser la peur au sein de la population afin de stimuler la servitude volontaire. La « stratégie du choc », comme on disait autrefois. Ce qui est remarquable dans la pandémie, ce n’est pas la question sanitaire, le nombre de morts, le fait de sacrifier la santé et la vie au cannibalisme du capital, mais bien le développement des mécanismes de contrôle et de répression par le big data, la digitalisation du quotidien, le renforcement de la société du spectacle, la montée du pouvoir médical, l’émergence du biopouvoir. Ce processus peut simplement nous conduire à un capitalisme plus fort et plus totalitaire, ou bien il pourrait même s’agir de la transition vers une nouvelle société de classe caractérisée non pas par la production de valeur, mais par l’affirmation absolue d’un État orwellien par la domination technologique et les connaissances spécialisées.
Du capitalisme à la biocratie ?
C’est peut-être le courant anti-développementaliste qui a le mieux exprimé ce dernier aspect. De son point de vue, la pandémie a été exploitée – si ce n’est provoquée – par l’État pour accroître le pouvoir médical et technologique sur la population et, en ce sens, ce serait là une confirmation de sa thèse selon laquelle nous nous dirigeons vers un type de société, ou que nous y sommes déjà passés, où la question fondamentale n’est pas l’exploitation d’une classe sociale par une autre, mais la domination d’une caste de technocrates organisés autour de l’État sur l’ensemble de la population. En actualisant un peu les termes à la lumière des événements, on peut affirmer que cet État est une dictature sanitaire dirigée par des biocrates – les technocrates du pouvoir médical – qui, grâce à la médicalisation de la vie et à la surveillance numérique, ont réalisé une percée dans la domination d’une population engourdie par la peur de tomber malade et de mourir.
Les termes sont importants, ils façonnent notre pensée et les catégories que nous utilisons. Il existe une différence radicale entre exploitation et domination, car la première a une base matérielle enracinée dans la manière dont les sociétés produisent et reproduisent la vie. La domination, en revanche, ne fait que nous parler d’une relation de pouvoir sans expliquer d’où elle vient. Et ce n’est pas anodin, car ce qui n’a pas de cause précise n’a pas non plus de solution possible. C’est là que réside la force réactionnaire de la postmodernité, qui nous représente un monde organisé par un réseau de dispositifs de pouvoir sans cause ni but précis, une multiplicité d’oppressions dont il est impossible de se libérer. Dans cette perspective, il n’est plus possible de penser à la révolution, ni même à la résistance.
On comprendra alors pourquoi la différence entre l’État qui nous domine et l’État qui gère notre exploitation est importante. L’État n’est pas une institution autonome, avec sa propre finalité et son propre fonctionnement, séparée des rapports sociaux qui organisent la production et la reproduction de la vie. Il est au contraire un organe de ces rapports sociaux lorsqu’ils sont fracturés par l’antagonisme de classe, et à ce titre, il veille à ce que la société reste soudée dans la séparation. Dans le cas des rapports sociaux capitalistes, où la production de valeur suit une logique impersonnelle et automatique, l’État remplit la fonction de sauvegarde des intérêts du capital, au besoin contre les capitalistes individuels eux-mêmes.
Le discours anti-développementaliste va encore plus loin. Il prend ces rapports sociaux, qui produisent un certain type de technologie et de connaissance, et il inverse la pyramide. Ce sont la technologie et les connaissances spécialisées qui produisent un type particulier de rapports sociaux et l’État n’est qu’un instrument pour les imposer. La technologie est fétichisée. La technologie, le savoir, et plus récemment le savoir médical, deviennent un pouvoir autonome capable de générer des relations sociales aliénées. Ce type d’approche pose de nombreux problèmes, mais pour notre propos, nous n’en soulignerons qu’un seul : les relations sociales peuvent être modifiées, on peut combattre positivement une organisation sociale pour en établir une autre, mais la connaissance et la technologie ne peuvent pas être combattues. Quoi qu’il en soit, tirons un trait là-dessus car tant que le capitalisme existera, la technologie et les connaissances continueront à se développer, stimulées par la concurrence entre les entreprises. Il s’agit donc d’un combat perdu d’avance, car il ne s’attaque pas aux causes profondes mais les contourne. Ce faisant, la révolution cesse d’être une possibilité matérielle et l’émancipation, si tant est qu’elle le soit, devient un fait éclairant. Seuls les plus conscients, ceux qui ont reçu la parole, peuvent tenter de s’échapper.
En réalité, ils n’en seront pas non plus capables. Il n’y a pas de moyen de sortir de la technocratie, mais il y a un moyen de sortir du capitalisme.
Débat autour du biopouvoir
Dans le capitalisme, l’État est le gestionnaire des rapports sociaux d’exploitation qui sont par ailleurs en proie à une crise historique profonde. Pour comprendre le comportement de l’État pendant la pandémie, il faut expliquer la contradiction à laquelle il est confronté.
Bien qu’il y ait eu d’autres pandémies dans l’histoire, c’est la première fois qu’un virus inconnu se propage dans une société dont la population est si nombreuse, si mondialisée, interdépendante, en interaction constante avec le monde entier. Pour nous donner une idée, à l’époque de la grippe espagnole, on estime qu’il y avait 1,8 milliard de personnes dans le monde et les principaux moyens de transport étaient les bateaux à vapeur. Nous sommes aujourd’hui près de 7,8 milliards et le nombre de voyages aériens s’est multiplié en quelques années : la puissance de propagation de nouveaux virus – avec leurs nouvelles souches – croît en même temps que se développe le capitalisme. Nous pouvons donc comprendre que dans une société aussi globalement interconnectée et avec une population aussi vulnérable, un virus d’une telle contagiosité représente un réel danger, non seulement en raison de la létalité plus ou moins grande du virus lui-même, mais aussi en raison de la menace d’effondrement des systèmes sanitaires ainsi que des morgues, et des dommages collatéraux qui en découlent. Il n’est donc pas surprenant que, si les décès dus au covid s’élèvent officiellement à 4 millions dans le monde, on estime qu’il y aurait rien qu’en Inde une surmortalité entre 3,4 et 4,9 millions de juin 2020 à juin 2021.
Par conséquent, l’État se trouve dans une situation délicate. Il est tout aussi nécessaire de produire et de faire circuler des marchandises que d’avoir des travailleurs vivants pour le faire. Loin d’être dans un processus de transition vers une nouvelle société totalitaire, les États font ce qu’ils ont toujours fait sous le capitalisme, mais avec les difficultés croissantes que leur impose le développement de ce mode de production : ils doivent rester les garants de la préservation de la force de travail en vue de son exploitation, dans un contexte où la population croît de manière exponentielle, où l’interconnexion des transports à l’échelle mondiale est de plus en plus exacerbée, où la crise permanente du capital pousse à une augmentation de la misère sociale et à une dévastation croissante de la nature, et où ces facteurs affaiblissent à leur tour notre système immunitaire et provoquent l’apparition de nouvelles pandémies. La fonction de l’État, qui est de maintenir la cohésion d’une société déchirée par les antagonismes de classe et, sous le capitalisme, par la guerre de tous contre tous causée par la concurrence entre les capitaux, connaît des difficultés grandissantes, car il est confronté au dilemme de maintenir une économie qui propage la maladie ou de maintenir les travailleurs qui soutiennent l’économie.
D’autre part, derrière ce constat se cache la question que la santé est un fait social, bien avant d’être un fait individuel. Bien sûr, nous ne parlons pas seulement des maladies contagieuses, mais du fait que notre santé est le résultat de la manière dont nous nous organisons socialement : s’il y a ou non une séparation entre ville et campagne, si les villes sont petites ou monstrueuses, s’il y a ou non du travail salarié, les conditions plus ou moins saines dans lesquelles ce travail est effectué, le type de logement que nous avons, le type d’agriculture que nous pratiquons, la manière dont l’activité sociale affecte notre habitat naturel et les multiples façons dont cet habitat nous rend la pareille. Bien avant d’en arriver à la gestion individuelle de notre propre corps, la santé est un fait social.
De plus, le développement du capitalisme et l’énorme force de socialisation qu’il a déployé à l’échelle mondiale implique que la santé devient de plus en plus un fait d’espèce. Contrairement à d’autres pandémies, notre santé est de plus en plus interconnectée au niveau mondial ; on pourrait dire que nous devenons de plus en plus un seul corps au niveau mondial. C’est toutefois un problème sérieux sous le capitalisme, car il tend à nous uniformiser au niveau international alors qu’en même temps il ne peut nous gérer qu’à travers les États-nations. Comme pour le changement climatique, la pandémie de covid est une démonstration de l’impuissance du capitalisme à résoudre les problèmes historiques qu’il crée. Et la médiocrité des gouvernements face à la pandémie n’est qu’une expression de cette impuissance.
Notre santé est un fait social, mais dans ce système d’agrégation d’individus isolés en concurrence permanente, la liberté est pensée de manière isolée et le social est identifié à l’État. L’organisation spontanée fondée sur le libre arbitre et l’entraide n’est pas possible dans une société régie par la marchandise : tant que les rapports sociaux capitalistes existeront, l’État continuera d’exister pour réguler les intérêts égoïstes des individus et s’imposer face à ceux-ci. Bien sûr, ce ne sont pas les besoins des êtres humains en tant que collectivité qui s’opposent à l’égoïsme individuel, mais les besoins de valorisation de la valeur, d’accumulation du capital. La gestion de la santé n’en est qu’une conséquence.
Le fait que nous ne soyons qu’une force de travail pour l’État et le capital est une évidence. C’est pourquoi ce n’est pas notre vie qui compte, et encore moins notre santé, mais de maintenir – en termes statistiques – un minimum des deux, afin de continuer à alimenter la machine automatique du capital. Il va sans dire que nos corps sont soumis au contrôle de l’administration pour atteindre cet objectif. Cela n’a rien de nouveau ni d’extraordinaire. A un tel point que le corps des femmes fait l’objet depuis bien longtemps d’un contrôle par les sociétés de classe, afin de garantir la reproduction de la force de travail et la transmission correcte de la propriété privée, sans que cela n’ébranle les idées des grands génies philosophiques. La théorie du biopouvoir, si en vogue ces derniers temps pour défendre l’idée d’un État de plus en plus totalitaire et puissant, n’est rien d’autre qu’un constat banal de ce fait. En cas de pandémie présentant les caractéristiques décrites et menaçant fortement le bon fonctionnement de la machine du capital, la nécessité pour l’État de contrôler nos corps est renforcé par un élément qui est exact – la santé est un fait social – et un autre qui est faux : qu’il défendrait ainsi la société et les besoins sociaux. Mais si l’on s’en tient à cette affirmation, il n’y a cependant ni explication ni issue possible. La solution ne peut résider ni dans la gestion sanitaire de l’État, qui sera toujours la subordination de notre santé au cannibalisme du capital, ni dans la défense de l’individu en tant qu’atome libre, indépendant et étranger au corps social.
Le capitalisme s’affaiblit, et l’État avec lui
Ceux qui ne parlent pas directement de la transition vers une nouvelle société de classe affirment que le capitalisme se renforce, qu’il gagne de plus en plus en force de conviction et qu’il écrase ceux qui ne veulent pas se laisser convaincre. De ce point de vue, la bourgeoisie devient de plus en plus puissante. Si elle ne l’a pas planifiée, du moins elle n’a pas raté l’occasion de la pandémie pour renforcer la surveillance technologique et soumettre davantage les citoyens par une stratégie de la peur.
Mais le terme de stratégie semble excessif. Il n’est certainement applicable en tant que stratégie mondiale où la classe dirigeante suit un plan défini et convenu, étant donné que la gestion de chaque gouvernement a été un chacun pour soi tout au long de la pandémie, d’abord avec les masques, les EPI [Équipements de Protection Individuelle, NdT] et les respirateurs artificiels, puis avec les vaccins. Et au niveau national, il n’y a pas non plus de plan défini ni de collusion, car le trait le plus caractéristique de cette gestion a été le zigzag, les recommandations contradictoires, les tâtonnements à l’aveugle, les réouvertures et l’assouplissement de mesures dont on savait, avec certitude, qu’elles n’étaient que temporaires. Bien sûr, cela n’a pas grand-chose à voir avec les grands plans nationaux que la bourgeoisie a élaborés il y a quelques décennies et qui ont donné une stabilité à la gestion gouvernementale malgré les changements de couleur politique. Mais cela n’a pas non plus grand-chose à voir avec les années précédentes. Avec cette crise, l’incertitude et la désorientation de la classe dirigeante atteignent un paroxysme : les données de la croissance économique sont évaluées et oscillent tous les mois, les politiques monétaires et de contrôle de l’inflation sont régies par un « faisons-le maintenant et nous verrons bien », les ERTE [Expediente de Regulación Temporal de Empleo – Plan d’Ajustement Temporaire de l’Emploi, NdT] sont négociés et renégociés pour les conserver encore quelques mois, les mesures de réduction des factures d’électricité et de gaz sont appliquées chaque trimestre, en espérant que – si Dieu le veut – le trimestre suivant sera meilleur. Au sein de l’UE, sa propre politique à l’égard de la campagne de vaccination a été une succession de contradictions et de tergiversations.
Et c’est normal. La bourgeoisie est désorientée, parce que ses propres rapports sociaux deviennent incontrôlables. Elle doit limiter le chômage, mais elle ne peut empêcher les licenciements par l’automatisation de l’économie. Elle doit limiter le changement climatique et le gaspillage des ressources énergétiques et naturelles, mais un simple ralentissement de la croissance du PIB est synonyme de graves crises économiques. Elle a besoin que les marchandises circulent, que la population continue à les consommer rapidement, que les capitaux continuent à circuler librement sur la planète, mais sa propre débâcle provoque des pandémies qui l’obligent à entraver ce mouvement, à fermer les frontières, à battre en retraite.
Si l’État semble prendre de l’ampleur, ce n’est pas parce qu’il devient plus grand et plus fort, mais parce qu’il enfle du fait du pourrissement pur et simple de sa fonction historique. D’une part, son poids dans l’économie s’accroît parce que les entreprises ont besoin de lui comme organe de respiration artificielle, dans la mesure où leurs profits ont tendance à diminuer avec l’avancée du capitalisme. Sans ses emplois, sa consommation, ses politiques d’injection monétaire ou son crédit public, l’économie ne pourrait pas résister. Nous assistons ainsi à un processus désireux de gommer la séparation originelle du capitalisme entre économie et politique, entre État et marché, car si l’État est un organe de respiration artificielle pour le capital, celui-ci exerce un contrôle toujours plus grand sur lui. La capacité de l’État fordiste à imposer ses choix politiques, sa planification économique, ses politiques monétaires ou même sa fiscalité est désormais loin derrière lui. Car l’épuisement de la valeur conduit également à l’épuisement de l’État en tant qu’organe de régulation des rapports capitalistes. La facilité avec laquelle le capital se délocalise et échappe à son contrôle territorial, l’augmentation persistante de la dette publique qui le place entre les mains des marchés financiers internationaux, l’importance croissante des structures supranationales, tout cela remet en question le principe traditionnel de tout État : la souveraineté sur son territoire, la capacité à imposer ses choix politiques. D’autre part, la concentration du capital dans des régions spécifiques entraîne une disparité territoriale à l’intérieur de ses frontières, ce qui constitue la base matérielle pour le déclenchement de mouvements régionaux ou nationalistes de nature centrifuge. Enfin, la perte des bases matérielles du réformisme, en raison de la diminution de la production de plus-value, signifie également que l’État lui-même dispose de moins en moins de ressources pour l’intégration sociale à travers les aides, les services publics, l’assistance sociale : ce n’est pas pour rien si la religion et l’identitarisme communautaire se substituent à lui dans ces fonctions, sans que cela permette d’unifier les fractures sociales, mais au contraire en les approfondissant dans un sens réactionnaire.
Ce n’est que dans ce chaos que l’on peut comprendre l’augmentation de la surveillance numérique et la modernisation des mécanismes répressifs. Oui, le capitalisme a recours et aura de plus en plus recours à la répression, mais cela ne signifie pas que le contrôle social s’accroît. Au contraire, s’il doit recourir à l’usage de la force, c’est parce que la machine du consensus commence à s’enrayer.
Le développement technologique est à la fois l’outil et la condamnation de la classe dirigeante. Le développement technologique nous a donné une capacité de surveillance sans précédent dans l’histoire : drones, reconnaissance faciale, traçage grâce aux smartphones, analyse massive de la consommation de produits et de contenus sur internet, surveillance des réseaux sociaux grâce à l’intelligence artificielle et au big data. Mais aussi, sur la base de ce même développement technologique, on a besoin de moins en moins de force humaine à exploiter, les profits diminuent, le capital se concentre dans une économie de casino qui ne fait que générer des bulles toujours sur le point d’éclater, la population excédentaire, sans utilité sociale, est en augmentation, il faut de plus en plus de ressources énergétiques et de matières premières, et pour les obtenir la crise écologique s’aggrave, la terre devient stérile en raison de l’exploitation de l’agro-industrie, la rupture du cycle du phosphore et la désertification ainsi que les phénomènes climatiques deviennent de plus en plus extrêmes, l’eau potable devient un problème croissant, les guerres se multiplient, le déséquilibre des écosystèmes menace notre vie même sur la planète.
Et tout cela génère des explosions sociales, des révoltes qui jettent les bases de futures rébellions. Bien sûr, l’État s’arme, mais uniquement parce qu’il peut de moins en moins compter sur le consensus social. Ce n’est que dans une perspective de domination, dans laquelle le pouvoir s’impose sans explication ni résolution possible, que l’on peut croire que l’humanité peut assister à ce processus sans réagir. Ceux qui ne se laissent pas piéger par une telle perspective verront que les mouvements actuels sont confus, pleins de limites, mais qu’ils répondent à un système qui condamne notre espèce et qu’ils apprennent, qu’ils tirent les leçons des défaites passées, avec une mémoire souterraine qui rend chaque vague mondiale un peu supérieure à la précédente : des vagues face auxquelles l’État se retrouve de plus en plus armé et de plus en plus fragile.
Il est courant dans le capitalisme d’être placé le dos au mur et de devoir prendre parti pour un moindre mal. La santé ou l’économie. La liberté ou la sécurité. Les droits de la personne ou les besoins sociaux. L’individu ou l’État. Nous écrivons après un an et demi d’une pandémie traversée par ces dichotomies. Et le débat qu’elles ont suscité dans les rangs de la critique sociale n’est pas anodin, mais nous ne serons pas en mesure de le résoudre au sein de celles-ci. Il y a quelque chose de faux et de vrai dans la polarisation à laquelle nous assistons : vrai, parce que la santé et l’économie, la liberté et la sécurité dans le capitalisme vivent un antagonisme réel et irréconciliable. Celui qui opte pour l’un doit plus ou moins renoncer à l’autre. C’est pourquoi les tentatives de la gauche d’élaborer des propositions pour résoudre cet antagonisme ne sont pas seulement banales, mais aussi pleines d’auto-illusion – pour justifier sa propre fonction sociale – et de cynisme.
Mais il y a aussi quelque chose de faux dans cette polarisation, parce que nous ne trouverons jamais la réponse si nous la cherchons dans cette confrontation, et parce qu’argumenter à partir de là nous conduit à préférer une partie du capital plutôt qu’une autre. Ceux qui choisissent la santé et la sécurité se retrouvent à défendre l’État comme si c’était une institution neutre, bonne si elle est bien gérée, qui seule est capable de veiller à l’intérêt commun et de sauvegarder les besoins sociaux contre les aspirations égoïstes d’individus isolés. Ceux qui penchent pour la liberté et l’économie finissent par défendre le libre arbitre de l’individu, coûte que coûte, et considèrent comme naturelle l’aberration d’un système social régi par la marchandise et le travail salarié.
La seule possibilité pour ceux d’entre nous qui aspirent à une société émancipée, c’est de rompre avec cette approche du débat, si nous ne voulons pas en être prisonniers. Entre mourir du covid ou mourir de faim, nous choisissons de lutter contre un système qui nous impose ce dilemme. Entre la défense de l’État comme seul garant des besoins sociaux ou la défense de la liberté de l’individu, oublieux de son interdépendance avec les autres, nous choisissons de lutter contre le capital. Ni le travail salarié, ni un système qui nous rend malade. Ni l’État, ni l’individu : ces deux catégories sont nées avec les sociétés de classe, se développent avec le capitalisme et mourront avec lui, comme la dernière société de classe de l’histoire.