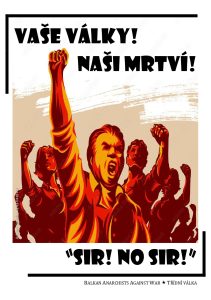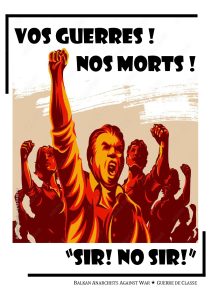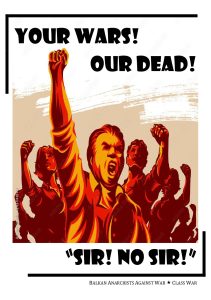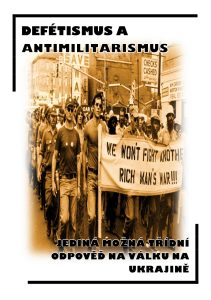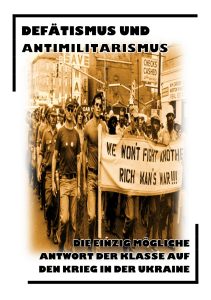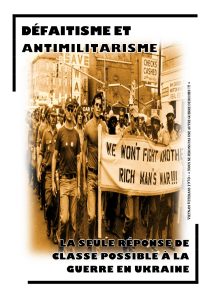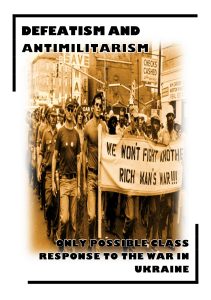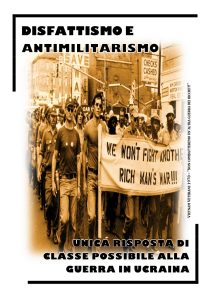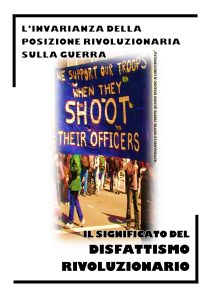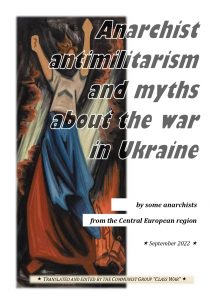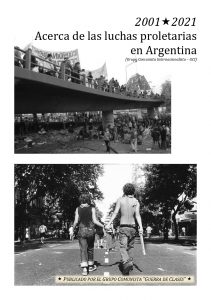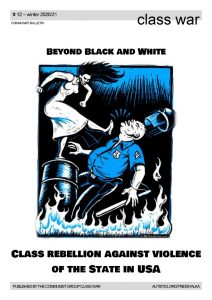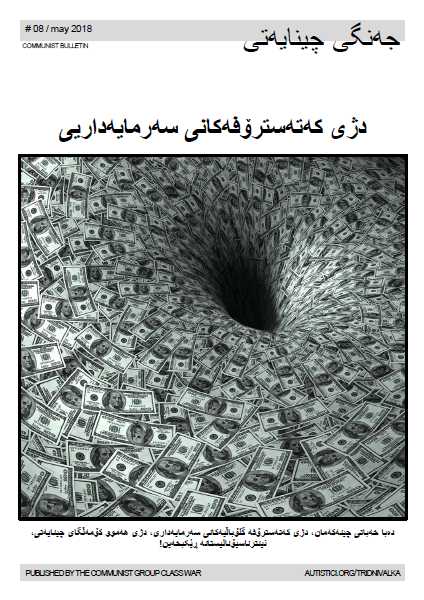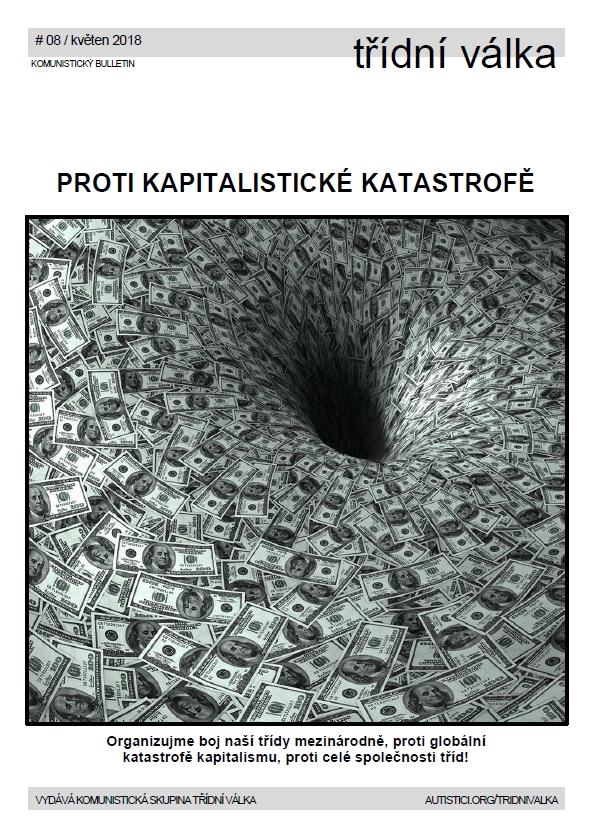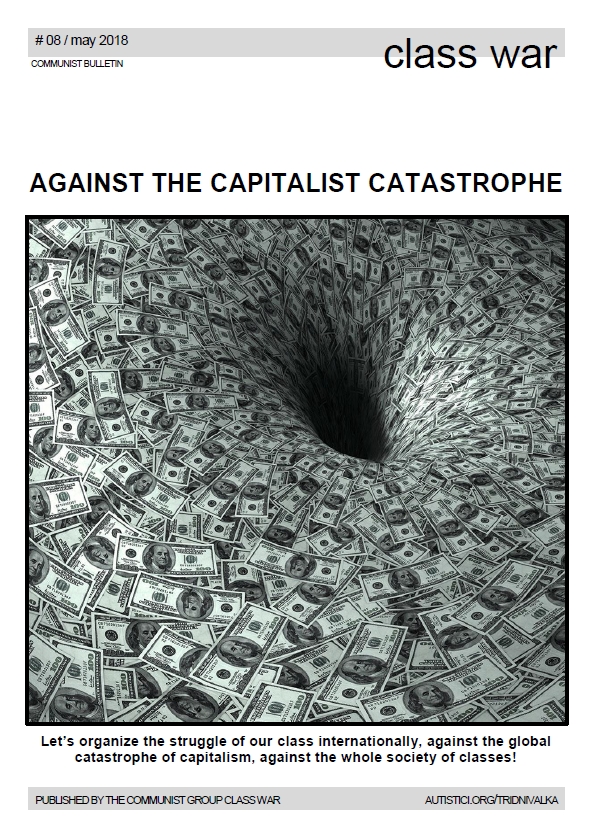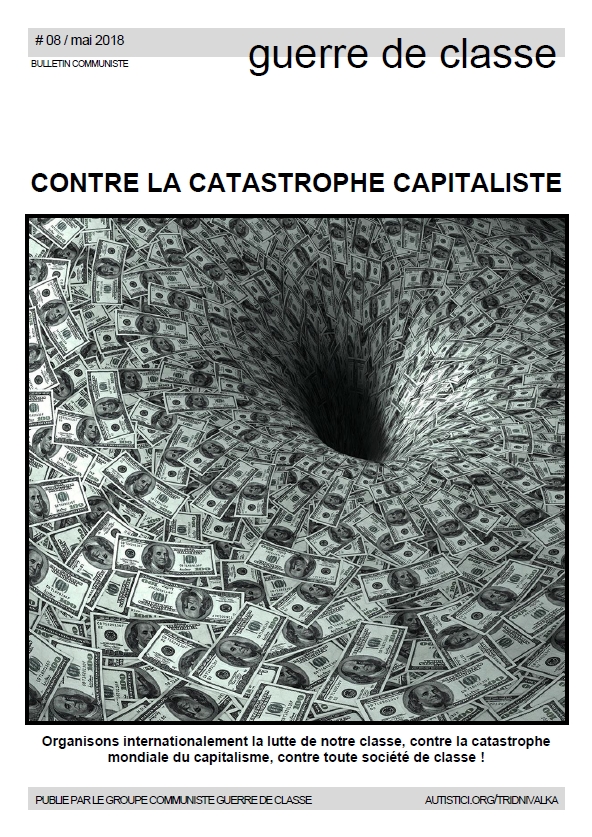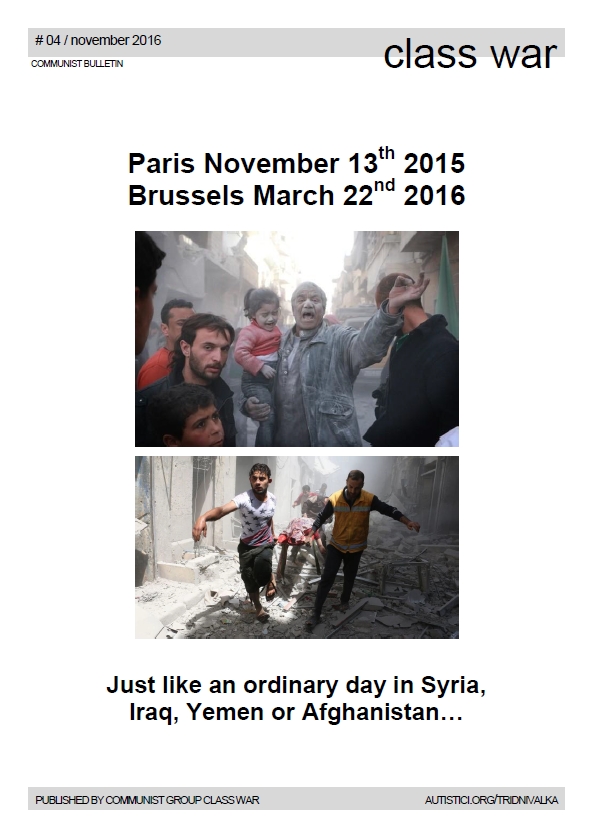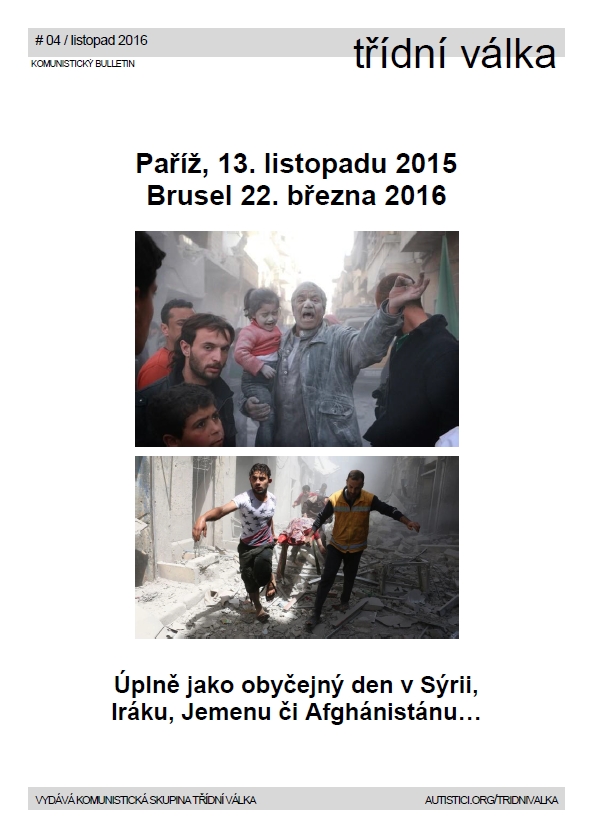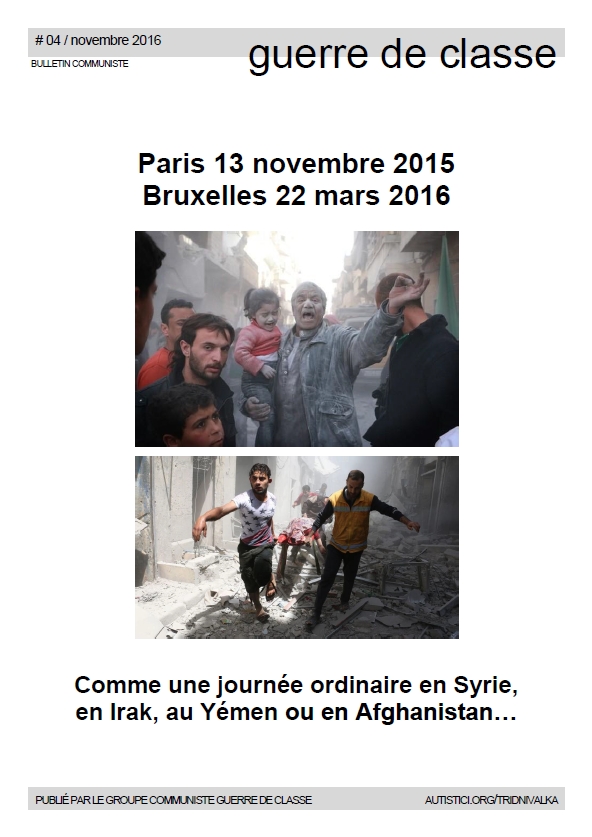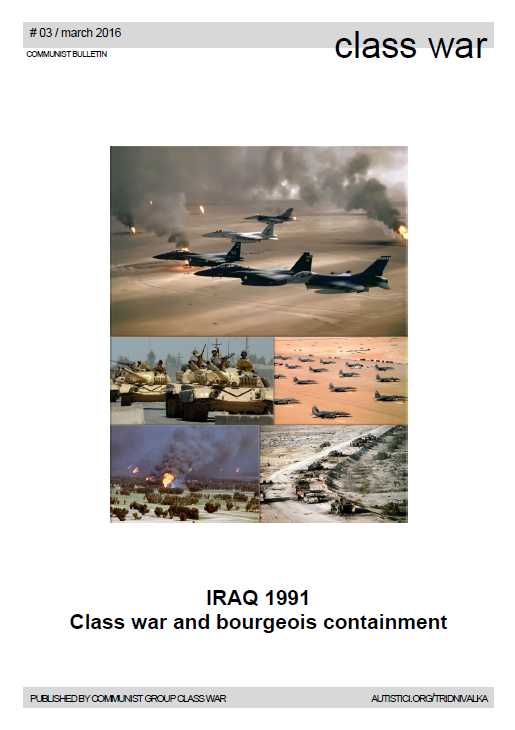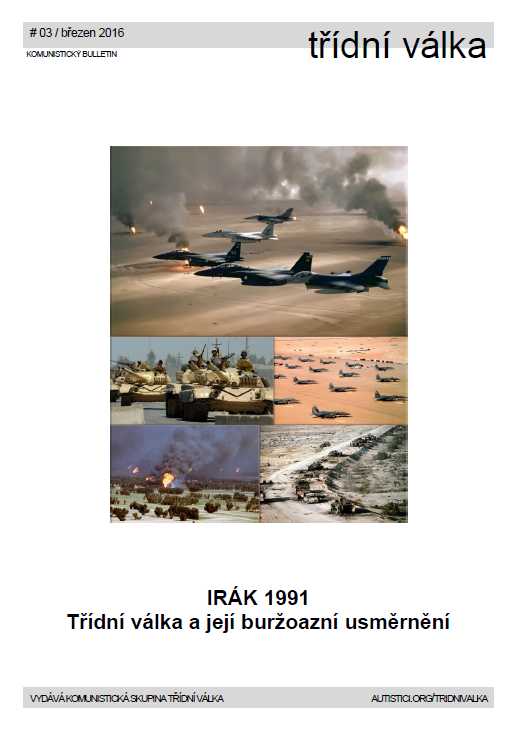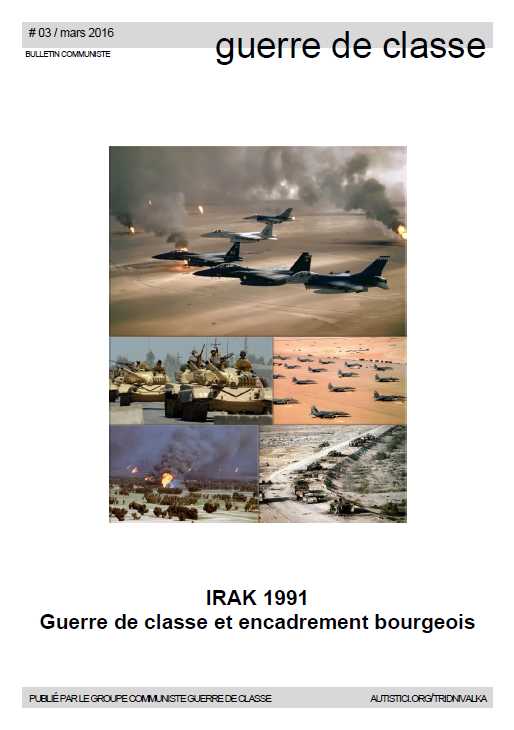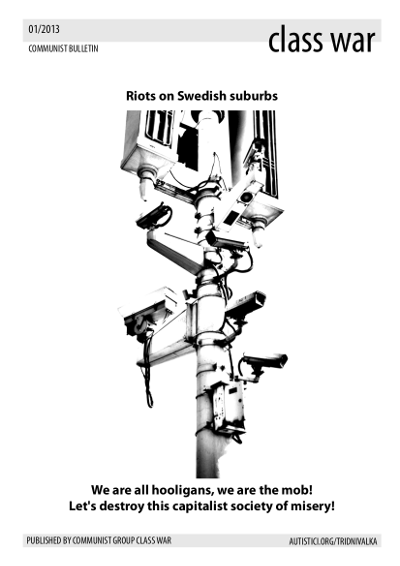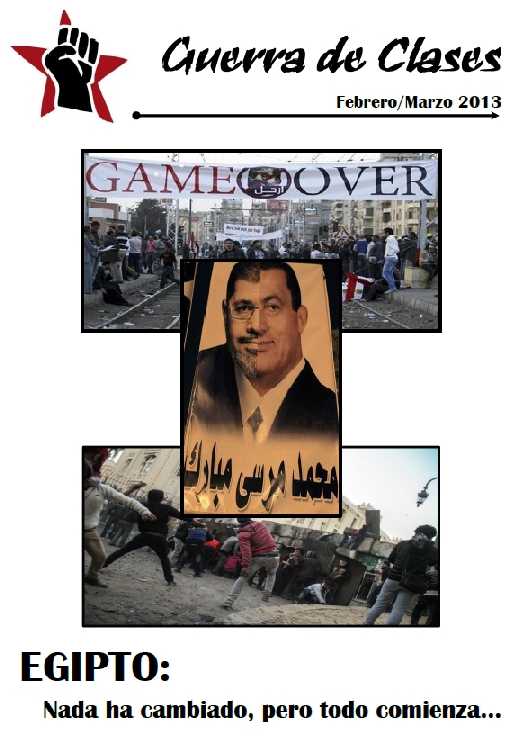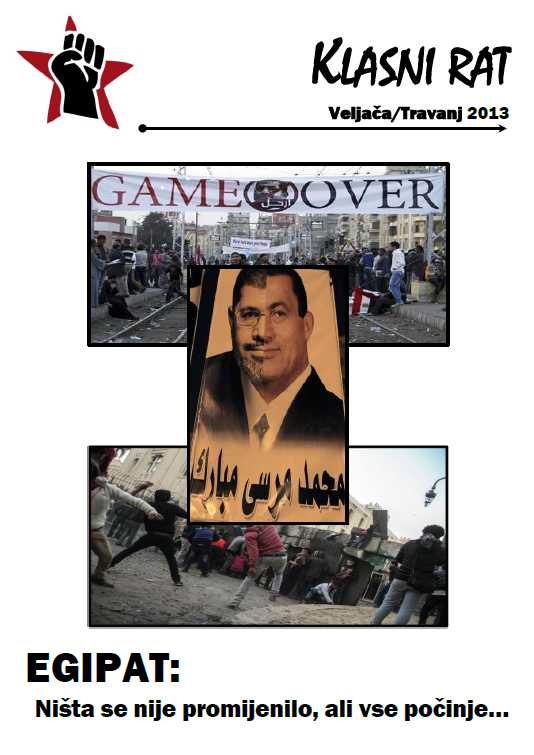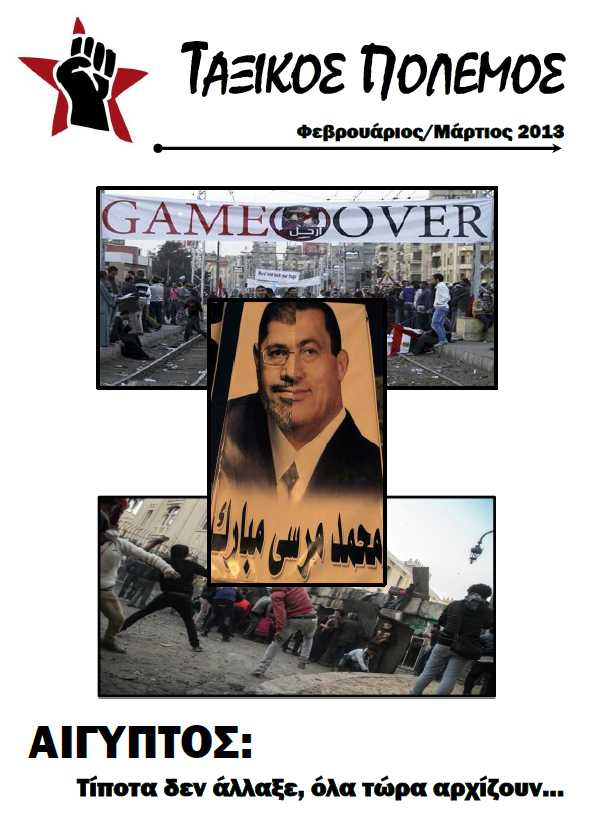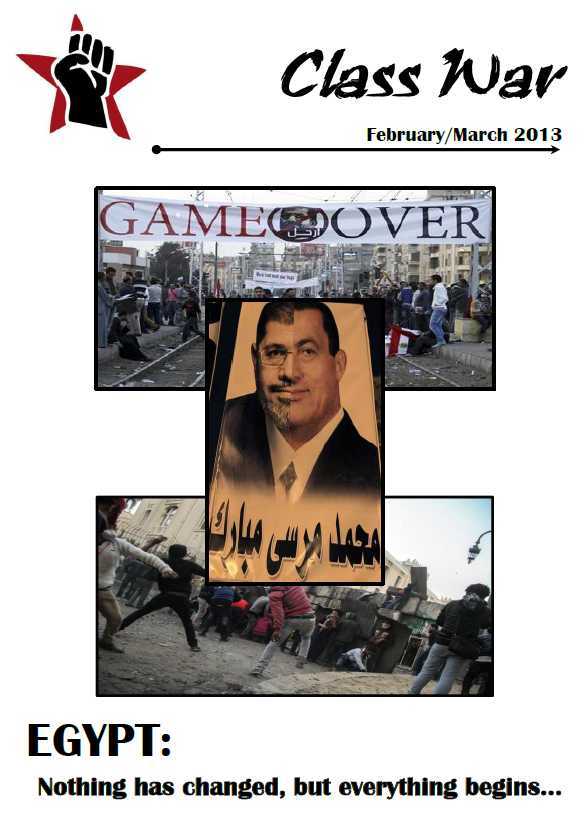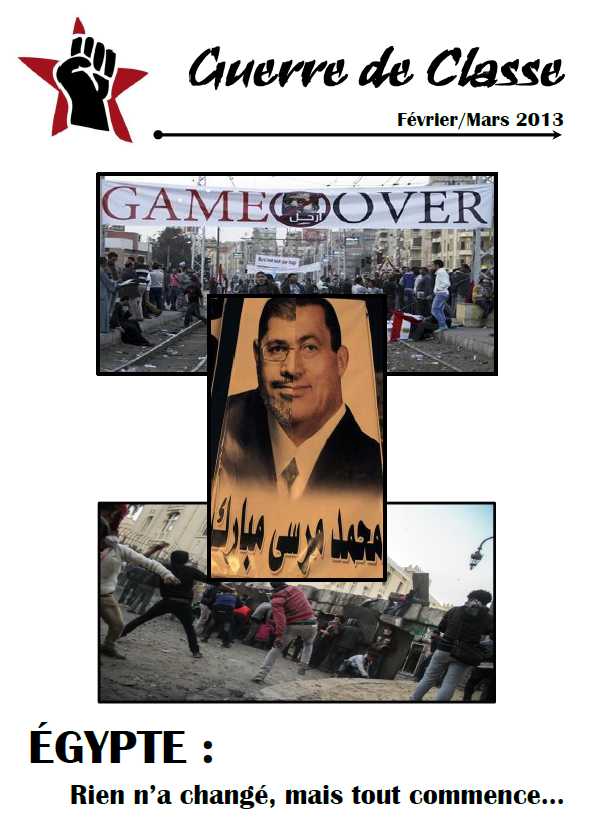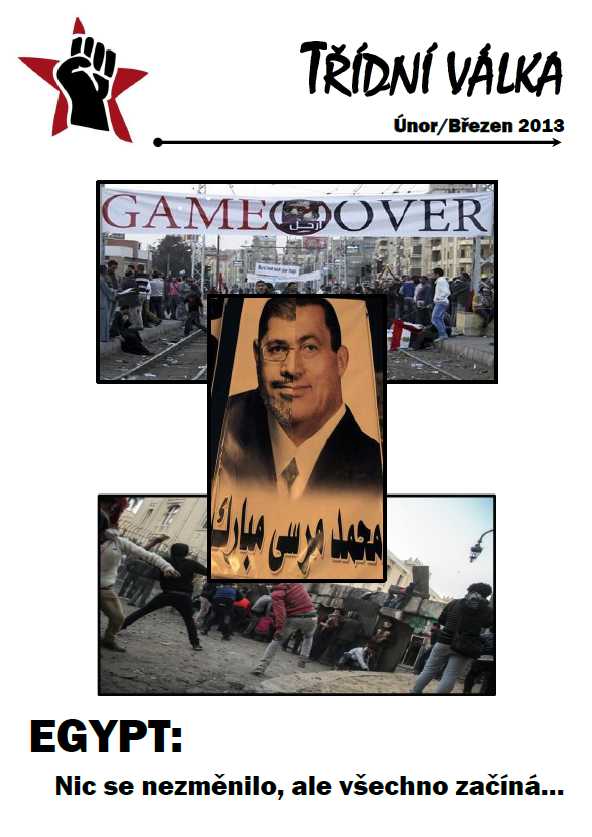Nous republions ici le texte du Groupe Communiste Internationaliste – GCI « A propos des luttes prolétariennes en Argentine », dans la mesure où celui-ci dépasse le cadre strict de ce qui s’est déroulé dans ce pays il y a vingt ans. La bourgeoisie a tout fait pour disqualifier et falsifier ces luttes ; s’il en est ainsi, c’est parce que, sous bien des aspects, ces luttes indiquent, avec leurs forces et faiblesses, ce qui pourrait se produire sous d’autres latitudes. C’est pourquoi elles ont suscité à l’époque, et continuent de susciter, un grand nombre de discussions entre camarades partout dans le monde. Et c’est également pour ces raisons que nous revenons sur le sujet : à savoir, en quoi la défense du caractère prolétarien de ces luttes et les discussions qui l’accompagnent contiennent une validité à perspective internationale et internationaliste.
Guerre de Classe, 31 décembre 2021.
A propos des luttes prolétariennes en Argentine
Première partie
(in Communisme n°54 – avril 2003)
Malgré les illusions dont se sont bercés ces dernières années, aussi bien les capitalistes qu’un grand nombre de prolétaires, la société marchande et l’Etat bourgeois se révèlent de fait, incapables d’assurer le minimum vital à la majorité de l’humanité. Dans la réalité, pour assurer son développement, son progrès, la société doit imposer des conditions d’existence de plus en plus misérables à un nombre toujours croissant de prolétaires de cette planète. Face à cela, encore une fois, le prolétariat en Argentine est descendu dans la rue et a assumé son opposition à la propriété privée en affrontant ouvertement les structures de l’Etat.
Le cas de l’Argentine n’est pas fondamentalement différent de celui des autres pays. Le développement catastrophique du capital et la réponse prolétarienne aux conditions misérables que ce dernier impose ne varient pas énormément d’un pays d’Amérique à l’autre, d’une région du monde à une autre. La différence régionale, nationale,… quelle que soit sa force, ne constitue jamais, nulle part, le centre de l’histoire. Au contraire, aujourd’hui, étant donné l’accélération de la catastrophe capitaliste, la crise économique passe d’un pays à l’autre, se généralise par continents entiers ; elle fait chanceler la stabilité du système et pousse le prolétariat vers la seule alternative possible : l’assumation toujours plus précise de son programme historique. Les luttes prolétariennes aussi se multiplient et semblent passer d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre. On assiste à une concentration dans le temps et à une intensification des luttes qui pourraient indiquer l’ouverture d’une phase différente dans la lutte de classes, une phase où le rapport de force commencerait enfin à changer.
A la liquidation des luttes prolétariennes des années 1960 et 1970 succéda une période de disparition presque totale des luttes pendant les années 1980. Ensuite, les années 1990 virent réapparaître des luttes naissantes et isolées mais fortes et qui, depuis le début de cette décennie, semblent se concrétiser par des ruptures pratiques et programmatiques, processus dans lequel le prolétariat prend conscience de son appartenance de classe et de sa force potentielle. Les illusions bourgeoises que portaient également les prolétaires à propos de la disparition du prolétariat et de la fin présumée de la crise, volent en éclats.
Le capital, et plus concrètement la fraction impérialiste dominante actuelle, semble avoir une confiance inébranlable dans sa puissance, dans sa force ; cette fraction semble à ce point persuadée de la fin historique du prolétariat… qu’elle s’offre le luxe de prévoir les conflits sociaux dans les différentes régions du monde (conflits produits le plus souvent directement par les politiques impérialistes) et de les utiliser non seulement comme moyen de répression contre le prolétariat mais aussi comme arme de la domination inter-bourgeoise. Cependant, son arrogance lui explose en pleine figure lorsque le prolétariat, contraint par la dégradation de ses conditions d’existence, refuse les carottes que le système démocratique agite sous son nez et réapparaît violemment sur la scène de l’histoire en occupant la rue et en affrontant de façon déterminée le capital et l’Etat.
1/ Réapparition et affirmation du prolétariat en Argentine
La lutte du prolétariat en Argentine se distingue par une tendance croissante à l’organisation et à l’affirmation de la pratique prolétarienne contre la propriété privée, contre l’Etat, pour l’amélioration des conditions de vie, en rupture avec les partis parlementaires et les syndicats officiels. Elle se distingue surtout parce qu’elle impose une force qui annihile de fait le décret de l’état de siège : la nuit du 19 décembre 2001, au moment même où le président argentin annonce l’état de siège, la rue est massivement envahie et une lutte violente contre la propriété privée et l’Etat se propage. Pour comprendre l’importance historique de cet acte contre l’Etat, il faut savoir que, dans les années 1970, les gouvernements démocratiques de la région avaient pris des mesures similaires, mesures qui avaient constitué le coup d’envoi de la généralisation des tortures et des disparitions des prolétaires combatifs de l’époque et qui se soldèrent par plus de 30.000 personnes disparues et assassinées rien qu’en Argentine. Soulignons également que c’est la première fois dans l’histoire de l’Argentine que la violence révolutionnaire du prolétariat parvient à faire tomber un gouvernement.
Pendant tout le mois de décembre et particulièrement les 18, 19, 20 et 21, les affirmations de la force prolétarienne se multiplièrent : réappropriation généralisée des moyens de vie, par l’attaque de la bourgeoisie et de son Etat.
Début décembre, commence la lutte contre les supermarchés, on réclame des moyens de survie… A partir du 18, aux quatre coins d’Argentine, le prolétariat
• assaille supermarchés, camions de livraison, commerces, banques, usines,…
• partage des marchandises expropriées entre les prolétaires et approvisionne les cantines « populaires » avec le produit des récupérations,
• prend d’assaut et incendie des immeubles emblématiques de l’Etat, telle la Casa Rosada (siège du gouvernement) et du capital financier et multinational : attaques de banques, de fast-foods,…
• s’affronte à la police et autres corps de choc de l’Etat telles les bandes de voyous mercenaires péronistes et ce, particulièrement le jour où, alternative de droite à la présidence social-démocrate éclair de Rodriguez Sáa, Duhalde prend place à la tête du gouvernement,
• organise des Cacerolazos (vacarme provoqué en frappant sur des casseroles), manifestations, marches et autres protestations massives devant les portes des institutions « prestigieuses » de l’Etat, comme les bâtiments du gouvernement, le parlement et le tribunal suprême,
• organise des barrages routiers, suivant la pratique habituelle du mouvement piquetero[1].
L’aspect le plus significatif de cette action prolétarienne réside dans sa généralisation et sa concentration dans le temps. Nous allons maintenant aborder certains éléments de cette affirmation prolétarienne et, ensuite, nous insisterons sur les faiblesses que recèle encore notre mouvement en Argentine.
2/ La signification des saqueos[2] : attaque généralisée à la propriété privée et à l’Etat
Les saqueos ont fait la une des journaux du monde entier, la presse mondiale a parlé de révoltes de la faim, de crise et de corruption en Argentine et ces moyens de falsification de l’opinion que nous savons être nos ennemis ont même justifié, de façon paternaliste et condescendante, les saqueos en disant, de façon tantôt implicite, tantôt explicite, qu’il était logique, étant donné la misère, que les gens attaquent les supermarchés pour y chercher à manger.
Bien entendu, ce point de vue occulte plus de choses qu’il n’en révèle. D’abord, et c’est le plus évident, on recherche des causes et des explications locales telle la corruption de la classe politique. Mais, ceci contredit l’explication elle-même parce que si c’était vrai, le même phénomène se produirait partout et surtout en Europe ou aux Etats-Unis où la corruption généralisée est irréfutable. Autre explication qui n’a guère plus de succès en Amérique Latine mais qui marche un peu mieux dans le reste du monde : la pauvreté et le manque de développement. Mais il s’agit d’une évidente grossièreté pour un pays qui fut non seulement l’un des plus industrialisés mais aussi le grenier et l’hacienda du monde entier. Enfin, on tente d’imputer la faute au Fond Monétaire International et à l’impérialisme yankee, ce qui a certainement plus de succès vu la propagande de la gauche en ce sens.
Ce que toutes ces explications dissimulent en fait, c’est que la contradiction que vivent les prolétaires en Argentine ne se situe pas vis-à-vis de tel ou tel gouvernement, tel ou tel impérialisme mais qu’il s’agit de l’opposition vitale et irréversible entre l’être humain et le monde de la marchandise. Ces explications cachent le fait que tant l’affamement généralisé (au sens de privation de l’être humain de tout, pas seulement de nourriture) du prolétariat en Argentine que son attaque au monde de la propriété privée ne sont que des manifestations supplémentaires de la catastrophe capitaliste, de l’incapacité totale de la société marchande à satisfaire le prolétariat et confirment notre affirmation de toujours : Mai la merce sfamerá l’uomo (« jamais la marchandise ne rassasiera l’homme »). La marchandise ne pourra jamais éliminer la faim, elle ne pourra jamais résoudre les problèmes vitaux de l’humanité ; c’est pourquoi, la société marchande est condamnée à périr. On veut camoufler que, quoi que fassent les réformistes de tous bords, ce monde de la propriété privée, de la marchandise et de l’argent est contraint d’affamer toujours plus de gens sur la planète. On tente de masquer le fait que l’attaque à la propriété privée, comme réponse impérieuse du prolétariat en Argentine, a exactement les mêmes racines et va dans la même direction que la lutte du prolétariat en Algérie, en Uruguay, au Paraguay, en Equateur, en Colombie, en Indonésie,… Et, pour finir, nous voudrions hurler, à contre-courant de toute cette fange, que la contradiction entre vie humaine et monde de la marchandise qui explose de toutes parts et se concrétise dans les saqueos généralisés en Argentine est aussi celle qui s’incarne dans la chair de plus de deux millions d’êtres humains qui survivent dans les prisons aux Etats-Unis. Cette contradiction continuera à s’aggraver, inéluctablement, jusqu’à la destruction de la société marchande généralisée.
Oui, bien sûr, aujourd’hui en Argentine il y a la faim, mais cette faim n’est pas due au manque de développement ou à une politique impérialiste en particulier, elle est un produit du développement, c’est une faim produite par le développement nécessairement chaotique du capital mondial. Et si, bien sûr, ce capitalisme d’aujourd’hui est plus « sauvage »[3], meurtrier pour l’humanité, ce n’est pas la faute de tel grand manitou ou de tel politicien corrompu, c’est parce que la crise généralisée de la valorisation du capital se heurte toujours plus aux besoins de l’espèce humaine.
Oui, bien sûr les prolétaires ont pillé pour pouvoir se nourrir ; ils n’avaient pas d’autre solution ! Et cela, le discours paternaliste des médias n’a pas manqué de le souligner. Mais la cible des expropriations fut bien plus large que la nourriture car la privation dont nous sommes l’objet ne se réduit pas à celle-ci. Par ailleurs, les prolétaires n’ont pas uniquement attaqué les dépôts, les supermarchés, les usines, les camions,… pour s’approprier de quoi vivre, ils ont assumé ouvertement une attaque bien plus globale contre la bourgeoisie parce qu’ils ressentent dans leurs tripes que c’est l’Etat capitaliste dans son ensemble qui les affame. Cela aussi a été systématiquement occulté : si on ne pouvait dissimuler que le prolétariat résistait à la faim (jusque-là, la révolte prolétarienne pouvait être présentée comme une « simple » révolte de la faim dans un pays du tiers monde, comme ils disent), on pouvait au moins cacher qu’il s’agissait d’une affirmation générale de la classe qui non seulement s’appropriait tout ce qu’elle pouvait (ce qui est bien plus large que la nourriture) mais qui détruisait physiquement les symboles de cette société basée sur la propriété privée. En effet, il ne s’agit plus uniquement de manger aujourd’hui, il s’agit d’affirmer la puissance de classe contre le monde de la privation généralisée. Il était et est indispensable non seulement de se nourrir mais aussi d’affirmer la vie, sentir le besoin d’être ensemble, sentir la joie que procure sa propre force, faire la fête avec ce qu’on a exproprié et pleurer ceux qui sont tombés ou, mieux encore, transformer la tristesse pour nos frères tombés dans la lutte en rage et en force révolutionnaires. Dans les rues d’Argentine, le prolétariat commence à se reconnaître comme tel, la camaraderie ressurgit, l’individualisme recule ; dans la rue, la communauté de lutte renaît.
Oui, nous sommes allés chercher l’argent et tout ce qu’il était possible de prendre dans les entreprises, les banques,… mais le sens profond de ces actes allait bien au-delà des faits : c’était une attaque généralisée contre ce monde de l’argent, de la propriété privée, des banques et de l’Etat, contre ce monde qui est une insulte à la vie humaine. Il s’agissait non seulement d’exproprier mais aussi d’affirmer la puissance révolutionnaire, c’est-à-dire la puissance de destruction d’une société qui détruit l’être humain. Et cela s’est produit en Argentine mais également dans un nombre croissant de pays, ces deux dernières années.
Pratiques d’affirmation prolétarienne
La catastrophe du capitalisme se concrétise dans l’aggravation des conditions de vie du prolétariat. Contre cela, s’affirment des pratiques contre la propriété privée, l’Etat, la répression,… Assauts, attaques, occupations de bâtiments (jets de pierres, incendies, prises et destructions,…), expropriations de marchandises (« saqueos »), terres, maisons, bâtiments du gouvernement, palais de justice, sièges régionaux du gouvernement ou du gouvernement régional, bâtiments ministériels, mairies, hôtels de ville, commissariats, chaînes de télévision, radios, journaux, universités, centres d’enseignement secondaire… Prises et pillages d’usines… Marches et manifestations, « cacerolazos », mots d’ordre prolétariens… Barrages de routes, de ponts et d’accès, parfois pendant de longues périodes… Blocage des transports, grèves, radicalisations des mobilisations convoquées par les réformistes dont l’intention est de récupérer les luttes… Affrontements à tous les corps de répression (différents types de polices, unités de l’armée, corps de choc de l’Etat en civil). L’« «escrache », dénonciation publique des cadres du capital chargés de la répression, s’étend comme pratique prolétarienne généralisée : hommes politiques, bourreaux, policiers, juges, grands entrepreneurs et journalistes sont la cible habituelle de ces « escraches ». Face aux élections : généralisation de l’abstentionnisme, du vote nul, développement de pratiques d’intimidation et rejet général des élections, des collèges électoraux (comme en Kabylie, en Algérie en 2002 !), des partis politiques,… Association, organisation, réunion, expression, coordination des prolétaires partout…
Là où la lutte se développe le plus, particulièrement au Mexique, en Equateur, en Bolivie, en Algérie, au Paraguay,… comme en Argentine, les prolétaires s’organisent territorialement par quartiers ou localités, articulant les efforts de façon coordonnée, généralement sans dépendre de partis ou de syndicats – et souvent ils s’organisent ouvertement contre ces derniers.
En plus du pillage des supermarchés, les saqueos et les attaques de banque et de distributeurs de billets furent massifs. Certains groupes d’action allèrent même jusqu’à amener les distributeurs de billets sur les places des quartiers ! Evidemment il y eut des affrontements entre les pilleurs et certains commerçants, ce dont les médias bourgeois de propagande se sont emparés pour dénigrer le mouvement prolétarien en disant qu’il y avait des pillages entre quartiers. Cependant, ce problème que nous analysions lors des saqueos de 1989 en Argentine est dépassé par la lutte actuelle. Dans l’article que nous publiions alors, nous disions : « C’est à ce moment-là qu’est montée une véritable opération de contre-information… partout circulent des rumeurs rapidement intégrées par les ‘pilleurs’ comme quoi tel quartier se prépare à attaquer tel autre et qu’il faut se défendre, etc. et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce mensonge est pris au sérieux par une grande partie des protagonistes de ces événements. » A la fin de l’année 2001 et au début 2002, les fossoyeurs de la réalité ressortent leur vieille histoire, mais cette fois les prolétaires ne tomberont pas dans le panneau. Plusieurs journalistes sont escrachés par le mouvement. Ni ces agents constitutifs de l’Etat, ni les politiciens, ni les bourreaux, ni les entrepreneurs ne peuvent sortir de chez eux sans escorte. Une terreur froide les envahit, le fantôme de ceux qu’ils croyaient morts et enterrés leur crache à la figure.
L’Etat argentin aussi pensait qu’il ne s’agissait que d’un problème purement alimentaire et eut recourt au vieil expédient de la charité. Au début des pillages de décembre 2001, comme lors du Cordobazo (1969/70) et comme en 1989, l’Etat fit œuvre de bienfaisance et organisa la distribution caritative de vivres. La réponse des prolétaires ne se fit pas attendre. Ces lamentables miettes ne trompèrent personne. C’est à coups de pierre et par une augmentation du nombre de pillages que la rage prolétarienne répondit à la manœuvre répugnante par laquelle la bourgeoisie espérait mettre un terme au mouvement. Une fois de plus, la poudre sortit du fusil par la culasse et lui explosa en pleine figure. C’est ainsi que mi-décembre 2001, pas un seul recoin du pays ne fut épargné par les pillages, attaques de bâtiments, occupations de maisons, piquets ou barrages de routes…
On tente de nous présenter la misère comme étant simplement la misère et on nous cache le caractère subversif et révolutionnaire que contient la misère, la lutte contre la misère ; on occulte le fait que l’affirmation du prolétariat en lutte en Argentine va bien au-delà des simples pillages de la faim qu’on nous montre. En effet, dans la rue, l’attaque généralisée contre la propriété privée et l’Etat est ouvertement assumée, la force destructrice de cette société basée sur la propriété privée s’affirme de façon naissante.
Autre aspect décisif de cette affirmation : la revendication ouverte de la continuité historique de la lutte actuelle avec la lutte révolutionnaire du passé. Malgré la puissante répression qui s’est abattue sur le prolétariat dans cette région pendant des décennies, les combattants prolétariens actuels revendiquent et, dans une certaine mesure, assument le passé de la lutte de notre classe, affirmant des éléments importants de leur conscience de classe. Des mots d’ordre et des chants prolétariens font sans cesse référence aux luttes de 1989, au Cordobazo et à la Semaine Sanglante de 1919. Les mouvements historiques de notre classe que la terreur d’Etat croyait pouvoir enterrer à jamais sont revendiqués et reprennent vie dans des consignes telles Qué cagazo, qué cagazo, echamos a De la Rua los hijos del Cordobazo! (« Quel effroi, quel effroi, les enfants du Cordobazo ont fait tomber De la Rua ! »)
3/ Rupture avec les partis et les syndicats et généralisation des escraches
L’autre point déterminant dans l’affirmation du prolétariat est sans aucun doute la rupture avec les partis et les syndicats et la généralisation des escraches.
La rupture avec les partis politiques et les syndicats traditionnels s’est affirmée pendant toute la période mentionnée dans ce texte. Manifestations, action directe, occupation de la rue ou de bâtiments… se font sans l’assentiment des partis et des syndicats qui, en général, se plient à certaines de ces actions pour ne pas être totalement dépassés. Mais les drapeaux des partis politiques ne sont pas admis dans les manifestations (pas même ceux de HIJOS) et les syndicalistes ne peuvent assister aux assemblées qu’à titre personnel. Suivant le mot d’ordre général du mouvement de décembre (Que se vayan, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, c’est-à-dire « Qu’ils s’en aillent, qu’ils s’en aillent tous, qu’il n’en reste plus un seul »), les prolétaires exigent et obtiennent la démission de « leurs » présidents : De la Rua, Rodríguez Sáa… Ils expriment ainsi leur dégoût et leur rejet du système électoral, de tous les partis politiques… du gouvernement. Lors des élections, le vote majoritaire sera le vote dit « vote de la colère » ou « vote de la rage », un vote non valide, à annuler. Des groupes de prolétaires impriment des bulletins électoraux sur le mode du pamphlet avec pour légende « Aucun parti. Je ne vote pour personne. Vote de la rage ». La généralisation de cette pratique contre les élections que les prolétaires en Argentine affirment au même moment que leurs frères en Algérie (sans le savoir, parfois) est une affirmation supplémentaire de la rupture prolétarienne avec les différentes institutions de l’Etat capitaliste et en particulier avec les principaux partis et syndicats, rupture qui va continuer à se produire tout au long de cette période.
La pratique de l’escrache que le prolétariat a développé en Argentine et qu’il utilisait jusqu’ici systématiquement contre les bourreaux, s’est élargie contre les politiciens, les entrepreneurs, les journalistes, les juges,… Depuis plus d’un an, l’extension des escraches visant tous les personnages de l’Etat est générale. Députés, ministres et ex-ministres, juges, personnages importants de la finance, journalistes,… personne n’y échappe. La peur augmente dans les quartiers bourgeois et dans les demeures des responsables du gouvernement, de la répression, des finances, des journaux,… de même que chez les députés du parlement ou au palais de justice, dans les rédactions, les casernes et les chaires des églises. Chacun d’eux tremble à l’idée de sortir de chez soi, d’être reconnu. Voici quelques exemples de personnages considérés comme représentatifs du spectre socio-politique escrachés depuis décembre[4] : De la Rua, Anibal Ibarra (ex-membre du gouvernement), le chef de la CGT dissidente Hugo Moyano, le président de l’association des industriels Ignaicon Mendigueren, Raúl Alfonsín (ex-président argentin) ou Angel Rozas.
« La situation est très mauvaise. Ils peuvent aller jusqu’à lyncher un homme politique » déclare un évêque à la presse. Les appels à la formation d’un front d’unité populaire (peu importe son nom, front uni par la base ou par la direction ou contre les corrompus,…) lancés par différents politicailleurs ou syndicalistes de service sont rejetés par la pratique du prolétariat dans la rue.
Les escraches contre les chefs syndicaux et les chefs des syndicats alternatifs sont le complément des consignes chantées dans la rue et confirment l’importance de la rupture du prolétariat avec les syndicats : ¿Adónde está, Adónde está la burocracia sindical? et ¿Adónde está, que no se ve, esa famosa CGT? (« Où est-elle, où est-elle la bureaucratie syndicale ? » et « Où est-elle, on ne la voit pas, la fameuse CGT ? »).
Les partis politiques et leurs représentants sont, quant à eux, à tel point brûlés qu’ils ne savent plus que faire. Duhalde lui-même reconnaîtra avec chagrin cette réalité dans une interview au journal Clarin (24/03/02) : « Le consensus social, personne ne l’a, malheureusement. Lisez les sondages, aucun dirigeant n’a plus de 10%. Le discrédit est épouvantable, mais il faut continuer… »
4/ Auto-organisation de la classe : piquets et assemblées
Le développement du capitalisme en Argentine ces dernières années suit les mêmes règles que partout ailleurs : il y a toujours plus de prolétaires sans emploi ou ayant des boulots précaires et mal payés. C’est sur cette réalité, totalement internationale, que se basent tous ceux qui prétendent que le prolétariat a disparu ou est en train de disparaître. A croire qu’on serait moins prolétaire alors qu’on perd son boulot ou que, d’une façon ou d’une autre, les conditions d’exploitation empirent !!!
En réalité, c’est la masse toujours croissante de prolétaires sans emploi qui permet au capital de détériorer les conditions de vie et de travail du reste du prolétariat. Aujourd’hui, on gagne moins et on travaille plus intensément et un plus grand nombre d’heures que jamais auparavant. Tout le monde sait que l’archétype du pays qui attirait les ouvriers européens en quête d’un meilleur salaire a été réduit à néant. Il ne reste rien non plus de ces limitations de la journée de travail à six heures que certains secteurs du prolétariat avaient réussi à imposer dans la région. Par exemple, l’horaire maximum des travailleurs du métro de Buenos Aires (obtenu lors des luttes de 1948) qui était de six heures par jour, fut augmenté, en 1994, à huit heures, ce qui déclencha d’intenses luttes qui aujourd’hui encore se poursuivent. La liquidation de postes de travail, l’offre excessive de bras et le terrorisme d’Etat généralisé pendant des décennies ont permis au capital d’accroître brutalement le taux d’exploitation, d’augmenter de façon générale la misère du prolétariat dans sa globalité. Pendant ces années, et exception faite de la réapparition soudaine des saqueos de 1989, le prolétariat semblait avoir cessé d’exister, il n’y avait plus que des travailleurs soumis et incapables de répondre. Pire, les éléments historiques de solidarité de classe, la camaraderie au travail, l’entraide et l’amitié dans les quartiers et la profonde haine envers tout ce qui venait de l’Etat, qui avaient caractérisé le prolétariat dans les années 1960 et 1970, étaient profondément cassés. De nombreux camarades signalaient la rupture généralisée de ce tissu social de camaraderie et le succès indiscutable, accompagné de la terreur d’Etat, du « débrouille-toi comme tu peux », de l’individualisme, de ce modèle capitaliste que Menem représente si bien. Les théories sur la disparition du prolétariat se propageaient sans entrave en Argentine jusqu’à ce que la violente réaffirmation actuelle les frappe de plein fouet. L’affirmation prolétarienne en Argentine n’aurait pas été possible sans le développement du mouvement piquetero, fer de lance de l’associationnisme prolétarien durant ces cinq dernières années.
La théorisation social-démocrate, à la mode dans toute la société mais qui est particulièrement propagée par les staliniens et les trotskistes recyclés en « libertaires », affirme qu’avec les usines disparaissent les prolétaires et avec eux, le prolétariat comme sujet historique : on ne peut déjà plus paralyser la production comme avant. Mais le prolétariat, c’est bien plus que l’ouvrier productif et la production capitaliste, c’est bien plus que la production immédiate d’objets industriels. Les piquets en Argentine, la paralysation de camions, de routes, d’autoroutes et leur extension à d’autres pays ont montré au monde entier que le prolétariat comme sujet historique n’était pas mort et que le transport constituait le talon d’Achille du capital dans sa phase actuelle.
La vieille tendance à rendre le travail de plus en plus collectif se concrétise dans le fait que chaque produit est le résultat d’un nombre toujours croissant de tâches techniques provenant de différents endroits et donc d’un nombre toujours croissant de transports. La division généralisée du travail, ajoutée à l’absence de tout plan d’ensemble qui fait que la seule autorité reconnue soit la compétitivité[5] conduit à ce que le plus petit produit contienne un nombre incalculable de kilomètres de transport et montre toute l’irrationalité du système. Ainsi, par exemple, certaines études montrent qu’un produit aussi simple qu’un yaourt dont le petit pot ne contient que du lait, un ferment et éventuellement du sucre et des fruits, un yaourt donc, parcourt quelques 8.000 kilomètres avant d’arriver sur notre table si on tient compte du trajet effectué par chacun des sous-produits entre chaque lieu de transformation. Pour fabriquer un simple « pot de yaourt en verre, en plastique, en aluminium ou en papier, différentes unités productives entrent en jeu, dans le dernier cas par exemple, la production de la pâte se fait dans une région, celle du carton dans une autre, l’impression dans une troisième et le collage de l’étiquette ailleurs encore »[6].
Dans ce processus que nos ennemis appellent mondialisation ou globalisation (et qui pour nous n’est autre que l’affirmation de ce despotisme irrationnel de la division du travail dans laquelle le caractère de plus en plus collectif du travail exprime son antagonisme avec l’appropriation privative), le prolétariat serait liquidé parce que, selon eux, les usines auraient de moins en moins d’importance relative. Les chômeurs, les « femmes au foyer », les enfants, les vieux, les gens du quartier seraient réduits par ce processus à une impuissance sociale totale et à la nullité politique absolue parce que, toujours selon nos ennemis, ils ne pourraient développer aucune action de force. Ce serait donc la fin de tout questionnement social et, pour beaucoup, la fin de l’histoire ! Mais tout comme ils n’ont pas compris le b a ba des tendances inhérentes au capitalisme, ils n’ont pas non plus prévu le b a ba de la lutte prolétarienne : l’occupation de la rue, l’associationnisme territorial, un rapport de force basé sur la menace de la paralysation de l’économie bourgeoise. Les piquets, c’est exactement cela.
Le piquet, ce n’est pas nouveau, et le barrage routier n’est pas une invention argentine. Les piqueteros se situent dans la trajectoire historique du prolétariat international qui, pour assurer l’efficacité d’une grève, organise des piquets afin d’empêcher les jaunes de venir travailler. Les piqueteros assument ouvertement cette trajectoire qui jouit d’une sympathie et du respect de tous ceux qui luttent contre les patrons et l’Etat. Les « personnes », celles dont il était dit qu’elles ne pouvaient même pas donner leur opinion, se constituent en classe opposée à tout l’ordre établi : les exclus (ainsi sont-ils catalogués) qui n’ont ni voix ni vote au sein du système émergent comme force prolétarienne contre ce dernier. En Argentine, le développement de cette force de classe s’est révélé si puissant que même les prolétaires qui avaient encore un boulot et qui occupaient « leur » lieu de travail sont sortis du cadre de l’usine et ont rejoint leurs frères de classe (généralement considérés comme plus « faibles » mais à l’avant-garde car n’ayant pas d’emploi) dans la rue.
Ces dernières années, toute grande lutte est coordonnée et articulée autour des piquets, des assemblées et des structures de coordination des piqueteros. Le prolétariat affirme ainsi son organisation comme classe autonome, occupant la rue et s’organisant par quartier, c’est-à-dire territorialement, ce qui a toujours représenté un pas qualitatif dans le mouvement. Même la catégorisation inclus/exclus imposée par les forces du capital ne parvient pas à maintenir la division.
Les piquets commencent à se développer à la fin du gouvernement Menem, à partir du Santiagueñazo en 1994. Leur force vient d’abord du fait de s’être organisés hors de toutes les institutions politiques et sociales du pays : partis, syndicats, ONGs, églises,… La pratique des piquets qui barrent les routes, interrompant la circulation des marchandises (y compris de la force de travail) et donc de la production et de la reproduction du capital, se révèle immédiatement plus puissante que la grève dans une seule entreprise, parce qu’elle paralyse non pas un capital particulier mais un grand nombre de capitaux, avec une tendance à paralyser le capital national et pourquoi pas, ensuite, international. La paralysation de la production comme action de force prolétarienne affecte directement le marché national et d’outremer.
Le fenómeno piquetero commence à l’intérieur du pays (Cutral-Có et Plaza Huincul à Neuquen) et s’étend à travers le pays jusqu’à paralyser toutes les grandes villes, y compris Buenos Aires. Cette pratique prend force à mesure que d’autres exclus commencent à percevoir cette lutte comme la leur. Lorsque, ailleurs, des prolétaires, avec ou sans travail font de même, ils constatent que, pour la première fois de leur vie, ils sont écoutés. Dans ce processus de constitution en force, les prolétaires sentent dans leur propre chair la frontière qui les sépare des défenseurs du monde de la propriété privée. Le fait que la barricade n’ait que deux côtés se vit dans la rue. En même temps, on rompt non seulement avec la peur d’agir contre le capitalisme mais aussi avec les pratiques individualistes, avec le chacun pour soi, la concurrence entre travailleurs, entre chômeurs, avec le fait de couillonner son voisin, avec l’arrivisme. Les vieilles pratiques de solidarité de classe ressurgissent de leurs cendres et rompent avec l’individualisme régnant. Se redéveloppe un processus organisatif basé sur les assemblées de quartiers où les protagonistes se reconnaissent pour ce qu’ils sont tout en identifiant, en même temps, leurs ennemis. Dans les piquets et l’action directe renaissent l’amour et la camaraderie, dans le pillage d’un supermarché et la fête de quartier qui s’ensuit s’affirment des éléments de fraternité et d’humanité que les plus jeunes n’ont jamais connus.
Le barrage des routes est bien évidemment illégal. Les prolétaires qui assument cet acte le savent et ce fait même ancre cette action en dehors et contre les forces et les institutions bourgeoises. Pour les syndicats, les partis et autres institutions qui cherchent à encadrer le prolétariat, il s’agit d’une « grève ou action sauvage » qui, c’est un comble, s’impose par surprise, se généralise et les laisse complètement paralysés. Plus encore, tout délégué syndical ou politique est terrorisé à l’idée de devoir se déplacer, de sortir dans la rue et de se trouver coincé par un piquet parce qu’il court le risque d’être identifié et escraché. Il est donc tout à fait logique que les piquets aient été réprimés et que, pour résister et se développer, ils aient dû devenir de plus en plus organisés et puissants. Ainsi, lorsque la répression et les affrontements se généralisèrent, on créa des structures organisatives, de sécurité, d’action et des réseaux de communication et de soutien plus large que le quartier pour agir efficacement. Donc, si pour le piquet, le barrage routier est la méthode de lutte principale, l’action du piquetero ne se limite pas à cela : au contraire, il faut toujours plus d’organisation permanente, d’assemblées, de réunions quotidiennes, de coordination et de centralisation de cette action directe d’affrontement au capital et à l’Etat. Des minorités organisées, des groupes d’action et d’autodéfense, des groupes de soutien,… se sont dès lors développés dans chaque quartier et ils ont eu une importance décisive dans l’affirmation prolétarienne qui a précédé l’explosion de décembre 2001 : en août de cette année-là, plus de 100.000 prolétaires organisés en piquets avaient réussi à paralyser plus de 300 routes du pays !
Malgré la répression et les tentatives de récupération, le mouvement a continué à s’affirmer avant et après décembre 2001. Le nombre de piqueteros morts en 2001 et celui plus élevé encore pour l’année 2002, les centaines de blessés, les milliers d’arrestations ne sont pas parvenus à freiner le mouvement, au contraire, cela lui a fait comprendre que l’organisation, la sécurité et la préparation à l’affrontement sont fondamentaux et que les tendances légalistes qui, bien sûr, existent en son sein sont totalement antagoniques aux intérêts prolétariens.
Il est clair que ces organisations territoriales de prolétaires, bien que structurées en dehors et contre la majorité des institutions, ne sont pas exemptes de faiblesses et d’idéologies bourgeoises (comme tout conseil ouvrier ou soviet) sur lesquelles s’érige un ensemble de tendances qui cherche à liquider l’autonomie du mouvement, à l’institutionnaliser et qui, en dernière instance, l’entraîne vers sa propre mort.
Ceci nous amène à parler des faiblesses et contradictions qui se manifestent dans le mouvement. Ainsi lors de la « Première Rencontre Nationale des Piqueteros », conçue comme instance d’affirmation, de coordination et de développement prolétarien, un ensemble de manœuvres et de tentatives d’institutionnalisation se produisirent. Par exemple, contre toute prévision des organisateurs, un groupe de députés nationaux se présentèrent et tentèrent de faire un discours. Cependant, rejetés par la quasi-totalité des 2.000 délégués piqueteros présents, ils ne purent dire un mot. De la même façon, Hugo Moyano, secrétaire de la CGT dissidente, fut hué et on ne le laissa pas parler, même lorsqu’il tenta de saluer le congrès. Le rejet des partis politiques et des syndicats fut général tout au long du congrès.
Cependant, ce congrès pendant lequel sera mis sur pied un plan de lutte signifiant l’intensification des barrages routiers pour le mois à venir va être l’objet d’une tentative de contrôle de la part d’une tendance qui cherche à institutionnaliser le mouvement. Au sein de cette tendance se retrouvent, la CTA (Centrale des Travailleurs Argentins) à laquelle adhère l’importante Fédération de Terre et Logement, le CCC (Courant Classiste et Combatif) et le Pôle Ouvrier-Parti Ouvrier. Mélange de différentes idéologies politicistes et gauchistes (populisme radical, trotskisme, maoïsme), cette tendance cherche, dans sa pratique, à officialiser le mouvement piquetero, à en faire un interlocuteur valable, avec des représentants permanents et des formulations de revendications claires auquel l’Etat puisse répondre (« liberté pour les combattants sociaux prisonniers, Planes Trabajar[7] et fin des politiques de conciliation néolibérales »), ce qui mènent les tenants de cette tendance à accepter un ensemble de conditions qui dénaturalisent la force du mouvement et tend à sa liquidation. Après cette première rencontre, les représentants de cette tendance, nommés représentants officiels du mouvement, annoncent dans une conférence de presse que, désormais, les barrages se feront « sans cagoule » et « sans barrages totaux des routes », ce qui, ajouté au caractère limité et « raisonnable » des revendications, représente évidemment un coup brutal contre ce que le prolétariat avait affirmé dans sa pratique. Mais, malgré cette politique liquidatrice (de l’Etat, des dirigeants et forces qui collaborent pour imposer l’ordre) qui, par son politicisme et son légalisme, désorganise et affaiblit le mouvement, des masses de piqueteros ignorent ces consignes, rompent avec la légalité qu’on veut leur imposer et refusent d’abandonner leurs méthodes de lutte : l’utilisation de la cagoule (élément que le mouvement avait affirmé comme aspect élémentaire de sécurité et de défense), le barrage total des routes et même la prise d’agences bancaires, de sièges du gouvernement continueront à se développer.
Durant ces mois décisifs de 2001, le capital poursuit l’application de mesures qui augmentent violemment la misère absolue et relative du prolétariat argentin dans son ensemble jusqu’à ce que se produise le corralito, véritable expropriation des épargnes au bénéfice du capital bancaire national et international[8]. Les assemblées et les piquets qui étaient déjà monnaie courante dans les provinces et le grand Buenos Aires, se généralisent à tous les quartiers de la capitale. Les assemblées de quartier, les cacerolazos, les escraches et les manifestations violentes contre les banques et les bâtiments publics de la capitale marquent un grand pas qualitatif qui mènera à des affrontements massifs, à la tentative de la part de l’Etat d’imposer l’état de siège, à la chute de plusieurs présidents. Le fait que des secteurs bourgeois et petits-bourgeois sont touchés par les mesures gouvernementales sera mis à profit par tous les partis bourgeois pour semer la confusion et tenter de liquider le caractère classiste du mouvement. Les gauchistes de tout bord diront que ce sont les petits-bourgeois qui sont dans la rue et des groupes qui se disent libertaires et/ou trotskistes en viendront à qualifier le moment le plus fort du mouvement de petit-bourgeois. Les théoriciens du pouvoir populaire, du fédéralisme, du « libertaire » et de la démocratie directe affirmeront publiquement que « la majorité de la population de la ville de Buenos Aires, berceau du phénomène en question (les assemblées de quartiers) appartient à la classe moyenne »[9] et malgré qu’ils ne puissent faire autrement que de reconnaître la coïncidence objective entre les assemblées de quartiers (qui, comme nous l’avons vu ont été la forme de base de l’organisation des piqueteros) et les piqueteros, ils feront tout pour accentuer les différences et attribuer des programmes réformistes à ce mouvement : « Une espèce de rapprochement commence à se dessiner entre le mouvement des assemblées et le mouvement piquetero qui est d’une autre extraction socio-économique et possède plus d’années de lutte et de résistance au modèle néolibéral tout en ne résistant pas au capitalisme dans sa globalité. »
Cette interprétation des classes moyennes et du fait que le mouvement pourrait avoir des objectifs différents de la lutte contre le capitalisme est répercutée et diffusée internationalement pour « expliquer » la généralisation du mouvement à toute la ville de Buenos Aires : « avant c’étaient les chômeurs, maintenant, ce sont les classes moyennes » récitent en chœur des centaines de publications de gauche comme de droite de par le monde.
Toutes ces idéologies, qui nient le prolétariat comme sujet unique s’affirmant sur base du seul projet révolutionnaire possible – la destruction de la société capitaliste –, appliquent la sociologie bourgeoise à deux sous qui divise le « peuple argentin » selon des critères statistiques et structuralistes. Il est clair que les quartiers du Grand Buenos Aires possèdent un nombre de marginaux, de chômeurs et d’exclus supérieur à celui de la Capitale Fédérale (la partie plus centrale de la ville délimitée par l’avenue General Paz) ; il est certain que le corralito n’a affecté qu’une minorité de prolétaires parce que la majorité n’avait pas d’économie en banque. Mais de là à considérer que ceux qui possèdent un compte en banque ou qui habitent dans les quartiers de la capitale sont des petits-bourgeois, il y a un abîme que seules les organisations ouvertement au service du maintien de l’ordre actuel peuvent franchir aussi allègrement. Le prolétariat n’est pas une classe sociologique qu’on peut comptabiliser dans des statistiques ou mesurer sur base d’indices de pauvreté absolue ou de marginalité. Le prolétariat est une force vive en opposition pratique et vitale à la propriété privée qui renaît dans sa révolte contre l’Etat, qui développe des piquets, organise des assemblées, descend dans les rues de tout le pays pour affronter les flics, les patrons, les syndicalistes, les politiciens,… Ayant compris la vieille manœuvre de ses ennemis pour le diviser, le prolétariat s’est emparé de la rue au cri de ¡Piquete y cacerola, la lucha es una sola!
Dans les faits, il n’y a jamais eu de différence entre assemblées et piquets. Au contraire, l’organisation des piqueteros utilise aussi les assemblées de quartier comme base organisative (quoique pas uniquement car la préparation des actions exige, pour des raisons de sécurité, des structures plus fermées, restreintes). La différence entre piquets et assemblées vient du fait qu’en décembre 2001 ces dernières apparaissent également dans les quartiers de la capitale, alors qu’avant cette date, on n’en trouvait que dans le Grand Buenos Aires. C’est à ce moment-là que s’enclenche une dynamique telle que dès que quelqu’un entend résonner un cacerolazo au coin de la rue, il s’y joint, ainsi que tous ceux qui jusque-là n’étaient que de simples voisins anonymes. C’est pour cela que les manifestations et les concentrations deviennent si nombreuses, si massives. La force des assemblées, c’est de rompre la sectorisation. On s’y réunit entre voisins pour tout organiser, de la survie quotidienne à la lutte. C’est ce qui fait qu’y participent chômeurs, travailleurs, pensionnés, étudiants, jeunes, vieux,… de chaque quartier. Les conditions elles-mêmes se chargent de démentir les catégories dans lesquelles la sociologie et les idéologues divisent le prolétariat. La situation de chacun est précaire, celui qui hier se considérait comme un travailleur sait qu’il danse sur une corde raide. Les assemblées agissent solidairement avec les travailleurs en lutte et avec les piqueteros ; certaines tentent d’organiser des organes de coordination entre les ouvriers des usines occupées et les piqueteros du quartier. Souvent, les assemblées occupent des locaux et parviennent à maintenir cette occupation en les utilisant pour se réunir, s’organiser, se divertir, échanger des informations, discuter des problèmes et des perspectives politiques et, en ce sens, constituent une affirmation de la communauté de lutte contre l’Etat.
Comme c’est le cas pour tout phénomène faisant preuve d’une massivité aussi grande, après la rébellion généralisée de décembre 2001, simultanément à l’affaiblissement de la dynamique du cacerolazo, les assemblées perdent de leur force. Ceci dit, il faut souligner que, dans de nombreux quartiers, des structures organisatives se maintiennent, et qu’il y a des tentatives de coordination d’assemblées de quartier telle, par exemple, l’assemblée inter-quartiers de Centenario. Dominée (il ne pouvait en être autrement) par l’idéologie de l’horizontalité et de l’anti-direction, cette dernière s’est en fait révélée incapable de prendre une décision et s’est trouvée paralysée par le bureaucratisme. C’est pourquoi elle s’est affaiblie en tant que point de référence.
Le fonctionnement et les objectifs des assemblées sont différents selon les quartiers. Nombreuses sont celles qui, comme ce fut le cas de multiples soviets en Russie, ne sont rien de plus qu’une forme d’assistance, quasi mutualiste, nécessaire pour organiser la survie dans ce système de merde. Mais d’autres, en plus d’affirmer la solidarité et l’action directe afin d’obtenir les moyens nécessaires à la survie (ce qui comprend un grand nombre d’actes de force et de lutte, actes illégaux comme se raccorder clandestinement aux services publics, à l’eau, au gaz, à l’électricité coupés pour défaut de payement), vont bien plus loin et posent explicitement l’unité du prolétariat et la lutte contre l’Etat. Même le journal La Nación a vu la similitude et comparé les assemblées aux « sombres et funestes soviets » en Russie.
Ce qui est certain, c’est que la généralisation du phénomène des assemblées a été et reste d’une importance telle que leur composition sociale ne pouvait être qu’hétérogène et embrasser, sociologiquement parlant, des secteurs de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie en cours de prolétarisation. Mais cela a été et restera une constante de l’associationnisme prolétarien qui s’organise pour affronter la catastrophe que le capital implique. Toutes les couches de la société touchées par la détérioration violente des conditions de vie auront tendance à se joindre aux associations prolétariennes qui se posent comme seule alternative au capitalisme et à agir de façon suiviste vis-à-vis d’elles. Ce phénomène, comme tel, ne pose aucun problème à la révolution. Au contraire, si le prolétariat agit comme classe, comme force historique autonome affirmant son propre projet social, ces couches en processus de prolétarisation auront, en fonction de ce processus, à se plier à la lutte prolétarienne. C’est la seule alternative qu’elles aient pour affronter le capital et, par ailleurs, c’est seulement avec le prolétariat qu’elles peuvent affirmer un projet social alternatif. De son côté, le prolétariat affirme ainsi sa tendance historique à assumer les intérêts de toute l’humanité, tendance qui inclut, il ne faut pas l’oublier, son autodissolution comme classe. C’est pourquoi, il est logique que les assemblées aient suivi les piqueteros, coordonnant leurs actions avec les leurs, imitant leurs méthodes. Le danger ne vient pas de la présence d’individus bourgeois ou petits-bourgeois dans les associations prolétariennes mais de la pratique contradictoire de ces assemblées, de la lutte interne qui s’y déroule, du programme politique et social de ces associations qui, souvent, est étranger au prolétariat. En effet, même si l’on expulsait réellement toutes les personnes sociologiquement bourgeoises ou petites-bourgeoises (ce qui n’aurait aucun sens), la bourgeoisie continuerait à être présente. Si aujourd’hui, nous devons dire que la bourgeoisie est présente dans les assemblées de Buenos Aires, c’est du fait des positions existantes en leur sein ; si aujourd’hui, on peut parler de bourgeois ou d’agents de la bourgeoisie dans les assemblées, ce n’est pas parce que telle personne ou telle autre appartient à la « classe moyenne » mais bien souvent par les positions bourgeoises assumées pratiquement. En ce sens, ce qui, aujourd’hui encore, pèse le plus contre l’autonomie prolétarienne demeure ce que beaucoup de ces prolétaires font et pensent. Parce que, que cela nous plaise ou non, l’idéologie de la classe dominante continue d’être l’idéologie dominante, y compris parmi les prolétaires, et pas seulement à Buenos Aires, pas seulement en Argentine, mais dans le monde entier. Autrement, comment expliquer que cet associationnisme classiste brandisse des drapeaux totalement étrangers au prolétariat, comment expliquer qu’il dresse de répugnants symboles patriotiques, qu’il chante l’hymne national argentin et que le seul drapeau autorisé soit le drapeau national ?
Thèse d’orientation programmatique n°15 – GCI
En ce sens, il est indubitable qu’il existe des secteurs du prolétariat importants stratégiquement, du fait de leur capacité à paralyser les centres décisifs d’accumulation du capital (pôle d’accumulation capitaliste, grandes industries, mines, transports, communications, etc.). Ces secteurs ne sont pas nécessairement toujours les plus décidés, ni ceux qui garantissent (le plus) la généralisation de la révolution. Il existe également d’autres secteurs comme les « sans-travail » et, en général ou particulièrement, les jeunes prolétaires qui n’ont pas encore trouvé (ou qui savent qu’ils ne trouveront pas) d’acheteur de leur force de travail (secteurs camouflés de nombreuses fois sous la dénomination aclassiste de « jeunes », « d’étudiants » ou de « lycéens »). Ces secteurs peuvent jouer un rôle décisif dans le fait de donner un saut de qualité du mouvement. Le développement de la révolution communiste implique toujours la rupture d’avec le cadre borné de l’entreprise par la descente dans et l’occupation de la rue, par la généralisation effective de la lutte, par le passage à l’associationnisme territorial contre lequel la bourgeoisie ne peut plus offrir de réformes ni partielles, ni catégorielles et qui pose forcément la question générale du pouvoir de la société. Mais cette formidable énergie révolutionnaire ne constitue une force dans le sens historique du terme, que si elle s’organise en parti centralisé (sans cela, cette énergie sera dilapidée, balayée, voire même retournée par la contre-révolution). Mais ce mouvement ne peut se constituer en parti centralisé sans affirmer un programme intégralement communiste et sans se doter d’une direction pleinement révolutionnaire. Et, à leur tour, programme et direction communistes ne sont pas le résultat immédiat du mouvement, même si celui-ci est vaste et puissant, mais bien le résultat de toute l’expérience antérieure accumulée et transformée en force vive, en organe de direction du parti et de la révolution par une longue et dure lutte historique, consciente et volontaire, assurée par les fractions communistes.
5/ L’autonomie prolétarienne et ses limites
L’autonomie prolétarienne vis-à-vis de toutes les forces bourgeoises, sa constitution en classe et donc en parti distinct est la clé de la révolution sociale. L’associationnisme généralisé du prolétariat en Argentine est sans aucun doute une affirmation naissante de cette autonomisation. Le fait que cet associationnisme se soit maintes fois organisé en dehors et contre les organisations institutionnelles de tout type est une affirmation de l’autonomie du prolétariat dans la région. L’action directe, l’organisation en force contre la légalité bourgeoise, l’action sans médiation ni intermédiaire, les consignes contre les syndicats, les partis, les politiciens, l’affrontement organisé aux forces répressives, l’action de minorités organiques durant ces affrontements, l’attaque de la propriété privée, l’expropriation, les escraches, les piquets… sont d’extraordinaires affirmations de cette tendance du prolétariat à se constituer en force destructrice de tout l’ordre établi.
Au cours de ce processus d’affirmation comme classe, le prolétariat se dote de structures massives d’association comme les assemblées de quartier. Celles-ci, à leur tour, ont été précédées, rendues possibles et engendrées par des structures ayant une plus grande permanence et une plus grande organisation : celles des piqueteros telles que décrites ci-dessus et d’autres structures qui, depuis des années, luttent contre l’impunité des bourreaux et des assassins de l’Etat argentin (Mères de la Place de Mai, Hijos,…), celles des associations de travailleurs en lutte (usines occupées) ou celui du mouvement des pensionnés. La corrélation entre les différents types de structures, la continuité relative de certaines d’entre elles et les formes d’action directe qu’elles ont adoptées ont permis cette affirmation de l’autonomie du prolétariat en Argentine et constituent un exemple qui tend à s’étendre à l’Amérique et au monde : piquets, escraches, pillage organisé et organisation du quartier autour d’une énorme marmite afin que tous aient à manger chaque jour,… Cependant, ce mouvement comporte d’énormes limites et faiblesses qu’il est indispensable de clarifier.
Quelle est la direction du mouvement ? Quels sont les programmes, les drapeaux, les forces politiques qui impriment la direction à cette force prolétarienne ? La première chose qui frappe à ce sujet, c’est le déphasage entre la force exprimée par le prolétariat et l’absence d’objectif explicite, entre l’autonomie manifestée dans la rue et le peu d’incidence de positions clairement révolutionnaires qui crient haut et fort que la seule solution est la destruction de la société marchande et de l’Etat. Il est clair que ce déphasage est mondial, comme nous l’avons déjà constaté maintes fois mais dans le développement du mouvement actuel en Argentine il nous semble plus grand encore.
Le manque de direction révolutionnaire est évident. Direction non pas dans le sens de suivre tel ou tel individu. Au contraire. C’est le manque de direction révolutionnaire réelle qui fait que l’on est suiviste de tel ou tel chef populaire. Direction, donc, dans le sens historique d’assumer ouvertement ce que le mouvement contient déjà. L’affirmation que le prolétariat effectue pratiquement en s’opposant ouvertement à la société marchande et à l’Etat ne parvient pas à se structurer en consignes clairement révolutionnaires pour la destruction du capitalisme.
Tout au contraire, il y a très peu de consignes réellement radicales, c’est-à-dire allant à la racine de tous les problèmes : la société marchande. Très peu de groupes ou de militants expriment la tendance historique révolutionnaire vers la nécessaire et indispensable destruction des fondements de cette société. Nous sommes donc forcés de constater que, dans cette région, la rupture historique du prolétariat avec son passé de lutte est profonde. C’est comme si les positions prolétariennes de toujours brillaient par leur absence. Ce qui prédomine dans le mouvement du prolétariat, en fait, ce sont des directions politicistes/gestionnistes qui s’opposent pratiquement à une issue révolutionnaire : les uns essayant de pousser le mouvement vers l’institutionnalisation, la négociation avec l’Etat, le réformisme politique en général (le plus souvent en dressant le vieux drapeau bourgeois de l’Assemblée Constituante) et/ou vers le néosyndicalisme ; les autres poussant le mouvement vers l’autogestion, l’entreprise alternative, le soi-disant contre-pouvoir et la démocratie directe. Ces deux politiques s’opposent à l’insurrection, à la dictature révolutionnaire du prolétariat pour abolir le travail salarié qui est non pas une possibilité parmi d’autres mais l’unique issue possible.
L’absence de groupes révolutionnaires, de minorités poussant ouvertement le mouvement vers la révolution sociale a pesé lourd dans les moments décisifs de décembre 2001. La crise de la classe dominante était totale, le prolétariat imprima sa violence de classe même contre l’état de siège, ce qui précipita tous les changements au sein du pouvoir bourgeois. Mais dans cette situation de pouvoir social, le prolétariat resta paralysé comme s’il n’avait pas de projet révolutionnaire, ce qui revint à laisser l’initiative à la bourgeoisie. Celle-ci, tout en ne sachant trop que faire, elle non plus, savait au moins changer de tête pour que tout reste tel quel.
Nous ne sommes pas en train de dire que les conditions d’une victoire révolutionnaire étaient réunies, ce qui serait utopique sans préparation sociale à perspective insurrectionnelle. Ce que nous disons c’est que les conditions étaient au moins réunies pour imposer un rapport de force qui corresponde à cette extraordinaire consigne mise en avant par le prolétariat : Que se vayan todos, que no quede uno solo (« Qu’ils s’en aillent tous, qu’il n’en reste plus un seul »). Des conditions qui auraient pu empêcher que la bourgeoisie reconstitue aussi aisément sa domination, qui auraient permis de garder le rapport de force conquis dans la rue et d’empêcher que la bourgeoisie reprenne l’initiative de la réorganisation politique et finisse par imposer n’importe qui, tel Duhalde qui figurait pourtant en tête de la liste de ceux qui, toujours selon le même mot d’ordre, devaient s’en aller.
Aucune des organisations et des publications qui avaient du poids dans le mouvement n’a donné de consignes aux perspectives révolutionnaires, aucune n’a placé au centre de sa pratique la véritable révolution sociale. Aucune des positions ouvertement révolutionnaires existantes n’est parvenue à s’affirmer comme force sociale afin que la nécessité de l’insurrection et de la destruction violente de l’ensemble de la société marchande soient vues pour ce qu’elles sont : l’unique alternative. A part quelques camarades tout à fait isolés, personne n’a dénoncé les fausses solutions et expectatives suscitées par le gestionnisme évident dans lequel, parallèlement à la solution bourgeoise de la crise, les assemblées et une grande partie du mouvement piquetero sont tombés.
L’idéologie dominante, celle de la classe dominante, présente dans tout le mouvement, en a profondément limité la force. Au début de ce texte, nous signalions comme élément positif le fait que le mouvement ait interdit la participation de tout type d’institutions dans ses actions et démonstrations de force, qu’aucun syndicat, parti ou autre institution n’ait pu venir avec ses drapeaux, nous devons ajouter maintenant un élément extrêmement négatif : le seul drapeau autorisé fut le drapeau argentin. Et, malheureusement, il ne s’agit pas d’un simple drapeau, il ne s’agit pas d’un petit détail de l’histoire. La présence de ce drapeau est le reflet d’un manque évident de rupture avec le nationalisme, avec le patriotisme, avec le populisme, avec le péronisme,…
Même parmi les protagonistes les plus décidés du mouvement, certains parlaient de la ruine de « notre économie » de la « recherche d’une issue pour le pays », d’autres affirmaient que les politiciens « sont des vendeurs-de-patrie »[10], comme s’il s’agissait d’un problème de nation et pas de classe, comme si c’était uniquement l’Argentine qui sombrait et pas la société marchande toute entière. L’« anti-impérialisme » conçu comme affirmation nationale de l’argentinisme antiyankee a joué le même rôle bourgeois : lutter pour la liquidation de l’autonomie du prolétariat. Et il y a plus, en différentes occasions et dans de nombreuses manifestations, ce n’est pas contre la patrie ou pour l’internationalisme prolétarien que les chants s’élevaient, c’était (trotskistes en tête) l’hymne national qu’on entonnait. Voilà qui dénote une brutale rupture avec la trajectoire internationaliste du prolétariat dans la région tant lors des luttes de la vague 1968-1973 que lors de celles de la vague 1917-1923 ou lors des luttes du 19ème siècle.
Des dénonciations et des ruptures se sont bien sûr également exprimées. Nous reprenons ici, à titre d’exemple quelques lignes parues sur internet et qui s’insurgent contre le populisme, le péronisme, les Montoneros et autres genres de nationalisme.
Quelques extraits parus sur le site d’Indymedia et signés Burrito
Cette terminologie est stalino-péroniste, elle est utilisée indistinctement par le populisme de droite comme de gauche. Les anarchistes ne différencient pas l’oligarchie des bourgeois que vous ne nommez pas. Les anarchistes dénoncent tous les capitalistes. Est-ce que par hasard vous l’auriez oublié ? Ou y aurait-il des différences entre eux ?
Les anarchistes ne dénoncent pas les « entreguistas » (ceux qui vendent la patrie aux étrangers, à l’impérialisme, au FMI,…) mais bien les moutons, les ouvriers séduits par le patron. « Entreguista » a une autre connotation ; ce terme est associé au populisme. Vous ne vous en êtes pas rendu compte ?
Et pour finir « vendeurs-de-patrie » : je me sens mal à l’idée de devoir expliquer cette absurdité et, pour comble, à quelqu’un qui se dit anarchiste. Les ouvriers n’ont pas de patrie : où qu’ils aillent, ils continueront d’être des ouvriers/exploités et ils ne peuvent défendre ce qui ne leur appartient pas. Le capitaliste s’installe là où il tire des profits ; par conséquent, le capital n’a pas de patrie et la lutte contre lui non plus : cela c’est l’internationalisme, une valeur précieuse de l’anarchisme. Vendeurs-de-patrie ? Vendre quelque chose qui n’a de valeur ni pour les uns ni pour les autres est un contresens. Messieurs, vous qui vous dites anarchistes ! De plus, être patriote c’est être assassin !
26 décembre 2001
Cette fois, je ne vais pas répondre à ta « conception » de l’anarchisme. Tu as déjà tout dit dans la première note avec les termes vendeurs-de-patrie, oligarchie,… Tes dernières opinions confirment la gravité et la crise de la pensée sociale la plus élémentaire, et le gaspillage discursif de cette farce philo-péroniste qui se dit anarchiste ; en disant « ce peuple qui lutte et meurt dans la rue comme le firent 25.000 Montoneros ».
[…] Pour ton information, les Montoneros ont été méprisés même par Perón « à cause de ces stupides imberbes qui croient avoir plus de droits que ceux qui ont lutté pendant vingt ans dans le mouvement syndical » – 1974.
Tu as oublié que Firmenich[11] et toute cette clique dénonça, moucharda et aujourd’hui se la coule douce ? Si tu crois qu’il y a des valeurs positives dans le sentiment populaire à l’égard d’Evita et de la vierge Marie et que cette fusion réveille des réactions anti-impérialistes pourquoi n’entres tu pas au PJ ou, pour être plus révolutionnaire, au PCR et pourquoi ne cesses-tu pas de t’appeler anarchiste ? Quel est l’objectif, maintenant ? Tenter de s’infiltrer une fois de plus auprès des Mères, déguisé en anarchiste ? Vous n’avez pas honte ? C’est ce que faisaient des types comme Astiz. Comment pouvez-vous être tombés si bas ? »
Nous désirons également souligner le fait que, par endroits, grâce à des camarades, un anti-hymne argentin, une vieille chanson qui oppose à tous les chants patriotiques la lutte à mort contre le capitalisme, l’anarchie[12], réapparaît et que, cette chanson, les militants prolétariens de la FORA communiste l’ont chantée pendant de nombreuses années.
Hymne non-national
Contre le patriotique hymne national argentin que la bourgeoisie a tout intérêt à ce que les ouvriers continuent à chanter car, ce faisant, ils font l’éloge de leur propre exploitation, ressurgit cet hymne internationaliste à la révolution sociale et à l’anarchie. Composé par des prolétaires au début du 20ème siècle (sur le même air que l’autre), cet hymne internationaliste a été chanté lors des grandes luttes et manifestations prolétariennes de l’époque. En voici la traduction française :
Vive, vive l’anarchie !
Ne plus souffrir le joug,
couronnés de gloire nous vivrons
ou avec gloire de mourir nous jurons.
Ecoutez mortels le cri sacré
d’anarchie et de solidarité
Ecoutez le bruit des bombes qui explosent
pour défendre la liberté.
L’ouvrier qui souffre proclame
l’anarchie pour le monde tout entier,
couronne sa tempe de lauriers
et à ses pieds, le bourgeois vaincu
La gloire des nouveaux martyrs
leurs bourreaux osent l’envier,
la grandeur a logé dans leur poitrine
leurs paroles ont fait trembler.
Aux pleurs de l’enfant qui crie :
« donne-moi du pain, donne-moi du pain, donne-moi du pain »
la Terre répond en tremblant,
le volcan crache sa lave.
« Guerre à mort » crient les ouvriers
guerre à mort à l’infâme bourgeois
« Guerre à mort » répètent les héros de Chicago, Paris et Jerez.
D’un pôle à l’autre résonne ce cri
qui terrorise le bourgeois
Et les enfants répètent en chœur « Notre patrie, bourgeois, c’est la Terre ».
Cependant la prépondérance idéologique du populisme continue à peser sur le mouvement et ce qui prédomine est, sans aucun doute, cet hymne à la patrie, à la soumission du prolétariat qu’est l’hymne national. Il est vraiment désolant que sur le plan de la continuité historique, on évoque le Cordobazo, la « semaine tragique » de 1919 (nous préférons l’appeler semaine insurrectionnelle) mais que, dans la pratique, on continue à tellement peu affirmer l’internationalisme prolétarien, l’antipatriotisme qui a constitué l’alpha et l’oméga de la lutte historique du prolétariat tant au 19ème qu’au 20ème siècle. Le prolétariat qui vit actuellement en Argentine est originaire de dizaines de pays différents et dans tous les mouvements de lutte importants, il s’est ouvertement affronté au nationalisme argentin, à l’argentinisme et à ses valeurs. Par contre, ceux qui ont le plus affirmé l’idée de patrie en Argentine, les bourgeois et leurs exécutants, les militaires (y compris Perón), sont ceux qui réalisèrent les plus grands massacres de l’histoire. Les escadrons de la mort, les bandes de voyous des syndicats et autres organisations para-policières ont des antécédents historiques indiscutables dans la Ligue Patriotique Argentine[13].
« Le mois passé, on a fêté trois fêtes patriotiques ! Il y a eu profusion de drapeaux, cocardes, fêtes nocturnes, bals, soûleries,… Cela semble incroyable que dans nos rangs il y ait des camarades qui appuient si sottement ces fêtes ! Adieu drapeau rouge brandi le premier mai !… Qui sont les promoteurs de ces fêtes ? Quelques commerçants qui achètent et vendent des produits partout dans le monde en concurrence avec ceux de leur patrie et pour qui, de fait, la patrie c’est le profit commercial. Un banquier qui spécule dans toutes les bourses du monde, qui se livre à l’agiotage sur toutes les places boursières, de fait, sa patrie c’est l’argent. Un fermier qui emploie des ouvriers de n’importe quelle nationalité (ceux qui lui coûtent le moins cher et qui travaillent le plus) de fait, leurs compatriotes sont les bêtes de somme les plus rentables et les moins chers…
Quand comprendrons-nous, nous prolétaires, qui n’avons ni terre, ni bien, ni rien de matériel qui nous retienne en un lieu plutôt qu’en un autre, que l’idée confuse de patrie n’a pour nous aucun intérêt ? Quand nous rendrons-nous compte, nous les bêtes de somme, que la patrie est parfaitement conforme à et est fomentée par les privilèges de la caste bourgeoise ? »
Fédération Ouvrière de Rio Gallegos (1921)
En plus du populisme et du nationalisme toujours présents qui constituent des forces contre la révolution, il faut également signaler d’autres idéologies complémentaires, comme les tendances à légaliser le mouvement, à officialiser ses représentants, à formuler des revendications positives au sein du capitalisme et clairement entendables par les fractions bourgeoises au pouvoir, en fin de compte, à transformer cette force prolétarienne qui s’exprime dans la rue en une force institutionnalisée et intégrée par l’intermédiaire de ses représentants comme institution d’Etat. Font partie de cette tendance contre-révolutionnaire toutes les tentatives pour transformer le mouvement piquetero et d’assemblées en nouveaux syndicats mais aussi, celles qui cherchent à en faire une forme d’appui à l’action politique de parti, y compris l’action électorale et, en particulier, celles qui arborent la consigne de la gauche bourgeoise d’« Assemblée Constituante ». Il est très important de dénoncer cette option bourgeoise (comme le font les Juventudes Libertarias en Bolivie) parce que cette consigne a déjà joué son rôle néfaste en bien des endroits et à bien des époques et parce que, aujourd’hui même, cela se reproduit non seulement en Argentine mais dans d’autres pays de la région.
La Constituante : pirouette réformiste
Partout on parle de l’assemblée constituante ; téteurs de mamelles, profiteurs et opportunistes disent qu’elle résoudra tous nos problèmes ; on déverse une propagande mystificatrice qui cache les réels problèmes, au jour le jour, de la libération de la classe travailleuse du joug patronal capitaliste. Ce qui est sûr, c’est que le monde est divisé en deux classes : la classe des exploiteurs (bourgeoisie) et la classe des exploités (prolétariat). Le régime économique, le capitalisme, fonctionne sur base de l’obtention du plus grand profit possible ; pour cela, les bourgeois exploitent le prolétariat avec pour unique fin d’obtenir un profit supérieur. L’Etat est la structure qui a pour objectif la protection des intérêts de la classe dominante et le maintien des rapports de domination dans lesquels les capitalistes vivent du travail non payé au prolétariat. C’est pourquoi les intérêts de ces classes sont totalement opposés. Par conséquent, croire qu’un espace de dialogue entre les deux classes permettrait d’en finir avec l’exploitation et l’oppression est une niaiserie ! C’est impossible ! Les bourgeois cesseraient d’être riches et cela, comme ça, de leur plein gré, cela ne se passera jamais. Alors pourquoi tant de vacarme, ici, il y a anguille sous roche… La vérité, c’est que l’on prétend changer le champ de bataille, des usines, des champs et de la rue en pompeuses assemblées où les enfarinés du syndicalisme réformiste et les petits docteurs de la bourgeoisie, tous laquais du capital/Etat, parlent au nom des travailleurs à ceux qui ont toujours désiré avoir des exploités pour en tirer profit. On prétend substituer à la lutte de classe réelle, violente dans les rues, les braillements des délégués constitutionnalistes. Les capitalistes veulent avoir des assemblées, des parlements qui abrutissent le prolétariat de l’idée que ses problèmes puissent être résolus au sein des institutions bourgeoises. L’appel à une assemblée consistante dévie les travailleurs de leurs véritables moyens de lutte, elle les dupe en prétendant que la transformation de la société peut être réalisée sur les bases de la société capitaliste. Elle alimente la passivité des masses qui se fient à la capacité des chefs. Elle sème la confusion à un moment où la lutte se cimente en un mouvement direct des masses. Si le prolétariat renonce à ses objectifs, affirmant ceux de ses oppresseurs, il se nie comme classe, il s’exclut en tant que (la seule chose qu’il puisse être) force antagonique à l’ordre existant en se dissolvant dans le citoyen. Monter sur le char de la constituante, c’est légitimer la dictature du capital, c’est-à-dire la démocratie qui, voilée sous des formules trompeuses de libertés politiques et de garanties démocratiques fictives, sert de cheval de Troie pour amadouer le prolétariat et river les chaînes de l’esclavage.
Juventudes Libertarias, 16 juin 2002
Il ne faut pas oublier que tous ces points (nationalisme, populisme, argentinisme « anti-impérialiste », institutionnalisation, assemblée constituante,…), bien que ce soient des idéologies au sein du mouvement du prolétariat, représentent les intérêts de la bourgeoisie. Ce sont des expressions, des consignes et des directives qui constituent objectivement un frein à et un dévoiement de ce que le prolétariat a pratiquement affirmé de plus important : son opposition pratique, ouverte et irrémédiable à la propriété privée et à l’Etat.
6/ Le gestionnisme contre la révolution
Cependant, tandis que la rupture avec ces idéologies politicistes continue de s’opérer du fait de la réelle incapacité des fractions du capital dans leur ensemble à apporter quelque solution immédiate que ce soit, le mouvement, ne parvenant pas à adopter une direction révolutionnaire, s’embourbe de plus en plus dans toutes les formes de gestionnisme, d’alternatives productivistes. La crise de la gauche bourgeoise politique et syndicale, péroniste et gauchiste, la pousse à opérer une transformation « libertaire » qui coïncide avec la mode et à développer une idéologie alternativiste pour attirer le prolétariat en lutte.
Dans un contexte de chaos généralisé comme en Argentine où la situation matérielle est chaque jour plus insupportable pour un nombre croissant de personnes, la nécessité de survivre pousse tout le monde à s’arranger de mille façons : pillages, occupations de locaux et/ou d’usines, récupérations, combines en tout genre, artisanats, trafics, falsifications, changes,… Personne et nous moins que quiconque, ne pourra juger ou condamner ces procédés de survie, de lutte contre la faim que notre classe invente pour affronter les conditions que lui impose la société marchande. Dans la gestion immédiate de la survie et sous la dictature du capital, tout ce qui se fait contre la loi de la propriété privée et l’Etat bourgeois est fondé, légitime et, que les protagonistes en soient conscients ou non, exprime l’opposition totale et irrémédiable entre les besoins humains et la société basée sur la propriété privée.
Le problème surgit quand des mécanismes de survie dont l’occupation nécessaire de moyens de production réalisée dans la lutte prolétarienne sont idéalisés comme s’ils constituaient une solution de rechange à la société actuelle, comme s’ils pouvaient opérer un changement social sans la nécessaire rupture révolutionnaire, comme si on pouvait « communiser » le monde sans détruire despotiquement la société marchande. L’illusion d’améliorer peu à peu une société qu’il faut détruire joue un rôle contre-révolutionnaire important, quelle que soit la façon dont elle s’exprime. Dans les moments de crise sociale et politique, ces idéologies ont pour fonction de paralyser le potentiel révolutionnaire du prolétariat et empêchent l’insurrection. Plusieurs fois dans l’histoire, l’idéologie gestionniste anti-insurrectionnelle a transformé les occupations d’usines et des moyens de production en général en « contrôle ouvrier », « autogestion », « collectivisation », « socialisation »,… et autres innombrables dénominations qui ont toutes comme point commun de faire l’apologie de l’abandon de la lutte contre l’Etat au profit du travail et de la gestion productive. C’est ce qui s’est passé en Espagne avec les collectivisations en 1936-1939. La perte de perspective révolutionnaire du prolétariat qui en résulte se transforme invariablement en force contre-révolutionnaire et se conclut par la liquidation politique et physique du prolétariat organisé. En effet, pour la bourgeoisie, dans des circonstances de crise politique et sociale profonde où l’insurrection est à l’ordre du jour, il est extrêmement positif que, plutôt que d’attaquer son pouvoir social et politique, le prolétariat investisse toute son énergie dans la production et la gestion économique ; non seulement parce que la bourgeoisie peut dès lors se réorganiser pour liquider le prolétariat ensuite mais aussi parce que le capital lui-même est maintenu en bon état de fonctionnement par un prolétariat qui croit qu’il produit pour ses propres intérêts. Comme la bourgeoisie sait parfaitement tout cela, il est normal que toutes les pseudo-alternatives qui se sont développées en Argentine et que nous pourrions résumer par la recherche d’une autre gestion ou d’autres formes d’échanges sans détruire le capital, aient été idéalisées et propagées par des secteurs bourgeois dans le monde entier. Ainsi le modèle gestionniste que le sous-commandant Marcos avait remis à la mode il y a quelques années et qui souffrait d’usure notoire reprend un nouvel essor au niveau international grâce à l’exemple argentin et à la publicité faite par les secteurs bourgeois alternativistes.
Echange des produits, échange de travail, commerce alternatif,… Face au désapprovisionnement des commerces et au manque d’argent, beaucoup de familles ouvrières se sont intégrées dans un réseau de troc ou d’échange de produits. En Argentine, il y a plus de trois millions de personnes qui utilisent occasionnellement ou régulièrement ce procédé. Pour les raisons que nous invoquions plus haut, il est normal que cette soi-disant alternative soit l’objet de louanges de la part des progressistes du monde entier. Chaque produit est évalué en créditos. Le crédito équivaut à la moitié d’un peso. On échange aussi des services sur le plan du travail : j’arrange les vélos, tu répares les frigos… Il est clair que pour beaucoup, ce système permet de trouver des choses moins chères ou d’obtenir ce dont ils ont besoin en échange de quelques petits travaux. La supercherie, c’est qu’en Argentine aussi on a imaginé et fait la propagande de cela comme s’il s’agissait d’un projet social différent alors qu’en réalité cet échange généralisé tend irrémédiablement vers la loi de la valeur qui existe dans toute la société bourgeoise. C’est-à-dire qu’indépendamment des illusions qui peuvent naître au sein du prolétariat, sur ce marché toutes les lois du capitalisme tendent nécessairement à se vérifier. Ces lois sont fondamentalement contenues dans l’échange marchand lui-même, y compris sous sa forme la plus simple, le troc. L’échange d’un objet, d’un service, d’un travail,… contre un autre ne peut se réaliser que sur la base du travail qui s’objectivise en lui et ce rapport d’échange contient dans son développement toute la barbarie de la société actuelle, comme (il faut le rappeler) le démontra Marx contre Proudhon. Toute illusion sur le fait que cet « échange alternatif » puisse être différent du capitalisme ou qu’au moins il développerait des rapports « moins inhumains » joue un rôle réactionnaire. En Argentine, on constate déjà que le prix en créditos de la plupart des produits est supérieur à celui qui existe dans les commerces, que cette unité de compte se dévalue également, que dans ce commerce soi-disant alternatif se développent déjà toutes sortes d’escroqueries, de maffias, que les grands mangent les petits, etc. Malgré cela, l’idéologie qui défend que grâce à ce commerce alternatif et à la production alternative on peut changer la société continue de peser.
Le même problème se pose lors des prises d’usines et de ce qu’on appelle l’autogestion. Prendre une usine est un acte qui signifie s’affronter au patron et attaquer la propriété privée. La généralisation de ce processus est un bon point de départ pour opposer la force prolétarienne à la force de la bourgeoisie coalisée. Quand, en plus, on expulse les patrons, quand on utilise les outils de travail (souvent en en changeant l’usage et la destination) pour produire les objets nécessaires à la subsistance et/ou quand on met ces outils de production au service du mouvement, quand on occupe des usines d’aliments, d’objets utiles, des imprimeries, des journaux comme cela s’est passé dans certains cas à Buenos Aires et dans certaines capitales de provinces), on affirme son opposition à toute la société bourgeoise. Mais si les prolétaires se convertissent en gestionnaires de ces entreprises (toutes coopératives horizontales et équitables qu’elles soient), certains finiront nécessairement par soutenir le capital et l’Etat parce que l’existence de cette entreprise dépend obligatoirement de sa rentabilité et celle-ci du taux d’exploitation. Le capital et l’Etat, loin de s’affaiblir du fait que ces entreprises soient « contrôlées par les ouvriers » ou « collectivisées » se renforce encore plus, vu que la lutte cesse d’être une lutte pour la destruction du travail salarié et de la société marchande et que l’énergie révolutionnaire est canalisée vers la production et l’échange de marchandises. Même dans le cas extrême où la propriété privée juridique cesse d’exister, les rapports sociaux entre les entreprises collectivisées continuent à être des rapports marchands et toutes les lois de la société capitaliste continuent à régir les rapports entre les hommes. Pour abolir la propriété privée réellement et pas formellement et/ou juridiquement, il faut abolir également la gestion d’entreprise et l’entreprise elle-même. Sans cela, la société continuera à décider quoi produire et qui le produira en fonction du marché, c’est-à-dire des lois du capitalisme. La décision autonome de chaque unité productive qui fait que la production ne « devient sociale » qu’a posteriori, par l’intermédiaire du marché et de ses lois (en opposition aux besoins de l’humanité) est la clé du capitalisme. Seule la destruction de cette autonomie et de cette indifférence de chaque unité productive et la soumission de toutes les unités aux impératifs humains rendra la production directement sociale (destruction de la dictature de la loi de la valeur) et fera de la société une association libre de producteurs associés, base de la communauté humaine.
Chaque fois qu’on occupe un lieu et qu’on commence à travailler se pose cette alternative entre généralisation et approfondissement de la lutte ou paralysation de celle-ci sur base de l’illusion productiviste, gestionniste. Durant le processus d’affirmation du prolétariat de 2001-2002, il y eut plusieurs cas importants d’entreprises occupées et réouvertes par les ouvriers en lutte où cette alternative s’est posée.
Citons quelques exemples d’occupations qui se distinguent par leur radicalité : Zanón (à Neuquén qui, alors que nous mettions cet article sous presse en espagnol –novembre 2002– en était à son dixième mois d’occupation), Bruckman (à Buenos Aires), Perfil,… Il y a aussi des cas où l’occupation et la mise en fonctionnement de l’usine est directement une mesure de lutte, d’affirmation de la camaraderie. A Azul, après l’occupation, les travailleurs ont réussi à réouvrir une usine de céramiques et à faire réintégrer les camarades licenciés. A Fricader (Rio Negro), on impose la coopérative après la fermeture du chantier. A Chilavert (Buenos Aires), les travailleurs impriment un livre nécessaire au mouvement des assemblées.
Pourtant, s’il y a des occupations qui affirment le mouvement, dans bien des cas les occupations d’usines et le fait qu’on y travaille de façon « autogérée » s’articulent et se confondent avec les projets de commerce alternatif entre groupes et marchés « parallèles » ou de troc. Dans chaque usine, l’illusion qu’il s’agit d’une solution entraîne les ouvriers à se contenter de ces alternatives partielles qui poussent à l’isolement et qui, dans les faits, s’opposent à la seule solution : la généralisation de la lutte, l’organisation contre le capital et l’Etat.
Un cas similaire s’est produit avec le mouvement des piqueteros et les « triomphes immédiats ». Couper les routes et imposer un Plan Trabajar est un acte de classe dans la mesure où on arrache au capital des allocations qui permettent de subsister. Mais ce résultat est éphémère et tend à être liquidé par l’évolution économique elle-même. Ce qui reste, en fait, c’est l’organisation et la solidarité croissante de ce mouvement social. Dans la mesure où les alternatives bourgeoises sont de moins en moins capables de résoudre les problèmes immédiats des gens, le mouvement se généralise et on ne peut plus l’enfermer comme si ce n’était qu’un mouvement purement économique. Toute lutte prolétarienne réelle, même si elle se déclenche du fait de besoins immédiats, tend nécessairement à s’opposer à tout le fonctionnement du capital et de l’Etat, comme cela se passe pour le mouvement piquetero. Le développement de ce dernier le pousse à la généralisation et, comme on l’a vu, à s’unifier avec le reste des luttes prolétariennes qui, à leur tour, tendent vers une solution unique : l’insurrection, la révolution sociale. Contre cela, en Argentine comme dans le reste du monde, un ensemble d’alternatives gestionnistes, basées sur l’illusion d’une économie alternative, et qui s’opposent explicitement à cette seule solution possible qu’est l’insurrection prolétarienne, sont devenues à la mode.
Dans les discussions, tant dans les assemblées que dans le mouvement piquetero, nous constatons avec grande inquiétude le poids croissant de cette idéologie que nous devons combattre. A titre d’exemple, prenons l’idéologie qui s’exprime publiquement au nom du Movimiento de los Trabajadores Desocupados – MTD Solano (Mouvement des Travailleurs Sans-Emploi du quartier de Solano), travailleurs qui ont impulsé la Coordination Anibal Verón, idéologie reproduite par Situaciones dans différentes brochures. Il ne s’agit pas ici de rabaisser la lutte menée par les camarades, par les piqueteros de ce quartier qui, par ailleurs, sont depuis des années à l’avant-garde du combat contre les forces répressives de l’Etat, il s’agit de combattre l’idéologie gestionniste qui s’exprime en leur nom et qui les entraîne vers une voie sans issue.
« L’expérience du MTD-Solano a sa singularité. Ses fondateurs travaillaient dans la chapelle de la zone jusqu’au moment où ils furent délogés par l’évêque Novak. Ensuite, ils commencèrent à organiser le MTD Teresa Rodríguez… Avec le temps, ils commencèrent à administrer leurs propres projets (Planes Trabajar). Et très rapidement ils fondèrent des commissions et des ateliers de formation politique, de boulangerie, de forge, une pharmacie pour le mouvement, etc. »[14]
L’on peut considérer logique, comme nous le disions plus haut, qu’on lutte pour imposer ces Planes Trabajar dans la mesure où on arrache quelque chose au capitalisme sur base d’un rapport de force, mais les porte-parole du MTD-Solano en viennent à idéaliser les résultats des entreprises productives développées dans ces conditions. Ces entreprises et les rapports sociaux qui en découlent sont totalement idéalisés, au point de prétendre que l’exploitation y serait abolie peu à peu : « Ce qui est très clair pour nous c’est que nous voulons abolir l’exploitation, seulement l’exploitation ne s’annule pas à partir d’une idée mais d’un processus et progressivement. Je n’oublie jamais ce qu’a dit une camarade lorsque nous étions dans l’atelier d’éducation populaire et que nous travaillions le thème de l’identité. Elle a dit : ‘Ici je suis redevenue moi-même par rapport au travail. Parce que maintenant je suis une travailleuse, même si je ne reçois pas d’allocation : je suis une travailleuse et pas une exploitée’. »
Toute l’idéologie des porte-parole du MTD-Solano va dans le sens de cette apologie de la gestion immédiate, du changement graduel et d’une économie prétendument alternative comme synonyme de changement social : « Nous tentons de travailler sur l’idée d’une économie parallèle… nous tentons de concevoir des projets productifs qui ne soient pas PYMES, qui aient d’autres caractéristiques, où les relations de travail changent, où l’essentiel ne soit pas la marchandise, l’échange de la force de travail contre de l’argent ; c’est un projet très vaste. » C’est-à-dire que l’on nous vend comme une nouveauté cette vieille idée proudhonienne, réformiste de l’établissement de rapports sociaux non capitalistes sans l’indispensable destruction révolutionnaire de ce qui existe en réalité : la dictature du capital. Cette idéologie d’une soi-disant « solidarité transcendant l’individualisme » basée sur les entreprises productives est évidemment tout à fait utopique. Si l’on ne détruit pas la dictature de la valeur, on ne peut dépasser l’individualisme. Lorsque le prolétariat descend dans la rue pour en découdre, cette idéologie fait office de barrière contre la révolution sociale.
On peut dire la même chose de tous les discours sur l’horizontalité, sur la décision de la base, sur l’incessante discussion des critères, sur la multiplicité, sur le fait que tous décident et/ou sur la démocratie directe, alors que ce qui se décide, en fait, c’est de produire pour le marché : « Ce que nous faisons, c’est réviser constamment les accords… Parce que nous avançons toujours sur base d’accords : quand on descend dans la rue, quand on constitue un groupe de travail ou une zone du mouvement… Ce qui nous a grandement facilité la tâche, c’est qu’on n’a commencé aucun groupe sans avoir d’abord soumis les critères à la discussion, ils ont toujours été définis par l’ensemble du mouvement. Par exemple, dans les entreprises productives, il faut d’abord se former et fixer des critères de production pour ensuite produire et vendre à l’extérieur. » Comme si on pouvait rompre avec la structure de domination capitaliste sans remettre en question la dictature de ce marché, la dictature de la valeur !
C’est sur ce terrain et sur cette base que les discours s’opposant à la prise du pouvoir par le prolétariat prennent toute leur dimension contre-révolutionnaire : « Nous serions un peu fous si nous cherchions à créer une organisation populaire de base, pour le changement social, en fonction d’une lutte pour arracher le pouvoir politique au capitalisme… cela ne nous intéresse pas de prendre le pouvoir politique, (ce qui nous intéresse c’est de) commencer à vivre comme nous en avons si souvent rêvé. Et cela, c’est maintenant : nous n’allons pas devoir attendre une révolution. » Comme on peut le constater, on nage dans le gestionnisme et l’immédiatisme le plus grossier, en opposition à la révolution sociale. Comme si on pouvait « vivre comme on en a toujours rêvé » en plein capitalisme et sous la terreur de l’Etat ! Ce dont il faut se rendre compte, c’est que ce que disent ici les porte-parole du MTD-Solano, ce n’est pas seulement qu’ils sont contre la prise du pouvoir politique, ce avec quoi nous pourrions être d’accord parce que, pour nous, il ne s’agit pas de prendre l’Etat bourgeois mais de le détruire ; ce qu’ils disent, c’est qu’ils sont contre la révolution, contre la liquidation du pouvoir du capital qui n’est évidemment pas que politique. En effet, la clé de voûte de ce plan c’est « organiser l’économie alternative » sans détruire la société marchande. Comme s’il pouvait y avoir une autre économie, une autre société, en plein capitalisme ! Ils oublient juste un détail : c’est que cette économie soi-disant alternative est soumise à la dictature du capital : dictature de la loi de la valeur, dictature de l’Etat bourgeois.
A ce sujet, il faut mentionner que c’est le Coletivo Situaciones (au travers de ses textes et de ses interviews des porte-parole de MTD-Solano) qui a fait le plus de propagande pour cette position gestionniste tellement puissante dans le monde entier et qui, répétons-le, dans un mouvement comme celui du prolétariat en Argentine joue un rôle contre-révolutionnaire, en lui donnant une conception plus globale, plus philosophique. Ce collectif est un mélange idéologique de stalinisme, de populisme, de proudhonisme. Ou, plus précisément, un mélange de manque de ruptures avec le nationalisme et avec le populisme sous toutes ses formes (péronisme radical, guevarisme, castrisme ou inspiré du modèle actuel des Tupamaros uruguayens –aujourd’hui parlementaires et défendant le Frente Amplio – ou encore celui du sous-commandant Marcos) mais qui utilise le langage à la mode de la gauche alternative. Situaciones s’est spécialisé dans cette apologie de la gestion contre toute remise en question révolutionnaire. Il est pour le moins symptomatique que dans son apologie de la gestion contre ceux qui luttent pour la révolution sociale, le Coletivo Situaciones soit obligé de paraphraser la vieille phraséologie léniniste, puis stalinienne, contre les révolutionnaires : « La politique sans gestion est le nouvel infantilisme de la gauche »[15].
Cette citation apologétique du léninisme contre les positions révolutionnaires[16] suffit à mettre en évidence qu’en dépit de ce que les auteurs de Situaciones ont pu lire concernant les situationnistes ou émanant directement de ces derniers, ils n’ont rien de commun avec ces camarades. Rappelons que dans Situaciones, la lutte pour la dictature du prolétariat, qui est l’un des points programmatiques les plus clairement démarcatoires chez les situationnistes, brille ici par son absence. La terminologie spectaculaire de Situaciones (qui va jusqu’à parler d’« usine spectaculaire » !) prétend utiliser formellement une continuité mais elle le fait si mal qu’elle révèle à chaque instant sa non rupture fondamentale avec le populisme et le stalinisme. Ainsi, ils n’hésitent pas à parler de « la recherche d’une production non capitaliste. Une nouvelle productivité pour les sujets, pour les militants, pour la pensée, pour les liens, pour l’économie et les représentations qui – comment ne pas le mentionner ? – constituent essentiellement nos vies. »
Dans le cadre de la lutte contre cette idéologie bourgeoise, nous voudrions reproduire ici quelques extraits d’un feuillet publié à l’origine en italien et intitulé : Ai ferri corti et traduit, publié et diffusé en décembre 2001 par des camarades en Argentine.
Indépendamment des désaccords que nous avons avec ses auteurs, ce document critique d’un point de vue révolutionnaire le gestionnisme tel que l’exprime Situaciones et d’autres groupes. Voici quelques extraits qui se situent sur une ligne de dénonciation identique à la nôtre : « Les exploités n’ont rien à autogérer à l’exception de leur propre négation comme exploité. Ce n’est qu’ainsi qu’avec eux disparaîtront leurs maîtres, leurs guides, leurs apologistes pomponnés des plus diverses manières… Curieusement ceux qui considèrent l’insurrection comme une tragique erreur (ou également, selon les goûts, comme un irréalisable rêve romantique) parlent beaucoup d’action sociale et d’espaces de liberté pour expérimenter… Beaucoup de libertaires pensent que le changement de la société peut et doit avoir lieu graduellement, sans rupture brutale. C’est pourquoi ils parlent de « sphères publiques non étatiques » où élaborer des idées nouvelles, de nouvelles pratiques. Laissant de côté les aspects décidément comiques de la question (où n’y a-t-il pas d’Etat ? comment le mettre entre parenthèses ?), ce qu’on peut noter c’est que le référent idéal de ces discours reste la méthode autogestionnaire et fédéraliste expérimentée par les subversifs à certains moments de l’histoire (la Commune de Paris, l’Espagne révolutionnaire, la Commune de Budapest, etc.). Le petit détail qu’on néglige cependant, c’est que la possibilité de se parler et de changer la réalité, les rebelles l’ont prise avec les armes. En définitive, on oublie une broutille : l’insurrection.»
Les gestionnistes « oublient » aussi que, y compris dans les cas cités plus haut, l’insurrection ne faisait que commencer, que l’Etat bourgeois n’avait pas été détruit, que le gestionnisme, loin de permettre une avancée révolutionnaire, permit la restructuration du capital et de l’Etat contre le processus révolutionnaire naissant. Ils « oublient » que, dans tous ces exemples historiques, le gestionnisme, en dévoyant l’énergie révolutionnaire dans l’autogestion, ouvrit la voie à la répression qui s’abattit ensuite !
Pour en finir avec le gestionnisme, il nous faut insister sur sa constante complémentarité avec le politicisme. Si les uns nient la lutte contre le pouvoir capitaliste et appellent à la gestion tandis que les autres appellent à l’institutionnalisation du mouvement au sein du pouvoir de l’Etat, soulignons que tous s’opposent à l’insurrection et à la destruction violente du capitalisme et de la société marchande. Les deux conceptions agissent comme si le fondement dictatorial de la société capitaliste, la dictature de la valeur contre l’être humain, n’existait pas. Elles désirent toutes deux démocratiser la société bourgeoise, l’une politiquement, l’autre économiquement (« démocratie directe ») ; aucune ne rompt avec la dictature sociale que cette démocratie implique.
En ce sens, elles sont d’une complémentarité parfaite, dans les deux cas on cherche des solutions au sein du capitalisme et on s’oppose à la lutte pour la dictature du prolétariat pour abolir le salariat, la marchandise.
Aujourd’hui en Argentine, où le prolétariat s’oppose objectivement à toute la société marchande, à tous les partis, à tous les syndicats ; où personne ne croit au prochain président, ni aux parlements, ni aux élections ; où le rejet de tous les pouvoirs est général, ceux qui sont en train de sauver l’ordre social sont, en fait, ceux qui parlent d’assemblées constituantes mais aussi ceux qui cherchent des solutions dans la gestion économique laissant intactes les bases de cette société (la société marchande et l’autonomie des unités privées de décision, l’entreprise,…). Confrontés à la catastrophe économique, sociale et politique du monde capitaliste dans son ensemble qui s’abat sur le prolétariat en Argentine, les gestionnistes et les politicistes révèlent leur véritable nature : de fausses alternatives indispensables pour empêcher la remise en question de la société actuelle, pour empêcher d’en détruire les fondements.
7/ Généralisation et perspectives
Occupation des rues, associationnisme, affirmation du piquet et de l’escrache, voilà les éléments du développement de la force du mouvement révolutionnaire du prolétariat en Argentine.
Dans son article intitulé « Le mouvement des sans-emploi en Argentine »[17], James Petras se réfère à la généralisation du piquet et dit : « Le succès précoce des barrages routiers par les travailleurs au chômage dans les villes fantômes de Neuquen en 1996 s’est répandu dans tout le pays. Les barrages routiers sont devenus la tactique généralisée de groupes exploités et marginaux dans toute l’Amérique Latine. En Bolivie, plusieurs milliers de paysans et de communautés indigènes ont coupé les routes en demandant des crédits, des infrastructures, la liberté de cultiver la coca, l’augmentation des dépenses en matière de santé et d’éducation. En Equateur également, on proteste par de massifs barrages routiers contre la dollarisation de l’économie, le manque d’investissements publics dans les régions montagneuses, etc. En Colombie, au Brésil, au Paraguay, les barrages routiers, les marches et les occupations de terres associent demandes immédiates et exigence de politiques redistributives, la fin du néolibéralisme et des payements de la dette. » Laissant de côté les objectifs partiels que Petras attribue à ce mouvement (qui, pour nous, reflète plus l’idéologie réformiste de Petras que la force du mouvement), il nous semble que cette citation donne des éléments sur sa généralisation, au moins concernant les six premiers mois de l’année 2001. Ensuite, il y eut non seulement de nouveaux barrages routiers dans presque tous les pays mentionnés par Petras, mais également dans d’autres pays de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du Nord.
Les escraches aussi se sont généralisés. Non seulement en Argentine et dans les pays limitrophes comme le Chili et l’Uruguay, mais également aux Etats-Unis (escrache de Bush en Pennsylvanie en juillet 2002 au cri de « Bush terroriste », comme aux Philippines quelques semaines plus tôt), au Brésil, en Espagne, en Italie (même si dans ces deux pays, pour le moment, seuls des bourreaux argentins ont été escrachés).
Face à la catastrophe capitaliste qui se concrétise de jour en jour, il s’agit là de signes évidents de la reprise de la lutte prolétarienne dans de nombreux pays. Dans le processus d’affirmation prolétarienne le piquet, l’escrache, l’organisation en assemblées territoriales deviennent des armes puissantes. La généralisation de ces méthodes et structures organisatives à d’autres pays, le fait que l’exemple du prolétariat en Argentine commence à être connu et assumé sont des éléments vraiment encourageants et pourraient indiquer un changement quant aux caractéristiques des luttes actuelles, tant en ce qui concerne la durée de cet associationnisme prolétarien naissant que sur le plan du rapport de force qui pourrait commencer à changer si piquets et escraches se généralisent à d’autres continents.
Les idéologies contre-révolutionnaires que nous devrons affronter seront toujours les mêmes, quels que soient les costumes sous lesquels elles se travestissent : le politicisme et le gestionnisme. L’imposante catastrophe que vit le capital et qui frappe l’humanité continuera à s’aggraver et brûlera sur son passage toutes les fausses pistes jusqu’à ce que le prolétariat affirme sa révolution en détruisant pour toujours la société marchande.
Généralisons la lutte du prolétariat en Argentine !
Pour l’extension des piquets au monde entier !
Pour la généralisation de l’escrache !
Pour la destruction révolutionnaire de la société marchande !
Cette lettre ouverte au prolétariat argentin a été publiée sur internet le 31 décembre 2001 par les camarades du groupe Conflicto, Papiers pour la révolution sociale, apartado di correos 15104, 28080 Madrid, estado español, e-mail konflizto@hotmail.com
Nous la republions parce qu’elle est tout à fait d’actualité, parce qu’elle se situe ouvertement contre le courant dominant et parce qu’elle affirme une direction révolutionnaire claire, aujourd’hui indispensable pour le mouvement de notre classe en Argentine. Comme elle le sera demain dans le monde entier.
Lettre ouverte au prolétariat argentin
«Frères,
1) La crise qui fond si violemment sur vos misérables existences n’a pas grand-chose d’argentin, elle n’est pas la conséquence de « mauvaises gestions », de « politiciens corrompus » ni de rien de la sorte ; c’est le capitalisme mondial qui se meurt. Vous, vous êtes seulement parmi les premiers à être immolés avec lui, avec ce cadavre horripilant qui, sur son lit de mort, continue à assassiner par millions les prolétaires du monde entier.
Beaucoup de sang devra encore couler pour que le système entier s’écroule enfin.
2) Le capital a déployé toutes ses armes pour vous combattre : partis, syndicats, ultragauchistes, nationalisme, balles, bastonnades, torture, prison. Par conséquent, vous devrez utiliser toutes vos armes pour combattre le capitalisme (la première de toute, la conscience de votre/notre projet révolutionnaire d’abolition de la société de classe, la conscience de votre appartenance à un mouvement historique et mondial pour le communisme).
N’en restez pas là si vous ne voulez pas être anéantis. Les forces qui disent vous représenter, vous et vos intérêts, ne sont en fait que les différents visages de la même bête capitaliste et n’ont d’autre projet que celui de vous soumettre et de vous exploiter.
Brûlez les sièges des politiciens. Ne laissez pas vos affaires entre les mains des syndicats : mettez votre poing dans la gueule des syndicalistes.
3) Votre travail incendiaire a eu la force d’avoir su prendre les rues et l’insuffisance de n’avoir pas su défendre cette conquête. Dans les jours et les mois de lutte qui viennent, vous devrez acquérir la force d’imposer votre projet, conquérir les rues, paralyser l’économie, abattre les contrecoups réactionnaires qui viendront. La gigantesque tâche de démolition que l’histoire a placée devant vous est une chose pour laquelle vous devrez être préparés.
4) Les démissions successives n’ont été que des manœuvres de distraction, un baratin grossier pour que vous pensiez avoir obtenu quelque chose, une petite victoire, au moins. La seule chose que vous pouvez attendre de la part des « nouveaux » bourgeois au pouvoir, c’est qu’ils sabrent plus encore dans vos conditions de survie. Frères : si vous ne continuez pas la lutte, si vous ne la menez pas jusqu’à ses ultimes conséquences, vous resterez dans la merde et vous vous y enfoncerez toujours plus.
Mener la lutte à ses ultimes conséquences signifie assumer les premières conséquences : la lutte pour vos propres intérêts comme classe, sans considération aucune pour l’économie nationale ou la situation des entreprises.
La promesse de non payement de la dette extérieure est un cadeau du gouvernement qui vient de démissionner aux grands bourgeois argentins, ceux-là mêmes qui amassent des milliers de millions de dollars dans les « paradis fiscaux ». La question de la dette extérieure est une affaire qui concerne les capitalistes de tous les pays, pas les prolétaires : qu’entre eux, ils se donnent plus ou moins de coups de dents ne change en rien notre situation d’exploités. Les jongleries monétaires avec lesquelles l’un ou l’autre de ces chiens prétend « résoudre » la crise signifie simplement de plus en plus de misère pour vous.
Prolétaires : n’ayez confiance en personne d’autre qu’en vous-mêmes et en vos propres forces, luttez pour vos propres intérêts de classe sans égard pour l’économie et l’Etat que, tôt ou tard, vous vous verrez obligés de détruire.
5) Frères, votre algarade constitue le fer de lance du mouvement international pour la destruction du capital. Les circonstances historiques vous ont placés dans cette position et vous devrez avoir le courage, la détermination et la conscience nécessaire pour la mener à ses ultimes et naturelles conséquences, ouvrant le chemin à un prolétariat qui, aujourd’hui, dans le monde entier, commence à nouveau à se retourner contre ses maîtres.
Avec les prolétaires (peut-être parfois appelés « paysans », « indigènes », « berbères », etc.) de Bolivie, d’Algérie, avec les prolétaires d’Europe qui s’appliquent à gâcher la fête aux puissants, avec ceux qui, où que ce soit, se rebellent contre l’exploitation et l’oppression du capital/Etat, soyez la partie visible de l’iceberg qui enverra ce bateau de merde par le fond.
Frères : votre feu est le meilleur moyen de communication. Les colonnes de fumée qui s’étendent à toute l’Argentine traversent les frontières et ont été aperçues en Bolivie, en Algérie, en Corée, en Europe,… N’arrêtez pas de parler avec le feu, méprisez toutes les caméras de télévision : ce n’est pas votre terrain.
Camarades, si nos arguments vous ont parus corrects, défendez, diffusez et reproduisez ce texte aussi rapidement que vous le pouvez par tous les moyens dont vous disposez ou que vous avez à votre portée. Et sinon, jetez-le sur-le-champ et commencez immédiatement à en publier d’autres qui soient meilleurs ! Car il est hors de doute que vous avez le droit de juger avec rigueur nos modestes arguments. Mais ce qui l’est plus encore, c’est que la scandaleuse réalité que nous avons révélée, comme nous le pouvions, n’est pas une matière que vous puissiez juger : au contraire, c’est elle qui, au bout du compte vous jugera tous.
Pour l’abolition du travail salarié et de la marchandise.
Pour la destruction de l’Etat et de la société de classes.
Pour le communisme.
Pour l’anarchie. »
Novembre 2002
A propos des luttes prolétariennes en Argentine
Deuxième partie
Contre les campagnes bourgeoises de disqualification de ces luttes
Quelques discussions entre camarades
(in Communisme n°55 – février 2004)
La bourgeoisie, et ses laquais un peu partout dans le monde, fait tout ce qu’elle peut pour disqualifier et falsifier les luttes du prolétariat en Argentine. S’il en est ainsi, c’est parce qu’à notre avis, sous bien des aspects, ces luttes indiquent, avec leurs forces et faiblesses, ce qui pourrait se produire sous d’autres latitudes. C’est pourquoi elles ont suscité un grand nombre de discussions entre camarades de tous azimuts. Et c’est également pour ces raisons que nous revenons – et reviendrons encore ultérieurement – sur le sujet : à savoir, en quoi la défense du caractère prolétarien de ces luttes et les discussions qui l’accompagnent contiennent une validité à perspective internationale.
1/ Négation du prolétariat en Argentine – répression
La domination bourgeoise n’a de cesse de nier l’existence de son ennemi historique, de nier le fait qu’il puisse exister un projet antagonique à la société actuelle. Le terrorisme d’Etat, les mass médias réalisent cette négation : le prolétariat n’existe pas, sa lutte non plus La liquidation physique de militants, la propagande d’Etat, les théories universitaires et celles des organisations politiques de la classe dominante, l’action des partis social-démocrates, la falsification et l’occultation de l’histoire de notre classe sont autant de mécanismes d’oppression qui visent à nier (détruire) le prolétariat. Comme nous l’avons souvent souligné, la lutte du prolétariat se voit assimilée à une lutte nationale, voire nationaliste, à une lutte ethnique ou à une lutte de chômeurs, de pauvres, de commerçants, de retraités, d’étudiants, d’ouvriers, de paysans bref à n’importe quelle lutte, du moment que soit nié le caractère révolutionnaire du mouvement et le prolétariat lui-même, en tant que force historique.
Comme déjà dénoncé dans la première partie de ce texte, toutes les théories dominantes à ce sujet ont concentré leur force pour nous présenter le mouvement prolétarien comme divisé en composantes sociologiques : le lumpenprolétariat, la « classe moyenne », les étudiants, les ouvriers, les épargnants, les assemblées de quartiers Une manière exemplaire de préparer le terrain pour que le prolétariat reste en dehors de l’histoire et pouvoir ainsi liquider le sujet de la révolution et son projet révolutionnaire. Un terrain parfait pour alors parler de « nationalisations », de « privatisations », d’assemblées constituantes, de gestions et d’autogestions, d’actions civiques et pacifiques, de plans pour les épargnants, de changements gouvernementaux ou syndicaux, d’économie alternative et autres inventions locales… Si la lutte n’est pas une lutte du prolétariat contre le capital, parler de révolution sociale n’a plus aucun sens.
On réécrit donc l’histoire et on prétend que les piquets, les saqueos et les violentes luttes contre les appareils de la bourgeoisie sont l’œuvre désespérée du « lumpenprolétariat », de « marginaux », de « chômeurs », on attribue le mouvement contre le corralito, les cacerolazos, voire les assemblées unitaires qui se développèrent dans la Capitale Fédérale[18], à l’action des « classes moyennes » ou de la « petite bourgeoisie ». Et même les « ouvriers » des usines occupées se sont vus marginalisés, grâce à une théorie fumeuse, prétendant qu’ils auraient été noyés dans une révolte interclassiste.
En guise de lumineux exemple, nous reproduisons un texte de l’autoproclamé « Courant Communiste Internationaliste »[19] qui, comme vous pourrez le constater dans le texte mis en évidence ci-dessous, illustre parfaitement cette manipulation idéologique bourgeoise.
« Dans les mobilisations sociales qui ont eu lieu en Argentine, nous pouvons distinguer trois composantes :
Premièrement, les assauts contre les supermarchés menés essentiellement par des marginaux, la population lumpenisée ainsi que par les jeunes chômeurs.
Ces mouvements ont été férocement réprimés par la police, les vigiles privés et les commerçants eux-mêmes. (…)
La seconde composante a été « le mouvement des cacerolas (casseroles) ».
Cette composante a été essentiellement incarnée par les « classes moyennes », exaspérées par le mauvais coup porté par la séquestration et la dévaluation de leur épargne, ce qu’on appelle corralito. La situation de ces couches est désespérée : « Chez nous, la pauvreté s’allie à un chômage élevé ; à cette pauvreté s’ajoutent les ‘nouveaux pauvres’ qui y tombent, anciens membres de la classe moyenne, à cause d’une mobilité sociale déclinante, à l’inverse de l’émigration argentine florissante des débuts du 20ème siècle. » Les employés du secteur public, les retraités, certains secteurs du prolétariat industriel reçoivent, comme la petite bourgeoisie, le coup de poignard que constitue le corralito : leurs maigres économies, acquises grâce à l’effort de toute une vie, se trouvent pratiquement réduites à néant ; ces compléments à des pensions de misère, se sont volatilisés. Cependant, aucune de ces caractéristiques n’apporte un caractère de classe au mouvement des cacerolas, et ce dernier reste une révolte populaire interclassiste, dominée par les prises de positions nationalistes et « ultra-démocratiques ».
La troisième composante est formée par toute une série de luttes ouvrières.
Il s’agit notamment des grèves d’enseignants dans la grande majorité des 23 provinces d’Argentine, du mouvement combatif des cheminots au niveau national, de la grève de l’hôpital Ramos Mejias dans la Capitale Fédérale ou de la lutte de l’usine Bruckmann dans le Grand Buenos Aires, au cours de laquelle ont eu lieu des affrontements tant avec la police en uniforme qu’avec la police syndicale, de la lutte des employés de banque, de nombreuses mobilisations de chômeurs qui, depuis deux ans, ont fait des marches à travers le pays tout entier (les fameux piqueteros).
Les révolutionnaires ne peuvent évidemment que saluer l’énorme combativité dont a fait preuve la classe ouvrière en Argentine. Mais, comme nous l’avons toujours affirmé, la combativité, aussi forte soit-elle, n’est pas le seul et principal critère permettant d’avoir une vision claire du rapport de forces entre les deux classes fondamentales de la société : la bourgeoisie et le prolétariat. La première question à laquelle nous devons répondre est la suivante : ces luttes ouvrières qui ont explosé aux quatre coins du pays et dans de nombreux secteurs, se sont-elles inscrites dans une dynamique pouvant déboucher sur un mouvement uni de toute la classe ouvrière, un mouvement massif capable de briser les contre-feux mis en place par la bourgeoisie (notamment ses forces d’opposition démocratiques et ses syndicats) ? A cette question, la réalité des faits nous oblige à répondre clairement : non. (…) Et c’est justement parce que ces grèves ouvrières sont restées éparpillées, et n’ont pu déboucher sur un gigantesque mouvement unifié de toute la classe ouvrière que le prolétariat en Argentine n’a pas été en mesure de se porter à la tête du mouvement de protestation sociale et d’entraîner dans son sillage, derrière ses propres méthodes de lutte, l’ensemble des couches non-exploiteuses. Au contraire, du fait de son incapacité à se porter aux avant-postes du mouvement, ses luttes ont été noyées, diluées et polluées par la révolte sans perspective des autres couches sociales qui, bien qu’elles soient elles-mêmes victimes de l’effondrement de l’économie argentine, n’ont aucun avenir historique. (…)
Contrairement à sa vision photographique et empiriste, ce n’est pas le prolétariat qui a entraîné les étudiants, les jeunes, des parties importantes de la petite bourgeoisie, mais c’est précisément l’inverse. C’est la révolte désespérée, confuse et chaotique d’un ensemble de couches populaires qui a submergé et dilué la classe ouvrière. Un examen sommaire des prises de position, des revendications et du type de mobilisation des assemblées populaires de quartier qui ont proliféré dans le Grand Buenos Aires et se sont étendues à tout le pays, le montre dans toute sa crudité. Que demande l’appel à manifester du cacerolazo mondial des 2 et 3 février 2002, appel qui a trouvé un écho auprès de vastes secteurs politisés, dans plus de vingt villes de quatre continents ? Ceci : « Cacerolazo global, nous sommes tous l’Argentine, tout le monde dans la rue, à New York, Porto Alegre, Barcelone, Toronto, Montréal – (ajoute ta ville et ton pays). Que tous s’en aillent ! FMI, Banque mondiale, Alca, multinationales voleuses, gouvernements/politiques corrompus ! Qu’il n’en reste pas un ! Vive l’assemblée populaire ! Debout le peuple argentin ! » Ce « programme », malgré toute la colère qu’il exprime contre « les politiques », est celui que ces derniers défendent tous les jours, de l’extrême-gauche à l’extrême-droite, car les gouvernements « ultra-libéraux » eux-mêmes savent porter des coups « critiques » à l’ultra-libéralisme, aux multinationales, à la corruption, etc.
D’autre part, ce mouvement de protestation « populaire » a été très fortement marqué par le nationalisme le plus extrême et réactionnaire. (…)
Du fait de son caractère interclassiste, ce mouvement populaire et sans perspective ne pouvait rien faire d’autre que de préconiser les mêmes solutions réactionnaires qui ont conduit à la situation tragique dans laquelle a plongé la population, et dont les partis politiques, les syndicats, l’Église, etc. – c’est-à-dire les forces capitalistes contre lequel ce mouvement voulait lutter – ont la bouche pleine. Mais cette aspiration à la répétition de la situation antérieure, cette recherche de la poésie du passé est une confirmation très éloquente de son caractère de révolte sociale impuissante et sans avenir. (…)
L’Argentine montre avec clarté ce danger potentiel : la paralysie générale de l’économie et les convulsions importantes de l’appareil politique bourgeois n’ont pas été utilisées par le prolétariat pour s’ériger en tant que force sociale autonome, pour lutter pour ses propres objectifs et gagner à travers cela les autres couches de la société. Submergé par un mouvement interclassiste, typique de la décomposition de la société bourgeoise, le prolétariat s’est trouvé entraîné dans une révolte stérile et sans avenir. »
Et comme toujours, la « démonstration » du CCI[20] consiste en une énumération sociologique de différentes composantes de la société bourgeoise, où les différents types de protestations se voient idéologiquement séparés (niant ainsi leur unité pratique et le processus d’unification réelle qui s’est produit dans la lutte autour des secteurs les plus combatifs du prolétariat), et qui aboutit à la dénonciation de tout ce que le mouvement pourrait contenir d’idéologies bourgeoises et en priorité du nationalisme. Auraient-ils déjà vus, ces distributeurs de bons points, une « révolution prolétarienne » exempte d’idéologies bourgeoises, d’idéologies nationalistes ?! L’idéalisation d’une classe ouvrière pure (sans lumpenprolétariat, ni ouvriers des pays périphériques, ni pilleurs), l’idéalisation de l’autonomie prolétarienne (comprise non pas comme un processus qui s’affirme dans la lutte, mais comme un « devoir être ») et d’une révolution prolétarienne sans idéologie bourgeoise, les amènent à non seulement nier idéologiquement le mouvement réel d’affirmation du prolétariat, mais contribue à la désorientation et à la division du prolétariat. Et en totale cohérence avec une telle conception, le CCI termine dès lors par cette docte conclusion, digne de Plekhanov (« il n’avait qu’à ne pas prendre les armes ») : cette révolte est « stérile et sans avenir » !
On ne peut trouver d’opposition plus évidente (tant au niveau local que national ou international) que celle qui existe entre, d’une part, toutes les idéologies et forces qui divisent le prolétariat idéologiquement et pratiquement et, d’autre part, l’action réelle du prolétariat tendant à s’affirmer comme classe et comme parti.
Comme nous l’avions déjà signalé dans la première partie, c’est précisément dans l’action directe que le prolétariat s’est unifié (en occupant la rue, par les assemblées, les piquets, les saqueos, les escraches, en s’attaquant aux centres de répression et aux centres économiques du système), en dépassant les divisions et en prônant la participation de tous dans la lutte : ouvriers et employés, travailleurs et chômeurs, enfants, jeunes et vieux, habitants des campagnes, des villes, des quartiers ou des villas miserias[21]. Et nous le réaffirmons encore, c’est dans sa pratique que le prolétariat a dépassé les revendications catégorielles, a remis de plus en plus en question les syndicats et les partis et, parallèlement à cela, a cherché à s’organiser en assemblées territoriales, ce qui exprime toujours un saut de qualité dans le mouvement. Dans ce processus, le prolétariat s’est affirmé comme classe en occupant la rue, en attaquant la propriété privée qui les affame, et les appareils d’Etat qui la protègent.
Précisons encore que les travailleurs qui ont occupé et occupent toujours des usines (en 2003, plus de 100 entreprises étaient toujours occupées) ont eu la lucidité de saisir le saut de qualité existant entre l’usine et la rue, les piquets d’usines et le blocage des routes, les assemblées d’usines et les assemblées territoriales. En guise d’exemple, citons les prolétaires de la Cerámica Zanon qui, depuis 1996-97, passent des piquets d’usines aux blocages de routes pour s’opposer à la distribution des marchandises et tendent à s’unifier aux piquets et assemblées d’autres franges du prolétariat (en particulier le Mouvement des Travailleurs de Neuquèn). Le même phénomène a pu être observé dans la Capitale Fédérale avec les travailleurs en lutte de l’usine Brukmann qui, par leur participation aux assemblées de quartiers, ont favorisé une plus grande unification avec d’autres secteurs du prolétariat, pour pouvoir résister et affronter ensemble les violentes tentatives d’expulsion des forces répressives. L’énorme pression idéologique visant à les enfermer dans le gestionnisme rendra difficile sans doute le maintien à long terme de cette position conquise dans la lutte mais cela n’empêchera pas les prolétaires des usines occupées de devenir des éléments dynamisateurs dans les assemblées de quartiers, les manifestations, les escraches : ce sont précisément ces usines occupées qui, bien souvent, vont servir de lieux de réunion.
Toutes les idéologies bourgeoises vont s’efforcer de minimiser, de falsifier, de nier, ce processus d’unification évoquant une espèce d’unité interclassiste, allant même jusqu’à parler de conciliation entre petite bourgeoisie et prolétariat. Tout cela pour nier le fait que, dans la pratique, il ne s’agissait pas d’une manifestation pacifique, citoyenne, démocratique, politiciste, comme le souhaitaient ardemment tous les secteurs partisans de cette conciliation, de cette canalisation, tous les organisateurs de manifestations civiques, mais, qu’au contraire, les secteurs décisifs du prolétariat, déjà présents dans la rue, avaient réussi à entraîner le mouvement vers un débordement de tous les appareils d’Etat. Ni les mots d’ordre appelant à la modération, ni les cacerolazos pacifiques dont les médias ont fait la propagande, ni les piquets refusant « le blocage total des routes et les cagoules », ni les marches moutonnières organisées par les partis et les syndicats, n’ont été les déterminants du mouvement. C’est, à l’inverse, le mouvement lui-même qui, jaillissant des quartiers, des piquets en faveur « d’un blocage total », des escraches, des assemblées, des grèves et occupations d’usines, a mis à l’avant-garde ce saut de qualité, par l’occupation de plus en plus massive et organisée des rues, par l’associationnisme prolétarien et avec des mots d’ordre de plus en plus généraux contre toutes les structures de l’Etat.
Et tandis que le prolétariat dans ce processus de lutte et d’affirmation classiste, générait lui-même une critique à nombre de ses propres mots d’ordre et que, parallèlement, des militants d’avant-garde dénonçaient le nationalisme, le démocratisme, le gestionnisme et/ou le politicisme, autrement dit, un ensemble d’idéologies et de drapeaux contre-révolutionnaires présents dans le mouvement (ce qui constitue l’une des invariances historiques de tout grand mouvement prolétarien), tous les appareils nationaux et internationaux de diffusion et de contrôle de l’information, de gauche comme de droite, assénaient leur propagande et mettaient l’accent sur les idéologies nationalistes, gestionnistes, politicistes, Tout fut ainsi mis en œuvre contre l’unification du prolétariat en Argentine et dans le monde : diffusion de chants nationalistes et péronistes, bastonnades et pressions, attaque armée, froidement planifiée par les appareils centraux de l’Etat à l’encontre des secteurs les plus organisés des piqueteros, soutien des positions gestionnistes de tel ou tel groupe piquetero en voyage à travers l’Europe pour fortifier les discours du fameux sous-commandant Marcos, projets et approbations de lois répressives, en particulier contre les piquets et les escraches, redorage du blason de l’alternative démocratico-électorale, propagande en faveur des groupes argentins les plus gestionnistes, commise par d’immondes réformistes connus de longue date tel Tony Negri, tentative pour rendre crédible le nouveau président argentin, en le présentant comme un gauchiste anti-impérialiste, publicité pour un cacerolisme pacifiste, pour des piquets non-violents, voire même des piquets refusant de couper le trafic, volonté de mettre en opposition les piquets d’un côté et les cacerolazos de l’autre, les quartiers entre eux, allant même jusqu’à s’évertuer à vouloir opposer les piqueteros entre eux. La bourgeoisie, d’où qu’elle soit, n’aspire qu’à une seule chose : dormir tranquille. Pour elle, les prolétaires du monde entier n’existent pas, ils n’agissent pas en tant que tels et ne doivent pas être informés des actions de leurs frères de classe. Pour elle encore, seule compte l’opinion publique, qui doit rabâcher, à n’en plus finir, qu’en Argentine il n’y a eu qu’une lutte interclassiste, petite-bourgeoise, lumpenisée ; mais oui, vous savez bien, ces fameux désespérés de la faim de ce qu’on appelle le « tiers-monde ».
Et comme ce fut le cas pour d’autres luttes révolutionnaires, ainsi s’établit un véritable cordon sanitaire, isolant le prolétariat, qui vit et lutte dans ce pays. Le conseil adressé alors aux « véritables prolétaires » ne peut être plus clair : surtout ne pas participer à la lutte, surtout ne pas se laisser entraîner par les couches lumpenisées qui en appellent à l’action directe. Et s’il était encore nécessaire d’enfoncer le clou, non seulement il y a les dizaines de morts, fruit du terrorisme d’Etat, mais aussi la position présentant le mouvement comme « stérile et sans avenir », comme aime à le répéter la contre-révolution.
Ou, toujours dans le même objectif, liquidateur et source de confusion, on assimile dans un même mouvement ce qui, en réalité, est totalement opposé : la lutte prolétarienne et les forces de l’Etat, la lutte des piquets et la gestion capitaliste de l’Etat.
Certains vont prétendre que nous exagérons, qu’il est vraiment grossier d’assimiler les prolétaires en lutte, paralysant la reproduction du capital, avec les gestionnaires de cette reproduction du capital au service de l’Etat (« les piqueteros argentins et le brésilien Lula »), et ajouteront que seul un Pinochet ou un Reagan (pour qui tout le monde est terroriste et/ou communiste) peut être capable d’un amalgame à ce point absurde et brutal. Et cependant, une personnalité de gauche aussi connue que Tony Negri, n’hésite pas à le faire allègrement et sans vergogne, au nom de son propre simplisme réformiste, qui réduit tout en une opposition entre le multiple et l’unilatéral, comme le démontre la perle de la bourgeoisie suivante :
Perle de la bourgeoisie
« Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années en Amérique Latine. Je sais seulement que ce continent est en train de développer son activité dans une sorte de laboratoire extrême et efficace. Quoi qu’il en soit, et aussi subjectivement qu’on puisse le penser, la distance qui existe entre les piqueteros argentins et le brésilien Lula s’avère être minime : le laboratoire d’Amérique Latine se dresse de manière efficace contre l’unilatéralisme du capitalisme nord-américain global. »
« La révolte des piqueteros » – Tony Negri
Ce mélange de méthodes directement répressives et de manœuvres idéologiques liquidatrices du mouvement, acquiert une puissance toute particulière lorsque la terreur de l’Etat se combine aux idéologies qui soutiennent que les morts et les blessés de la lutte de classe auraient été causés par des luttes intestines entre lumpen-prolétaires qui se seraient entre-déchirés.
La clé de voûte de toute cette construction bourgeoise est sans aucun doute la disqualification de l’action révolutionnaire du prolétariat, qui, en opposition ouverte avec la société marchande, généralisa les expropriations, la récupération de ce dont il avait besoin immédiatement pour sa survie. Ces actions sont ensuite transformées, métamorphosées, réduites à ne représenter que des actes primitifs, perpétrés par des marginaux et par le lumpenprolétariat, s’attaquant véritablement à n’importe quoi et sans aucun critère. Opérons un bref retour sur ce qu’en dit le CCI : « (…) les assauts contre les supermarchés menés essentiellement par des marginaux, la population lumpenisée ainsi que par les jeunes chômeurs… Dans de nombreux cas, ils ont dégénéré en cambriolages d’habitations dans les quartiers pauvres ou en saccages de bureaux, de magasins, etc. La principale conséquence de cette ‘première composante’ du mouvement social, est qu’elle a conduit à de tragiques affrontements entre les travailleurs eux-mêmes comme l’illustre l’affrontement sanglant entre les piqueteros qui voulaient emporter des aliments et les employés du Marché central de Buenos Aires le 11 janvier.
Pour le CCI, les manifestations de violence au sein de la classe ouvrière (qui sont ici une illustration des méthodes propres aux couches lumpénisées du prolétariat) ne sont nullement une expression de sa force, mais au contraire de sa faiblesse. Ces affrontements violents entre différentes parties de la classe ouvrière constituent évidemment une entrave à son unité et à sa solidarité et ne peuvent que servir les intérêts de la classe dominante. »
Nous pourrions rétorquer que lors de tout processus d’attaques sociales à la propriété privée, il y a de la violence, que dans tous les cas historiques où le prolétariat a donné ce saut de qualité dans lequel s’affirment ses intérêts contre la loi de la valeur et le taux de profit, il a dû affronter les défenseurs de la propriété privée, et que ces défenseurs (police ou milices privées) ont été recrutés au sein du prolétariat par la bourgeoisie. On pourrait dire qu’en ce sens, tout processus de remise en question de l’ordre bourgeois implique des niveaux de violence entre, d’une part, ceux qui sont en faveur de la révolution et, d’autre part, ceux qui défendent l’ordre établi, que dans tous les cas, la majorité de ceux qui subissent cette violence est issue du prolétariat (il n’existe malheureusement pas d’exemple de mouvement s’attaquant exclusivement aux généraux, bourgeois, politiciens tandis que ces derniers recrutent toujours leurs corps de police ou paramilitaires parmi les prolétaires). On pourrait encore ajouter que dans tout processus révolutionnaire, la social-démocratie utilise cet argument de la « non-violence entre ouvriers » pour défendre l’ordre social et, par exemple, défendre les décisions démocratiques des ouvriers (comme cela s’est produit lors de la révolution russe, qui a impliqué une rupture violente au sein de toutes les structures formelles des ouvriers, tant dans les soviets, que dans les partis soi-disant ouvriers). Mais s’engouffrer dans une telle brèche, nous amènerait à régresser à un niveau que la vague de lutte en Argentine a dépassé, et ce depuis le début.
Le fait qu’un groupe prétendant parler au nom de la révolution prolétarienne, rabâche cette thèse de l’affrontement entre personnes issues du lumpenprolétariat, définit parfaitement de quel côté de la barricade il se situe (au-delà de l’ignorance pédante que peut refléter le fait que ceux qui produisent de telles élucubrations se positionnent explicitement en tant que spectateur extérieur et méprisant). Et c’est pire encore si l’on tient compte du fait que cette fameuse thèse est l’argument par excellence de la répression, utilisé depuis toujours par les appareils d’oppression de l’Etat, lorsqu’il leur faut se justifier publiquement.
Il nous est facile de le vérifier au regard, par exemple, du formidable coup répressif opéré à l’encontre du mouvement piquetero, le 26 juin 2002 : deux camarades assassinés, plus d’une trentaine de blessés par armes de guerre, des centaines de camarades torturés Ce jour-là, les forces de police et les forces paramilitaires de la bourgeoisie ont tiré, tué, exécuté sélectivement les militants organisateurs du mouvement piquetero, comme le démontre formellement et indiscutablement le livre du MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados) Anibal Verón Darío y Maxi, dignitad piquetera, qui a pour sous-titre : El gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda.
Voici ce qu’on peut y lire : « En ce qui concerne le coup de feu sur Darío (Santillán), il n’y a rien d’autre à comprendre si ce n’est qu’ils ont cherché à le tuer. En plus des coups de feu tirés dans tout Avellaneda, ils sont entrés dans la gare [où Darío fut fusillé dans le dos – NdR] avec comme objectif de s’assurer qu’en ressortiraient des piqueteros morts, et de pouvoir expliquer ensuite ‘qu’ils s’étaient entre-tués’. Exactement les mêmes paroles qui, sans aucune concertation, ont commencé à retentir, à ce moment même, dans les dépêches en provenance de la Maison du Gouvernement. » (page 66)
Comme le souligne ce livre, les appareils centraux de l’Etat avaient minutieusement préparé la répression, ainsi que sa parfaite « justification », en prétendant que des piqueteros s’étaient entre-tués. Le 18 juin, quelques jours à peine avant les événements, une réunion présidée par Atanasof, chef du cabinet de Duhalde, est décrite comme suit par les journalistes : « Le gouvernement national, la justice et les forces de sécurité ont aujourd’hui avancé dans la définition des directives à respecter par les juges, les magistrats et les corps répressifs, en vue de prévenir et de disperser toute protestation, comme celles des piquets ou toute autre action visant à interrompre le trafic des voies stratégiques, ont informé les sources officielles Durant ces rencontres, on a débattu de l’attitude de la Gendarmerie Nationale, de la Préfecture Navale et de la Police Fédérale, ainsi que de la couverture judiciaire de leurs actes par les juges et magistrats fédéraux lors des prochaines actions des piqueteros, qui préoccupent tant le gouvernement. Les conclusions doivent être arrêtées avant ce jeudi, journée choisie par les groupes de piqueteros pour interrompre le trafic des accès stratégiques de la Capitale Fédérale, encerclant virtuellement la métropole. » (Agence Infosic)
Et Atanasof, président officiel de cette mémorable réunion, où se prépare ouvertement l’action répressive par la coordination de toutes les forces de répression (le 26 juin sera le jour de la première action réellement centralisée de toutes les forces de répression de la Capitale Fédérale et de la périphérie[22]), va dicter aux juges et magistrats les décisions à prendre (exemplaire démonstration, si c’était encore nécessaire, de la réalité de la célèbre, idyllique, et si démocratique « division des pouvoirs » !), leur imposant même de donner une couverture aux forces répressives. Et c’est ce même Atanasof qui, sans aucun scrupule, le jour d’après, tiendra une conférence de presse, dans laquelle il va soutenir, par avance, la thèse macabre certifiant que ce sont des pauvres qui s’affrontent entre eux. Il poursuivra ensuite en expliquant que « les réunions tenues entre les fonctionnaires et les forces de sécurité ont pour but d’établir un mécanisme de coordination qui nous permette de protéger le droit des personnes à se déplacer » (c’est comme pour le droit au travail et autres droits démocratiques, à chaque fois qu’on les applique, le résultat est le terrorisme contre le prolétariat – NdR) (page 84) et insistera sur le fait qu’il faut « privilégier le droit de circuler plus que n’importe quel autre droit humain » (ce ne doit certainement pas relever du hasard si, tout à coup, alors que se déroule le mouvement piquetero en Argentine, ce « droit humain »-là devient le droit le plus important !) et expliquera encore que « dans le chaos, seul gagne le chaos », pour enfin terminer sa déclaration, en affirmant à propos des événements, qu’il s’agit « d’une sorte de guerre des uns contre les autres ».
Et il est vrai que, des exécutants directs aux hautes sphères du gouvernement, tous vont reprendre en chœur cette interprétation des massacres : le lumpenprolétariat s’entre-tue, c’est la « guerre de tous contre tous ». Le Commissaire Fanchiotti, à la tête des opérations répressives, va confirmer cette thèse, en mentant ouvertement : « A la gare, où nous ne sommes jamais entrés (…) Nous n’avions sur nous que des gaz et des balles en caoutchouc. » Par la suite, il va donner une explication, avec luxe de détails fantaisistes sur les forces à ses ordres, les présentant comme de véritables brigades volant au secours de la pauvre population terrassée par des malfaiteurs en armes : « les personnes à l’intérieur de la gare nous appelaient au secours. Un groupe assez important était entré et tirait sur un des trains qui passaient. Les gens avec lesquels nous avons pu entrer en contact et établir le dialogue ont dit qu’on avait tiré sur un train, qu’il y avait des coups de feu à l’intérieur… Il ne restait que quelques groupes, alors nous avons lancé des gaz. Une fois les gaz à l’intérieur, nous avons dû agir et sommes parvenus à secourir un tas de gens qui nous réclamaient de l’aide : il y avait là des femmes et des enfants, des femmes enceintes, d’autres personnes allongées au sol et nous avons été obligés de les faire sortir par le côté Pavón pour éviter qu’un malheur n’arrive. »
Vu ce qu’il nous raconte, il est évident que ni ce salaud, ni ses commanditaires, ni les journalistes qui reproduisirent cette version à n’en plus finir, ne savent alors que toute la scène a été filmée et photographiée dans la gare et que l’on voit Fanchiotti, tirant avec son revolver sur Darío. Mais dès le 27, même le Clarin va publier une photo où l’on reconnaît Maxi et, près de lui, encore debout, le visage assez flou de Darío, et juste à leurs côtés, se distinguent très nettement le Commissaire Fanchiotti et ses subalternes, le caporal Quevedo et les agents Acosta et Colman, pointant leurs armes sur eux (page 93). D’autres photos viendront plus tard confirmer clairement la présence de ces quatre sinistres personnages dans un lieu où ils déclarent n’être jamais entrés et où « s’entre-tuaient des piqueteros », pointant Darío de leurs armes, juste avant que ce dernier ne s’écroule au sol.
Mais avant que ces faits ne soient connus, en tout début d’après-midi, « aucun membre du gouvernement ne voulut répondre aux appels de la presse. Ce n’est qu’après avoir écouté les deux conférences de presse de Fanchiotti et s’être mis d’accord sur la version à donner, qu’il devint inutile d’insister. Dès 16 heures, les membres du cabinet national eux-mêmes téléphonèrent à des journalistes de confiance et aux rédactions des principaux journaux du pays. Tout ce remue-ménage avait pour objectif de renforcer la théorie ‘des piqueteros s’entre-tuant’, mais cette fois, la version provenait de la bouche même des ‘hautes sphères du gouvernement’… Dès la réunion du cabinet, tous s’efforcèrent de transmettre ce message en béton : ‘Les balles qui avaient tué les piqueteros provenaient des piqueteros eux-mêmes’ comme l’affirma Matzkin. Le gouvernement diffusa donc le même discours que ceux qui avaient pressé sur la gâchette. » (pages 90 et 91).
2/ Concernant le lumpenprolétariat
Généralement, les défenseurs de la version selon laquelle les pillages sont l’œuvre du lumpenprolétariat et que seule la racaille du fond du panier, des marginaux asociaux toujours prêts à s’entre-déchirer, s’attaquent à la propriété privée et aux symboles de l’Etat, s’abritent généralement derrière la protection des ministères, des congrès internationaux, des universités, des chaînes de télévision, des commissariats… Rarement, cette théorie est proférée dans la rue, car pour avoir vomi de telles falsifications, plus d’un s’est retrouvé et se retrouvera encore escraché.
C’est de cette manière que le prolétariat protège sa force et sa perspective contre tout type de disqualification et de répression des éléments les plus décidés à s’opposer à la propriété privée. Quoi de plus logique, en effet, dans tout processus d’affirmation révolutionnaire du prolétariat, que ce soient les éléments les plus désespérés par la situation qu’ils subissent sous le capitalisme, qui assument le plus ouvertement les attaques contre la propriété privée. L’opposition générale entre êtres humains et propriété privée, déterminant toute la vie des prolétaires, revêt ses formes les plus antagoniques au sein de couches particulières du prolétariat qui, bien des fois, indiquent le chemin à suivre au reste du prolétariat, assumant avant les autres, ou plus ouvertement, l’action révolutionnaire décidée. La disqualification de ces couches, parce que ce sont celles qui s’attaquent particulièrement à la propriété privée, est sans aucun doute une forme cachée ou ouverte de défense de la propriété privée et de l’Etat.
Une partie importante de ces éléments, que la social-démocratie qualifie de lumpenprolétariat, de bandits, de canailles ou de brigands,… participe de façon décisive à tout grand processus révolutionnaire. Ainsi, l’insurrection d’octobre 1917, en Russie, n’aurait pu être possible sans l’action conspiratrice de certains éléments, que les partisans du gouvernement Kerenski considéraient comme faisant partie du lumpenprolétariat. N’oublions pas non plus que la social-démocratie et la ligne officielle de Moscou ont qualifié de lumpenprolétariat ceux qui, en réalité, constituaient l’avant-garde de la révolution en Allemagne. Max Hölz et ses camarades furent épinglés comme lumpen, ainsi que les insurgés de 1918. Même le prolétariat, regroupé autour du Parti Communiste Ouvrier d’Allemagne (KAPD), fut déprécié par des ouvriers hautement qualifiés et syndicalisés, qui leur reprochaient de n’être, dans une grande majorité, que des ouvriers non qualifiés et des chômeurs. Cette constante se retrouve dans d’autres grands mouvements révolutionnaires, comme au Mexique au début du 20ème siècle, en Espagne dans les années 30, en Hongrie en 1919 et dans l’Argentine des années 1919-1921. Dans tous ces exemples, la social-démocratie, au nom des « ouvriers conscients », a qualifié de lumpenprolétariat, des secteurs qui étaient, en réalité, à la tête du mouvement révolutionnaire.
Il est vrai que Marx et Engels, à l’inverse de Bakounine ou d’autres communistes du passé, n’ont pas eu conscience de la puissance révolutionnaire de ces secteurs du prolétariat, ont souvent fait référence, en terme péjoratif, au « lumpenprolétariat ». Mais contrairement à ce qui se passe en Argentine, où ce sont ceux qui s’attaquent à la propriété privée et aux appareils de l’Etat qui se voient ainsi disqualifiés, lorsque Marx fait référence au « lumpenprolétariat », il parle de secteurs mobilisés par le bonapartisme pour la défense de l’Etat et de la propriété privée. Jamais Marx n’a utilisé ce terme pour désigner ceux qui s’attaquent à la propriété privée, ni discréditer ceux qui volent, pillent, attaquent et terrorisent le capital. Au contraire, dans ses travaux, comme dans ceux d’Engels, le prolétariat est toujours défini en opposition générale à la propriété privée et les vols, les pillages, les attaques individuelles (ou collectives) de propriétés et/ou de propriétaires privés sont considérés comme faisant partie de la guerre du prolétariat contre le capital. Et au travers de cette falsification de ce qu’est le lumpenprolétariat, nous pouvons aussi constater de quelle manière s’est constituée la religion d’Etat qu’on appelle « marxisme », et que Marx, à l’époque, dénonçait.
En Argentine, comme nous l’avons dit précédemment, cette théorie sur le lumpenprolétariat, sur les marginaux, n’a pas fonctionné et n’a été utilisée que par les agents directs de l’Etat. En réalité, ce discours n’a pas pu fonctionner pour la bonne et simple raison que la propriété privée, dans son entièreté, est apparue violemment pour ce qu’elle est réellement : source de famine pour des franges toujours plus grandes du prolétariat. Car les grandes masses prolétariennes ont assumé, dans la pratique, des actions contre la propriété privée ou s’en sont senties partie prenante. Et parce que cette lutte a assumé la forme d’un affrontement ouvert contre la propriété privée concentrée, c’est-à-dire les corps de police et les forces paramilitaires de l’Etat capitaliste.
Cependant, cette conception répugnante selon laquelle la partie la plus touchée du prolétariat appartiendrait à une autre classe sociale ou aurait des intérêts différents de ceux du prolétariat, pèse lourdement dans la balance. Bien des fois, la bourgeoisie parvient à isoler et disqualifier certains secteurs, particulièrement en période de paix sociale. C’est ce qui se passe aujourd’hui-même dans bon nombre de pays, où les pillages restent encore marginaux, et ne coïncident ni dans le temps ni dans l’espace, et où la majorité du prolétariat n’assume pas encore ouvertement cette opposition de peur de la répression, à cause des idéologies dominantes (légalisme, religions, illusions), ou à cause du mépris idéologique envers les plus pauvres qu’eux. Parce qu’en dernière instance, la bourgeoisie parvient encore à convaincre la majorité des prolétaires que le système de la propriété privée est l’unique système possible et parce que le très relatif meilleur niveau de vie de ces prolétaires, comparé à ceux qui n’ont rien, permet à ce système de maintenir cette division du prolétariat.
En réalité, dénigrer les pillages et/ou les piquets en Argentine, en les attribuant au lumpenprolétariat, poursuit précisément cet objectif de l’Etat : diviser le prolétariat. Même si, localement, elle n’a pas eu le succès escompté, cette idéologie cherche à isoler les prolétaires en Argentine du reste de leurs frères de classe dans le monde. Pour cette raison, les moyens de désinformation publique ont partout présenté les pillages en Argentine comme un produit particulier, propre à ce pays, comme de simples révoltes de la faim. Ce qui est visé ainsi, c’est que le téléspectateur du monde entier, cet idiot utile, ne se sente en rien concerné par ces problèmes, qu’il ne perçoive en aucun cas que cette « racaille » est en train de se battre contre la société qui l’exploite et l’opprime lui-aussi. Et cela marche du tonnerre : le téléspectateur ne se sent même plus prolétaire, mais consommateur, citoyen et, en tant que tel, il ne peut reconnaître son frère dans cette lointaine lutte ; il n’y voit que des désespérés, des gens dépourvus de tout, des marginaux.
Ce qui est également visé, c’est d’éviter toute contagion des prolétaires du reste du monde. Ils ne doivent surtout pas voir dans la révolte en Argentine le chemin à suivre, par la généralisation des méthodes de lutte comme les assemblées, les piquets, les escraches, les pillages, l’occupation de la rue,… Il faut qu’ils considèrent tout cela comme une réminiscence du passé. En 1917 aussi, la social-démocratie d’Europe Occidentale, tel le CCI aujourd’hui et d’autres groupes issus de cette ligne historique, en parfaite cohérence programmatique avec elle, a également nié l’existence d’une lutte prolétarienne en Russie. Tous les événements qui se sont déroulés dans ce pays, ont été vus comme quelque chose appartenant au passé, « fruit du retard typiquement russe » et du peu de poids qu’avait, selon elle, le prolétariat dans ce pays, composé de paysans et de lumpenprolétaires. Ce qui explique la grande frayeur qui s’est emparée d’elle en 1917 !
3/ A propos de la petite bourgeoisie
Et de la même manière, on a conféré à la petite bourgeoisie une part décisive dans le mouvement, notamment dans la violente explosion prolétarienne des journées du 19 et 20 décembre 2001.
En effet, en falsifiant les événements et en déformant les concepts, on a attribué aux « classes moyennes » la responsabilité des assemblées, des cacerolazos, d’un bon nombre de manifestations violentes, et même le rôle principal dans la rue durant ces journées décisives. De plus, à l’inverse de la fable mensongère concernant le lumpenprolétariat, uniquement colportée par les agents de l’Etat, la bourgeoisie est parvenue à ce que cette théorie soit répétée et propagée par le mouvement lui-même, y compris en Argentine. Ainsi, il s’est trouvé des piqueteros faisant partie des assemblées les plus combatives, telle que la Coordinadora Anibal Verón, allant jusqu’à soutenir que les manifestations du 19 décembre était l’œuvre des classes moyennes, à laquelle ils se seraient pliés, à contrecœur.
Comment la bourgeoisie est-elle parvenue à convaincre les piqueteros, ou les quelques ouvriers d’usines qui existent encore en Argentine, que la composition des assemblées de la Capitale Fédérale était petite-bourgeoise ? Comment est-il possible qu’une ville entière soit composée de petits-bourgeois ?
Il est encore plus difficile de comprendre un tel miracle si nous prenons comme exemple la composition-type d’une assemblée : une dizaine de jeunes des deux sexes qui ne sont jamais parvenus à trouver du travail, trois jeunes à l’emploi précaire, deux étudiants, l’institutrice du quartier, deux chômeurs ex-employés de banque, un autre ex-ouvrier, trois fonctionnaires publics, le boulanger et la boulangère du coin, un livreur de pizzas, deux infirmières, un professeur de philosophie, un autre de mathématique, deux caissières de grand magasin, trois ou quatre vendeuses, un jeune gars avec en poche son diplôme d’avocat tout frais, une femme de ménage, une psychologue, deux soubrettes qui travaillent dans un hôtel, un guitariste, un peintre, un plombier et un tas d’autres personnes qui bossent de temps en temps, selon « ce qui vient »[23].
Seule la puissante phase de terrorisme ouvert de l’Etat, subie par les camarades de ce pays et la rupture historique avec le programme de la révolution, phénomène mondial, peut avoir provoqué une telle inconscience de classe : le prolétaire ne se considère même plus comme prolétaire. Ceci est aujourd’hui valable dans le monde entier et constitue, comme on le voit, le plus grand obstacle à notre propre organisation en classe, en force internationale.
Ce n’est pas ici le lieu pour discuter conceptuellement des termes « petite bourgeoisie » ou « classe moyenne ». Nous ne désirons pas non plus convaincre le « milieu » qui s’autoproclame marxiste, en Argentine et ailleurs, de l’absurdité qui consiste à qualifier tout ce monde et même la Capitale Fédérale de « classe moyenne ». Nous dirons simplement que la classe qui a le plus intérêt à gonfler réellement ou idéologiquement un ensemble de secteurs sociaux intermédiaires, c’est évidemment la bourgeoisie. Depuis toujours, la contre-révolution a tenu à conférer à la petite bourgeoisie une force qu’elle n’avait ni ne peut avoir. Ainsi, durant le 20ème siècle, quasi tous les événements importants dans le monde ont été attribués à la petite bourgeoisie. On a prétendu que le démocratisme était petit-bourgeois, que le fascisme était un produit des classes moyennes, que la lutte nationaliste était petite-bourgeoise, que le stalinisme était du bureaucratisme petit-bourgeois, que le réformisme était petit-bourgeois, etc. En réalité, la démocratie est l’essence même de la dictature du capital et fascisme, nationalisme, réformisme, stalinisme constituent des formes ou des aspects particuliers de cette dictature. Ils représentent différentes expressions des intérêts de la bourgeoisie et les forces sociales qui y correspondent sont, sans aucune exception, des forces du capital. Mais on a aussi prêté à la petite bourgeoisie l’impatience révolutionnaire, le radicalisme social, la lutte directe et violente, le rejet du parlementarisme et du frontisme, la conspiration, etc. alors qu’il s’agit en général d’expressions de recherche, d’affirmation et de luttes du prolétariat dans son difficile chemin de réaffirmation en tant que force historique. Des phénomènes plus complexes, où bien des fois la bourgeoisie canalise la force prolétarienne et la transforme en lutte inter-bourgeoise, se sont vus catalogués de phénomènes petits-bourgeois. Ainsi, les mouvements guérilleros ont été épinglés en tant que produits de la petite bourgeoisie, alors qu’en de nombreuses occasions, il s’agissait de tentatives prolétariennes de lutte, même si, dans leur majorité, elles ont fini par être récupérées et/ou dirigées par des forces bourgeoises et conduites vers le militarisme (appareil contre appareil), le nationalisme et le réformisme armé. Cette occultation sert à cacher la contradiction réelle entre la lutte prolétarienne et son encadrement et sa liquidation par les forces bourgeoises populistes, nationalistes. Plus encore, la majorité des partis « communistes », trotskystes, et nombre de ceux qui s’auto-désignent libertaires… ont théorisé qu’en général la violence minoritaire, le terrorisme contre les propriétaires privés serait un produit de l’« impatience » de la petite bourgeoisie. Comme si, en plus de tout, le prolétariat devrait être patient !
Dans tous ces cas, la petite bourgeoisie est gonflée artificiellement et on lui attribue une force sociale qu’elle n’a pas ni ne peut avoir. En effet, la petite bourgeoisie, parce qu’elle n’a pas de projet social propre, n’est capable d’engendrer que des mouvements partiaux et oscillants entre les deux classes antagoniques déterminantes qui, pour cette raison même, se révèlent être peu importants. Dans les périodes où le prolétariat vise à transformer une crise sociale ouverte en crise révolutionnaire, ces mouvements se brisent et les secteurs prolétarisés par la crise tendent à s’aligner du côté du prolétariat révolutionnaire et à participer à ce mouvement, tandis que d’autres secteurs, effrayés par la révolution, ont tendance à s’aligner sur la réaction. En dehors de ces moments, les fameuses « couches moyennes » jouent un rôle de tampon intermédiaire qui sert de protection au capital, tout comme lui sert de protection, l’idéologie qui vise à gonfler le rôle de ces couches et réduit le prolétariat à l’ouvrier industriel. Mais dans un cas comme dans l’autre, que ce soit pour assurer la paix sociale ou pour affronter le prolétariat insurgé, ce qui a le plus de poids et sert le plus au capital, ce ne sont pas ces si « télé-visiblement » fameux petits-bourgeois, mais bien ce que pensent et font les « prolétaires », dominés par les idées de leurs exploiteurs. Ainsi, ce n’est pas grâce aux idées de la petite bourgeoisie que la démocratie avance ou que s’impose un vote démocratique contre l’action décidée de minorités prolétariennes (dans les assemblées, soviets, usines occupées, shoras, conseils, etc.), c’est grâce au fait que la démocratie de la société marchande parvient à se réimposer et que, par conséquent, l’idéologie bourgeoise de la démocratie domine « les prolétaires ». La démocratie n’est pas seulement une idéologie ou une simple mystification bourgeoise pour les prolétaires. Elle est reproduite dans les rapports sociaux capitalistes elles-mêmes : ce substitut, ou si l’on veut, ce consolateur de communauté qu’est la démocratie, continuera à séparer tout en unifiant fictivement, jusqu’à ce que la lutte prolétarienne fasse éclater les relations marchandes qui lui donnent vie. L’essentiel n’est pas la question de la petite bourgeoisie, mais le rapport de force : la reproduction du capital et sa négation révolutionnaire. C’est pour cela qu’il est absurde de parler de trois, quatre ou cinq classes, alors qu’en dernière instance, les projets viables ne sont que deux : le capitalisme et le communisme.
La gigantesque inflation idéologique autour du mythe de la petite bourgeoisie cherche précisément à cacher cette opposition générale. La bourgeoisie s’en sert, non seulement pour diviser et leurrer le prolétariat quant à ses forces, mais aussi pour dénaturer sa recherche d’une issue révolutionnaire, son programme historique.
La théorie des classes moyennes (comme celle qui prétend que marginaux et lumpenprolétariat forment une autre classe ou oscillent entre les classes) provient, au fond, des intellectuels bourgeois (universités, partis politiques de droite comme de gauche, syndicats) et est martelée à n’en plus finir au prolétariat (tous les médias utilisent cette théorie comme un fait advenu). C’est à cela que sert la fameuse théorie kautskyste/léniniste de l’idéologie apportée de l’extérieur au prolétariat par des intellectuels bourgeois. Aujourd’hui encore, ces mêmes intellectuels bourgeois arrivent de l’extérieur, et lui disent : « Tu n’existes plus en tant que classe, ta classe a de moins en moins d’importance ». Partout dans le monde, des livres sont écrits en guise « d’adieu au prolétariat ». Et effectivement, si les chômeurs ne sont plus considérés comme des prolétaires, si on prétend que les travailleurs des services sont des petits-bourgeois, si on dit la même chose à propos des enseignants, des petits indépendants des villes, des banlieues et des campagnes (qui, dans leur grande majorité, sont des salariés, à peine dissimulés), de la caissière du supermarché ou de la vendeuse de magasin, alors toutes les théories sur la disparition du prolétariat seraient réelles en Argentine, puisque, tout le monde le sait, les travailleurs du secteur industriel sont de moins en moins nombreux. Mais la même chose peut également être soutenue dans tous les pays du monde, car, depuis des décennies, on constate une augmentation relative du fameux secteur des services face au secteur industriel (ce phénomène s’est d’abord produit dans les pays du continent américain, avant d’arriver dans les pays européens, à cause de la vétusté d’une industrie qui n’a pas été détruite, durant ce qu’on a appelé la seconde guerre mondiale). Si la relative diminution du nombre de travailleurs industriels par rapport aux travailleurs des services (publics et privés), aux emplois précaires et aux chômeurs réduisait effectivement le prolétariat, la bourgeoisie serait alors parvenue à réaliser son rêve historique : éliminer progressivement son ennemi de toujours, le ramener à son expression minimum et réduire progressivement les contradictions sociales.
Bien que dans la réalité, il y ait plus de travailleurs dans les services (publics et privés) que dans l’industrie, ou plus d’emplois précaires et de chômeurs que jamais dans l’histoire, cela ne diminue en rien les contradictions du capital. Bien au contraire, elles n’en sont toutes que plus aiguisées (car cela traduit aussi une violente manifestation des difficultés du capital dans sa folle course à la valorisation) et il est logique que la théorie de la diminution du prolétariat continue à prospérer puisqu’elle constitue la clé de la domination bourgeoise, tout comme il est logique qu’elle continue à constituer la quintessence de toutes les sciences sociales bourgeoises.
Rien de plus logique dès lors que d’« expliquer » ce qui s’est passé en Argentine en fonction de classes moyennes et du lumpenprolétariat : cela permet d’affirmer la théorie de la disparition historique du prolétariat. Et il est tout aussi logique que nous, prolétaires, recevions cette négation idéologique comme une agression, une répression de notre être et que nous la replacions dans le cadre historique qui lui correspond, à savoir, avec l’ensemble des idéologies qui, depuis toujours, théorisent que le capitalisme conduit à une société de moins en moins contradictoire, de moins en moins antagonique. C’est bien là la vieille théorie de la suppression progressive des contradictions mortelles du capitalisme, qu’on appelle aujourd’hui post-moderne et qui théorise la fin de l’histoire. En réalité, il s’agit du manifeste historique de la bourgeoisie en pleine catastrophe sociale.
Mais malheureusement, nous ne pouvons pas prétendre qu’en tant qu’idéologie, cette théorie ne fonctionne pas. Dans des périodes de paix sociale, elle marche à merveille (toutes les théories bourgeoises, et en particulier les sciences sociales, tirent leurs conclusions théoriques, en toute logique, de l’idéalisation de ces moments) : le prolétariat ne manifeste pas sa force en tant que classe, tout semble coexister paisiblement sur l’air du « chacun se démerde comme il peut », et les protestations de chaque catégorie sociale sont totalement séparées les unes des autres. La théorie du prolétariat part (en toute logique) non du monde idéal de la conciliation des classes, mais de la rupture sociale et plus précisément de la révolution communiste, du processus de destruction totale de cette société, contenu en elle. C’est pour cela que le prolétariat ne se reconnaît pas dans telle ou telle catégorie sociale (les révolutionnaires n’ont aucun intérêt à faire de l’économie ou de la sociologie, leur intérêt se situe dans la destruction de l’économie et de la société bourgeoise), ni dans l’une ou l’autre couche de travailleurs ; il se reconnaît en tant que classe[24], dans sa contradiction avec le monde marchand, dans sa lutte, dans sa constitution en force. Les classes ne se définissent pas en soi, sociologiquement, pour agir ensuite ; elles se définissent dans leur pratique, dans leur opposition, dans la lutte.
Nous ne voyons aucun intérêt à expliquer ici pourquoi la maîtresse d’école, le boulanger du coin, l’étudiant, le chômeur, l’employé de banque, la caissière de supermarché, l’« exclus », la femme de ménage,… sont des prolétaires (ils ne le sont d’ailleurs pas en soi, mais dans leur opposition à la propriété privée – ils sont privés de la propriété des moyens de production – qui les pousse à s’associer et à lutter contre l’ordre établi). Au risque de nous répéter une fois de plus, reprécisons que les communistes ne considèrent pas comme prolétaire, quiconque réalise une activité productive déterminée, à l’image des organisations de la gauche bourgeoise, mais bien celui qui vit privé de la propriété des moyens de production et qui, pour survivre, est contraint de trouver des acheteurs pour sa force de travail ou/et alors, d’exproprier la propriété privée qui le condamne à crever de faim. Nous ne considérons en rien le prolétariat comme une classe sociologique de cette société. C’est, au contraire, la classe qui se constitue elle-même, au fur et à mesure qu’elle assume son opposition vitale à la propriété privée des moyens de production, c’est elle qui développe cet antagonisme jusqu’à se constituer en force sociale destructrice de la société bourgeoise. C’est pourquoi, pendant que les sociologues, les économistes, main dans la main avec les syndicats et les partis du capital, théorisent la disparition progressive de l’antagonisme social et du prolétariat, nous affirmons pour notre part l’intensification de toutes les contradictions du capital et la prolétarisation d’une masse toujours croissante d’êtres humains, entraînés dans un inéluctable processus d’exacerbation de la misère relative. Concrètement, l’augmentation du nombre de chômeurs, du travail précaire, des « emplois poubelles » ou des pseudo-employés financés par le gouvernement ou les ONG, par rapport au nombre de travailleurs considérés comme industriellement rentables, ne diminue pas le nombre de prolétaires, mais met plutôt en évidence l’absurdité du monde du travail, le fait que ce système social est de plus en plus antagonique aux nécessités humaines. Mais en plus, en Argentine, comme dans bon nombre de pays, l’augmentation de la misère sociale de la masse des exclus met à nu le fait qu’un ensemble de couches sociales, aveuglé par l’illusion de la petite propriété juridique, sont en réalité des prolétaires déguisés, puisque quelle que soit l’illusion dont ils se bercent, leur supposée propriété n’est que formelle. La propriété réelle revient au capital financier et/ou aux grandes sociétés. Ainsi des centaines de milliers de pseudo-commerçants, de pseudo-indépendants de la ville et de la campagne, travaillent en réalité pour un patron ou une société anonyme, même si le rapport salarié est juridiquement caché, pour éviter à la bourgeoisie de payer les cotisations sociales et obliger l’ouvrier à assurer lui-même le maintien des moyens de production et de sa force de travail. Le progrès en Argentine, comme ailleurs, c’est que de plus en plus de patrons ne contractualisent de nouveaux commissionnaires, garçons de café, livreurs de pizzas, etc., que si ceux-ci payent eux-mêmes leurs cotisations en tant qu’indépendants ! Il reste à ajouter que les statistiques et la sociologie classent ensuite ces travailleurs comme « les nouvelles classes moyennes urbaines » !
Il est vrai que si nous considérons le mouvement en Argentine tel que le décrivent les médias (et non au travers des éléments de force qui le déterminèrent, comme souligné dans notre article antérieur), nous pouvons constater que se sont côtoyés, dans certaines assemblées ou cacerolazos, autant de bourgeois en déchéance que de petits propriétaires en faillite. Et bien entendu, ces secteurs peuvent influencer le mouvement et ont, de fait, poussé le mouvement dans le sens légaliste, citoyen, démocratique, en visant ainsi à ce qu’il ne rompe pas la légalité bourgeoise, ne s’attaque pas à la propriété privée. Mais la prolétarisation réelle de petits et moyens propriétaires, ainsi que la force de la politique autonome du prolétariat (dans les piquets, les escraches, les pillages,…) a fait que bon nombre d’entre eux se sont senti attirés par le mouvement et que la rencontre dans la rue a permis la réaffirmation et la généralisation de l’attaque à la société capitaliste et non la défense de « leur » propriété privée. Il est tout aussi vrai que certains bourgeois et petits-bourgeois ont participé à des cacerolazos, malgré leur dégoût séculaire pour « ces sales nègres qui coupent le trafic », qu’on en a vu se spécialiser dans des cacerolazos pacifiques ou exclusivement organisés par des petits commerçants. Cette conception, qui s’affronte bien entendu à la rupture prolétarienne (comme nous le verrons dans le chapitre suivant), tente d’isoler, d’expulser et de réprimer la généralisation de l’action directe qui, dans la pratique, s’oppose à l’ordre bourgeois. Nous réitérons, à ce propos, ce que nous avons déjà dit dans la première partie du texte, totalement à contre-courant de ce qui se dit habituellement. Le problème ne se situe pas dans la participation de petits-bourgeois au mouvement, il réside dans l’idéologie bourgeoise, drainée par les prolétaires eux-mêmes, dans leur méconnaissance de leur programme de classe. Et nous affirmons (réaffirmons et confirmons), totalement à contre-courant, que les classes moyennes ou petites-bourgeoises n’ont joué aucun rôle décisif dans le mouvement de 2001/2002 en Argentine. Ils ne peuvent d’ailleurs pas le faire ! Le cas argentin confirme l’impuissance sociale des classes moyennes et l’irrémédiable tendance à la polarisation mondiale entre défenseurs de l’ordre et prolétariat révolutionnaire.
Le mépris que nous portons à la petite bourgeoisie, quant à sa capacité sociale, ne signifie absolument pas que la mentalité « petite-bourgeoise » (en réalité bourgeoise) n’a eu aucun poids lors de toutes ces manifestations et que le légalisme, le démocratisme, la citoyenneté furent dépassés. Bien au contraire, comme dans tout grand mouvement prolétarien, le nationalisme a revêtu un poids contre-révolutionnaire fort puissant, et le légalisme, le gestionnisme, le politicisme ont été et continuent d’être de puissantes idéologies bourgeoises présentes dans le mouvement. Mais il serait absurde de s’imaginer que l’ouvrier d’usine, ce véritable héros idéal du militant de la gauche bourgeoise (autrement dit, « le prolétaire » selon la définition social-démocrate, staliniste, trotskyste et libertaire), se soit subitement libéré de ces idéologies bourgeoises. Les petits drapeaux argentins et même les maillots de l’équipe nationale de football émaillaient les rues de tous les quartiers, pas seulement celles des quartiers considérés par nos ennemis comme appartenant à la « classe moyenne », mais également celles des quartiers ouvriers, des bidonvilles, des banlieues, des villages et des villes de province. Il en va de même concernant les illusions présentes sur les solutions politiques ou l’économie alternative. Contrairement au mythe de la gauche bourgeoise, l’extraction de classe n’a jamais constitué une garantie politique : les armées et les forces répressives du monde entier sont constituées d’ouvriers soumis au pouvoir central bourgeois. Plus encore, au 20ème siècle, ce sont les ouvriers des grandes usines, parfaitement organisés par l’Etat en syndicats et en partis, qui ont constitué les forces de maintien de l’ordre bourgeois, de défense du travail et de l’économie nationale (comme en Russie, sous le stalinisme, ou sous le fascisme, le nazisme, ou durant la politique des grands travaux aux Etats-Unis ou encore sous le péronisme, le castrisme,…), véritables objets de manipulation de l’Etat, contre tout type de protestation. A tel point que, pour obtenir un poste de travail dans une usine, il fallait et il faut encore, aujourd’hui, dans de nombreux pays, posséder sa carte de parti ou de syndicat, garantie de notre soumission. Le terrorisme d’Etat, maintenu à grande échelle, essence même de la démocratie, a besoin, pour se développer, de l’adhésion aux discours dominants des grands, moyens et petits-bourgeois, mais aussi de celle de nombreux ouvriers, organisés dans des partis ou des syndicats. Et précisément en Argentine, le terrorisme d’Etat s’est consolidé et développé contre les minorités actives du prolétariat des années 1960-1970, sur base du silence complice de tous les bénéficiaires de ce régime (grands, moyens et petits-bourgeois), mais également de larges secteurs ouvriers, malgré une baisse sensible de leur pouvoir d’achat (le vandorisme comme puissance ouvrière syndicalisée[25]– c’est-à-dire transformée en force d’Etat – a joué un rôle prépondérant dans la répression historique du prolétariat révolutionnaire) : non seulement le nombre de syndiqués n’a pas diminué, mais il n’a fait qu’augmenter durant la pire période de terrorisme d’Etat. L’idée selon laquelle l’ouvrier travailleur, parce qu’il provient de l’usine, serait plus proche du soleil de la vérité, et que le « prolétaire », par le simple fait de l’être, lutterait en faveur des intérêts de la révolution sociale, ne constitue rien d’autre qu’une vulgaire apologie, à peine dissimulée, de ce dont le capital a besoin pour se valoriser : le travail. N’oublions pas que, si pour la social-démocratie être prolétaire est une sorte d’honneur, pour le prolétariat, être travailleur productif est un véritable malheur. Le prolétariat n’est pas la réalisation de l’être humain, mais bien sa perte totale.
Il est donc complètement absurde d’attribuer à la petite bourgeoisie la force du mouvement, ses faiblesses ou même ses drapeaux et mots d’ordre, le plus souvent ouvertement bourgeois, comme le drapeau argentin. Ce qui a été décisif, c’est l’opposition de toujours entre bourgeois et prolétaires, entre d’une part, les défenseurs de l’ordre et de l’Etat et, d’autre part, ceux qui savent qu’ils n’ont rien d’autre à perdre que leurs chaînes, organisent des assemblées, des escraches, des pillages et s’attaquent aux centres de répression et d’administration du capital et de l’Etat et frappent aussi sur des casseroles !
4/ Concernant les cacerolazos
La bourgeoisie a fait tout ce qu’elle pouvait pour essayer d’opposer aux manifestations de protestations prolétariennes, et en particulier à ses formes les plus radicales (piquets, escraches, attaques à la propriété privée), des manifestations civiques, démocratiques, pacifiques, légales ; elle a cherché à disqualifier les premières et présenter les secondes comme la seule voie à suivre.
Cette tentative bourgeoise pour canaliser, dans le cadre de l’Etat, les événements qui se déroulent dans la rue et que ne parviennent pas à enrayer les forces politiques traditionnelles (partis, syndicats, ONG,…), relève de l’abc de toute domination de classe. Etant donné le discrédit absolu des appareils centraux de l’Etat (et des forces politiques classiques d’opposition et de canalisation), et la crise généralisée, des habituelles formes de délégation et de représentation, cette sortie massive dans la rue était, par conséquent, inévitable. La bourgeoise, incapable de stopper le mouvement, a dès lors tout fait pour empêcher que la rupture avec la démocratie ne soit totale, et faire en sorte qu’un brin de « civilité », de respect des règles du jeu démocratique soient encore présents dans le comportement d’une bonne partie de ceux qui occupaient la rue. Tout ce qui participe habituellement à la fabrication de l’opinion publique s’est alors mis en branle, plaçant sous les feux des projecteurs l’apologie d’une forme particulièrement civilisée de protestation : le cacerolazo citoyen et pacifique, seule « protestation » admissible, forme par excellence de légalisation des manifestations, en opposition totale au mouvement du prolétariat qui assumait de plus en plus la lutte violente. La télévision mit l’accent sur la participation de célébrités de la classe dominante et du monde du spectacle, manifestant, comme de bons et braves citoyens, leur petite casserole à la main. On ne pouvait rêver de meilleur complément à la campagne généralisée, orchestrée en vue de diviser le mouvement en différentes couches sociologiques, de liquider l’unification prolétarienne : appuyer la propagande opposant piquets et cacerolazos et attribuer à la fameuse « classe moyenne » un rôle prépondérant dans le mouvement. La gauche bourgeoise a, de son côté, contribué à cette opération, en reprenant la légende selon laquelle le mouvement des cacerolas était né à l’époque d’Allende, en tant qu’expression « de droite ». Ils furent malheureusement peu nombreux en Argentine à élever la voix pour affirmer que le gouvernement d’Allende était un gouvernement bourgeois qui avait affamé et réprimé le prolétariat, et ils furent moins nombreux encore à se souvenir qu’attribuer l’apparition de ce genre de manifestations aux années ‘70 au Chili constitue un énorme mensonge (il suffit de regarder les cacerolazos des prolétaires prisonniers un peu partout dans le monde). Pourtant cette campagne de division a pénétré le mouvement. Ainsi, des groupes de piqueteros, impliqués dans les affrontements de rue de décembre, ont souligné n’avoir pris la « casserole » qu’à partir du 19 décembre et s’être pliés à la manifestation, sans aucune conviction, car ils la considéraient dominée par la classe moyenne.
En réalité, il n’y eut pas plus de petits-bourgeois, agissant en tant que tel dans le mouvement, que de cacerolazos purs, si ce n’est ceux artificiellement créés de toutes pièces et gonflés par les médias, en vue de tout embrouiller. Cette image de l’honnête petit-épargnant, bien habillé et dégoulinant de gentillesse, victime du corralito, apparaissant à la télévision, armé de sa petite casserole, sans aucune intention de briser des vitres ou de faire des escraches, représente le protagoniste par excellence du cacerolazo, porté aux nues par les médias, mais qui n’existe que pour la télévision. Les médias, et en particulier le groupe Clarin, vont atteindre des sommets en exploitant « la mort du premier cacerolero », en novembre 2002 : en réalité, il s’agissait d’un pauvre homme qui, devant l’impossibilité de retirer les 100.000 dollars qu’il avait épargnés (corralito), s’écroula au sol, victime d’un infarctus.
Le désaveu des prolétaires les plus combatifs pour ce genre de gentil petit citoyen est parfaitement logique, ce qu’illustrent ces formules fleuries : caceroleros las que me cuelgan, que l’on peut traduire par « caceroleros, de mes deux ! ».
Donc, mis à part cette image médiatique, élaborée de toutes pièces et spectaculairement gonflée, il n’existe pas de cacerolazo pur. Un peu partout, les mouvements des cacerolas font inséparablement partie de la mobilisation prolétarienne, de l’activité organisée des assemblées, de l’activité plus ou moins spontanée, mais toujours organisée à un niveau minoritaire, qui s’est développée dans les différents quartiers, au même titre que les jets de pierres, les cocktails molotovs, les escraches, les blocages des routes, les manifestations,…
Cela ne veut pas dire que la bourgeoisie (non seulement l’un ou l’autre bourgeois venu s’encanailler dans une assemblée, mais aussi les différentes forces politiques de l’Etat) n’a pas tenté de séparer par tous les moyens possibles le bon grain de l’ivraie, le bon citoyen de ce « sale nègre qui coupe le trafic », « l’honnête petit-épargnant » de cette tête crépue et hirsute, sale et fainéante, et qui plus est, « allergique au travail ». Mais elle a surtout insisté pour marquer clairement l’opposition entre la bonne manifestation, représentée par le cacerolero légaliste qui s’effraie à l’idée d’employer la force, et celle où l’on canarde les banques de pierres, coupe le trafic et/ou pratique des escraches. Mais à part quelques rares exceptions, ressassées à n’en plus finir par les médias, la bourgeoisie n’est jamais parvenue à ce que les mouvements des cacerolas fonctionnent par les voies légales et prévues par l’Etat. Les pompiers sociaux en tout genre n’ont pas réussi à faire des cacerolazos ce petit spectacle gentillet dont rêvait la bourgeoisie : partout, le prolétariat a rompu les canaux prévus et affirmé sa violence de classe.
Poursuivons encore par quelques extraits, tirés d’un article assez représentatif de la lutte de la bourgeoisie pour canaliser les cacerolazos, qui met nos propos en évidence. Cet article dont le titre est « La non-violence est une force », publié le 27 janvier 2002 et signé par un certain Homero F., a été reproduit sur de nombreux sites Internet, traitant de ce thème (voir à ce propos, Caceroleando.fateback.com). Voici ce qu’on peut y lire : « Il ne fait aucun doute que le sujet le plus récurrent de ces jours derniers concernant les manifestations est celui des incidents qu’elles produisent. Dans le programme télévisé ‘Au-delà des Nouvelles’, il a été fait référence à une étude indiquant que plus une manifestation se déroule de façon pacifique, plus grande est son efficacité : nous devons dès lors nous demander à qui profite la violence. Le 25 de ce mois, on a observé que la police réprimait spontanément les ‘caceroleros’ qui rentraient chez eux, suite au déluge qui s’est abattu sur la Capitale Fédérale et le Grand Buenos Aires (personne ne peut se permettre de tomber malade par les temps qui courent). J’ai entendu aujourd’hui, sur Cronica TV, les déclarations des officiers hospitalisés suite aux agressions subies lors du ‘Cacerolazo’ national. Ils déclarent avoir vu des hommes, les sacs remplis de bouteilles et de pierres, les distribuant aux agresseurs. Ce que chacun se demande alors, c’est pourquoi n’a-t-on pas emprisonné ces personnes et évité ainsi les accidents ? La réponse est toute simple, parce que cela ne les arrange pas. Il est préférable de laisser ces infiltrés, faire de la provocation, pour ensuite réprimer l’ensemble des manifestants, rendre opaque l’expression populaire et faire en sorte qu’il y ait moins de gens la prochaine fois, en leur inculquant la peur. On peut donc dire que nous avons affaire à des terroristes. Le jour où nous parviendrons à faire un ‘cacerolazo’ sans pierres ni cocktails molotovs, sans gaz ni balles en caoutchouc, nous parviendrons à ce que la fois suivante, les gens n’aient plus peur et participent à la manifestation, et, ainsi de suite, jusqu’à réussir à ce qu’y participent des centaines de milliers de personnes. »
Comme on peut le constater, ce qui préoccupe le plus le bonhomme, ce ne sont pas tant les cacerolazos et les manifestations en général, dans cette Argentine prise de convulsions, suite à la crise et la lutte violente du prolétariat, mais c’est précisément la lutte elle-même. Notez bien que sa grande préoccupation, c’est de parvenir un jour à un mouvement de cacerolas pur, dans lequel il n’y aurait ni pierres ni cocktails molotovs… On peut également souligner que ses critères de vérité sont ceux de la télévision. Il est dès lors logique que, contre la rupture prolétarienne et pour parvenir à réaliser cet impossible rêve d’un cacerolazo dénué de toute rage prolétarienne, il propose de collaborer avec la police et/ou de former une police dans chaque assemblée, et/ou encore de collaborer à l’œuvre policière qu’assume la télévision. En bon citoyen, il a son propre flic dans la tête.
« Compte tenu de tout cela, notre préoccupation principale doit être celle de freiner les violents. Les formes pour y parvenir n’ont rien d’excentrique, on peut créer des commissions de sécurité des Assemblées, qui ont comme but de signaler les agitateurs, de façon à ce que la police puisse les arrêter et, s’ils n’y arrivent pas, ces commissions seront chargées de leur retirer pierres, bouteilles, etc. et/ou de les montrer à la télévision. Bien entendu, ceci n’a rien de démocratique et équivaut à se faire soi-même justice, mais, si les autorités ne font rien, il ne nous reste pas d’autre remède que celui d’agir pour notre propre sécurité. En y réfléchissant bien, ce serait agir en légitime défense.
Une autre chose qu’il est possible de faire pour éviter toute violence future, c’est de nous organiser. Il est nécessaire que nous laissions la spontanéité de côté pour commencer à penser à et à débattre de ce que nous voulons construire avec nos voisins. Si nous laissons s’accumuler la colère, nous allons devenir fous et faire des choses insensées. Nous ne pouvons plus permettre de laisser couler le sang. Si nous parvenons à nous contrôler nous-mêmes, nous pourrons reconquérir le pays. »
Comme on le voit, ni le terrorisme d’Etat, la télévision, les partis politiques, ni les mouchards en tout genre, ne sont parvenus à faire du cacerolazo, cette manifestation citoyenne rêvée, à l’image de la classe moyenne, qu’ils se sont évertués à créer. Mais cette tentative de récupération/liquidation de la lutte prolétarienne concernant les cacerolazos n’est pas un phénomène isolé. On a tenté de faire exactement de même avec les piquets. Dans le chapitre suivant, nous nous pencherons sur les formes qu’ont revêtu les tentatives de liquider l’autonomie du prolétariat, notamment en ce qui concerne les piquets. Ce qui mettra d’autant plus en évidence que le débat ne se situe pas entre marginaux et classe moyenne, comme on a voulu nous le faire croire, mais relève plutôt de cette vieille contradiction entre la puissance de la lutte prolétarienne contre l’Etat et les formes que prend sa récupération.
5/ Sur les piqueteros
Dans notre texte antérieur, nous avions souligné que les piquets s’organisaient et/ou agissaient pratiquement « en rupture avec tous les partis parlementaires ». Un camarade a tenu à nous répondre à ce sujet. Voilà ce qu’il en dit :
« Pour ce que j’en sais, il y a à l’intérieur du mouvement un nombre incalculable de groupes et/ou de fractions qui adhèrent idéologiquement à des partis ou à des organisations démocratico-parlementaristes.
Lire à ce propos le livre intitulé : ‘Le who is who des groupes PIQUETEROS’, dont est issue la liste suivante, à laquelle j’ajoute quelques commentaires :
• Raul CASTEX : Dirigeant combatif des retraités, deux années de prison pour pillage, membre du P.O. (Parti Ouvrier).
• D’ELIA : du C.C.C (Courant Classiste et Combatif). Dirigeant du parti le plus grand et le plus massif… 3 millions et ½ d’adhérents. Structure à prédominance péroniste. D’Elia fait partie du système et appelle à la création d’un Front.
• De GENNARO : du CCC-CTA (Courant Classiste et Combatif – Centrale des Travailleurs argentins). En dehors du système. Ne formule aucun appel à quoi que ce soit. Est dirigeant d’un syndicat formel/parallèle (de fait, c’est un front : la CTA). Se revendique du péronisme de centre-gauche. (Surnommés « les poussins », car toujours vêtus de jaune).
• Marta MAFFEI : CTRA (Centrale des Travailleurs Révolutionnaires Argentins). En faveur de « la grève solidaire ». Dirigeante d’un syndicat formel mais respecté. Elle est fille d’un anarchiste… N’importe qui peut secréter un furoncle !
• Marta GARRIO : Ex-députée radicale, fondatrice de l’ARI, en tête de liste aux élections. Milite pour « un autre 20 décembre ! ».
• Polo OBRERO (P.O.) : Groupe appartenant, comme son sigle l’indique, au P.O. (Parti Ouvrier) (Surnommés « les colombes », car tous vêtus de blanc).
• MOUVEMENT NATIONAL de LIBERATION : correspond à l’ex-PC et brasse beaucoup d’argent.
• MOUVEMENT de la PATRIE LIBRE : l’autre ligne du PC. Se fait appeler le « mouvement CHAVISTA » (Chavez).
• El MATE : constitué d’ex-ERP (Armée Révolutionnaire du Peuple), d’ex-PRT (Parti Révolutionnaire des Travailleurs), d’ex-MAS (Mouvement pour le Socialisme). Petit groupe, principalement trotskyste. Prêts à la bagarre, ils sont proches du :
• GROUPE ANIBAL VERON : ceux-là sont effectivement des chômeurs sans partis. Leur nom provient d’un martyr de Salta, bien qu’on dénombre déjà plus de trois morts dans leur rang (cf. le massacre du pont Avellaneda).
• ZAMORA : le seul homme politique que les piqueteros laissent passer, le seul également qui puisse aller dans la rue et voyager en métro. Ex-député du MAS et deuxième sur les listes électorales.
• Groupe MARTA RODRIGUEZ : son dirigeant se nomme Dirispeche FERNANDEZ, appartenant au Groupe QUEBRACHO, ex-Montonero. Ex-SIDE (Service Secrets de l’Etat). Nationaliste. Ne participe pas aux élections.
• AGRUPACION SIDE : connus comme infiltrés camouflés ou agents provocateurs.
• ‘Los PIQUE-TRUCHOS’ ou encore ‘les autopisteros’ : agents au service de la direction péroniste, payés 30 $ + le repas + 1 « pétard », pour agir à la demande, opérant de faux pillages.
• MOUVEMENT INDEPENDANT. JEUNESSE ET CHOMEURS : pour l’instant, toujours pas clair.
• MOUVEMENT des CHOMEURS ‘TERESA VIT’ : péroniste de centre-gauche.
• La liste continue car il manque encore : ‘IL PERRO SANTILLAN’ (Le chien Santillán) : un gars très intéressant, mais un peu en retrait ces derniers temps.
• On ne peut laisser en dehors le groupe H.I.J.O.S. : (Fils en faveur de l’Identité et de la Justice contre l’Oubli et le Silence), présents habituellement, sans aucuns drapeaux.
• MOUVEMENT de TERRE et de LIBERATION : un groupe similaire au « mouvement sans terre » du Brésil… »
Notre camarade poursuit ses commentaires sur notre texte précédent, en se penchant sur le chapitre concerné aux pillages. Voici ce qu’il en dit :
« On ne peut être que d’accord avec cette évaluation, mais il est choquant que le thème des SAQUEOS TRUCHOS[26] (faux pillages) ne soit pas abordé. Le fait de les ignorer ne doit tout de même pas nous faire oublier leur existence et leur importance politique. Qui a été à l’initiative de ces ‘faux pillages’ et pourquoi ? La réponse est double : 1) l’appareil Péroniste ; 2) le S.I.D.E.
Les premiers, car ce sont les seuls qui puissent capitaliser à leur bénéfice ce soulèvement prolétarien (de fait, Duhalde, le candidat qui avait perdu les élections, a pris le pouvoir). C’est maintenant Menem qui, avec la même tactique, essaye de déboulonner le siège sur lequel est assis son opposant. Pour les seconds, inutile de vous expliquer leur implication. »
Nous reproduisons ici notre réponse :
« Il semblerait qu’à notre affirmation ‘en rupture avec les partis parlementaires’, tu cites, pour marquer ton opposition, une série de groupes et/ou de fractions qui correspondent idéologiquement à des partis ou organisations démocrates parlementaires, et qui contrôleraient tout le mouvement. L’énumération est intéressante et particulièrement utile pour tous ceux qui ne vivent pas en Argentine, c’est pourquoi nous allons la publier. Mais toute opposition entre ce que nous affirmons dans la revue et ce que tu dis à ce propos doit être rejetée.
En effet, nous affirmions alors, et continuons d’affirmer, que la pratique du mouvement piquetero, l’action directe qui consiste à paralyser l’économie marchande qui affame l’espèce humaine, est totalement antagonique à la pratique des partis parlementaires. Cette opposition est généralement indépendante du fait qu’un grand nombre de participants (certainement la grande majorité) ont des idéologies bourgeoises, social-démocrates, croient aux partis, aux parlements, à l’autogestion ou encore au contrôle ouvrier.
Dans notre texte, nous affirmons cette rupture pratique entre le mouvement social, le communisme, agissant en tant que force sociale de remise en question de tout l’ordre bourgeois et la pratique de tous ces partis et forces de l’Etat. Bien évidemment, cette rupture est relative. Elle s’est cristallisée pendant les années de développement du mouvement piquetero et les escraches, et a atteint son apogée en décembre 2001 et dans les mois qui suivirent, et que depuis 2002, malgré des hauts et des bas, elle est train de dépérir… Ce qui nous intéresse, c’est de souligner qu’au plus fort de la rupture, toutes ces organisations se sont révélées incapables de contrôler, d’endiguer, de manipuler, le mouvement piquetero. Il est impossible de prévoir si ce mouvement poursuivra son processus de déchéance, s’il sera de plus en plus récupéré et manipulé par les forces de l’Etat (comme tu le décris) ou si, au contraire, il réémergera avec plus de force et d’autonomie que jamais face à l’Etat. Puisque nous sommes en lutte pour cette dernière proposition, nous insistons, dans nos publications, sur la rupture d’avec tous les partis parlementaires, sans que cela nous empêche de reconnaître que cette rupture ne peut se maintenir que dans la lutte, et que si on abandonne la rue (et la paralysie de la reproduction de la société marchande grâce à laquelle le mouvement s’est fait connaître dans le monde entier) pour placer nos espoirs dans le parlementarisme ou le gestionnisme, alors le mouvement prolétarien sera liquidé. La majorité des organisations que tu cites travaillent dans le sens de cette récupération, à l’aide de différentes méthodologies. L’emmerdant, camarade, c’est que le nombre de groupes en lutte contre ces récupérations est vraiment très faible : mais, nous croyons que la manière dont nous avons traité la question, en insistant sur la rupture prolétarienne vis-à-vis de ces forces de récupération, est la manière correcte, dynamique de le faire. Même si aujourd’hui, nous sommes bien obligés de reconnaître que, dans la période actuelle, les forces que tu mentionnes contrôlent de plus en plus les piquets et que, par conséquent, ces derniers ont tendance à perdre la puissance qui les caractérisaient.
C’est également pour cette raison que nous n’avons pas mentionné les faux pillages et les faux piquets. Le fait que les appareils de l’Etat truquent, de mille façons, ce qui se passe dans la rue, est une constante dans le mouvement révolutionnaire. Plus le mouvement est puissant, moins ces ruses s’affirment en force. Te souviens-tu que dans les pillages d’il y a une dizaine d’années, on ne parlait que de ces manœuvres, qui s’exprimaient sous la forme de fausses informations prétendant que les gens de tel quartier s’attaquaient à tel autre, facilitant ainsi le travail de la police et des appareils d’Etat ? Te souviens-tu encore que beaucoup de nos camarades présents à Buenos Aires argumentaient alors que ce n’était que des lumpenprolétaires qui s’affrontaient à d’autres lumpenprolétaires, comme voulait le faire croire la police, et que seule une infime minorité de révolutionnaires affirmaient le caractère prolétarien de ces pillages ? Cette fois, comme la force du prolétariat a été plus générale, et l’opposition entre la propriété privée et le mouvement d’expropriation des moyens de vie beaucoup plus large, tout ce baratin n’a pas eu énormément de succès. C’est pour cela que le fait d’en avoir peu parlé ne doit pas trop te surprendre (même si on fait mention des tentatives des médias bourgeois pour présenter les pillages comme des affrontements entre quartiers). De plus, ce fait a une relative importance dans l’action immédiate, en Argentine, l’importance que revêtent les piquets pour le prolétariat mondial ne peut être brouillée par les opérations des flics et autres appareils officiels de l’Etat. Il est évident qu’à un niveau d’analyse plus concret, plus détaillé, concernant le ‘who is who sur les piquets’, relever les différents cas de faux piqueteros peut revêtir une importance particulière (c’est pourquoi nous avons trouvé important de reproduire ce que tu affirmes là), notamment pour le développement de l’action camarade en dehors et contre ces tentatives de l’Etat. Notre texte n’avait pas, et ne pouvait avoir, la prétention d’entrer dans ces détails. »
Il nous faut cependant ajouter qu’en plus de la terreur d’Etat ouverte à l’encontre des piquets (ce qui implique non seulement les morts et les blessés par balles, mais aussi la mise sur pied de toute une législation répressive, la prise de directives administratives directement à l’encontre des piquets et des escraches : plus de 3.000 piqueteros sont soumis à des poursuites judiciaires !), on a tenté par tous les moyens possibles de les liquider, de les récupérer, de les manipuler, de les déprécier, de les rendre inefficaces, autrement dit, de leur enlever leur essence : imposer un rapport de force contre le capital. Pour cela tout est bon. Les faux piquets brûlent l’image du piquetero et laissent croire que les piquets ne sont rien d’autres que des manipulations de tel ou tel parti, voire du pouvoir lui-même. Les moyens de diffusion en arrivent à faire croire aux citoyens que les piqueteros sont un ramassis de profiteurs, payés pour bloquer les routes. Les partis et les syndicats, comme d’habitude, ont pris le train en marche (ce que nous dénoncions déjà dans le texte précédent) et tentent d’imposer des « piquets » qui ont de moins en moins de contenu réel, des « piquets » qui ne bloquent plus totalement les routes, sur lesquels il est interdit de porter une cagoule, pour ne pas effrayer le citoyen, et qui approuvent l’ensemble des mesures policières visant à identifier les piqueteros. Le bon vieux système de la carotte et du bâton, instrumentalisé par le gouvernement et administré par les syndicats, les manœuvres de division, la répression s’abattant de tous côtés, l’acceptation des normes citoyennes, voilà les formes actuelles utilisées par l’Etat pour liquider la force des piquets, comme le dénoncent différents groupes de camarades.
Pour rendre explicite notre propos, nous publions encore deux citations particulièrement parlantes. La première est datée de décembre 2002 : « Un autre succès, prouvant cette avancée [répressive – NdR], c’est l’imposition par les forces d’insécurité (qui vont jusqu’à jeter dans le fleuve des enfants vivant des poubelles) de l’interdiction de pénétrer dans la Capitale Fédérale, à toute organisation piquetera qui serait armée de bâtons pour former les cordons de sécurité, porterait la cagoule ou amènerait des couteaux, pour ceux qui sont chargés de l’intendance. Le fait que les groupes acceptent ces mesures humiliantes est un état de fait qui n’était pas accepté auparavant, et par exemple, le 27/06/2002, lorsqu’ils ont essayé d’appliquer ces mêmes mesures, la massivité du mouvement les en a empêché. L’acceptation de ce type de mesures constitue une grave erreur, car ils sont en train de prouver jusqu’à quel point nous cédons dans la lutte. La répression brutale que nous subissons aujourd’hui est en relation directe avec le fait d’avoir accepté ce qui nous a été imposé. »[27]
La seconde citation date de fin juin 2003 : « Nous manquerions de sincérité si nous ne reconnaissions pas qu’une des autres armes fondamentales, utilisée par le gouvernement pour calmer la tempête, ont été ces fameux ‘plans en faveur des chefs de ménage (hommes et femmes)’, dont l’application, signifia un accord entre le FTV-CTA et le CCC, accord par lequel ils s’engagèrent à ne pas ‘faire de vagues’, et une certaine tendance à la dégénérescence des secteurs les plus combatifs. Concrètement, on ne peut pas dire que ces derniers aient représenté une menace réelle pour le régime (de fait, ils ont plus été des points d’appui qu’une réelle menace), et cette tendance à la dégénérescence s’est cristallisée, par exemple, lors de la marche de soutien en faveur de l’usine Brukman, où la sécurité du Polo Obrero (organisation piquetera, dirigée par le Parti Ouvrier) a défoncé le crâne d’un militant de la trempe de Juan ‘Pico’ Muzzio (Démocratie Ouvrière), parce qu’elle le soupçonnait d’être un ‘infiltré’. Et à cette pathétique attitude du PO, il faut encore ajouter le silence complice des autres organisations qui n’ont même pas dénoncé énergiquement cet épisode criminel. »[28]
La dénonciation de ces forces et méthodes, tant au niveau argentin qu’international, tout comme les méthodes et organisations que nous avons dénoncées dans ce texte, représente une des tâches centrales pour les internationalistes du monde entier. Nos contributions, fruits de discussions camarades au niveau international, sont des armes à utiliser pour affirmer la théorie et l’action internationalistes contre l’isolement par lequel on prétend étrangler la lutte du prolétariat en Argentine.
Au moment où a été rédigé cet article (octobre 2003), le mouvement prolétarien en Argentine continuait à se débattre contre toutes les forces du capital mondial qui, en complément à la répression directe, cherchaient plus que jamais à l’isoler internationalement, à l’affaiblir programmatiquement et numériquement, à le liquider. Au-delà des flux et reflux, propres à tout mouvement similaire, il semble évident qu’on a atteint un rapport de force entre les classes tel que le prolétariat ne peut se maintenir à moyen terme sans donner un saut de qualité révolutionnaire qui, à son tour, est extrêmement dépendant du rapport de force sur le reste du continent américain et dans le monde. S’il y a bien une chose qui s’est faite chair et conscience de classe dans les mois qui ont suivi ces événements, c’est qu’il n’est plus possible de reproduire une nouvelle fois la même chose, qu’il faut aller plus loin dans la lutte contre le pouvoir. Mais sur la signification de cette lutte contre le pouvoir, les positions s’affrontent une fois de plus. En Argentine et partout ailleurs, circulent un nombre incalculable d’idéologies opposées à la révolution sociale qui, comme toujours, se parent de nouveaux atours et que nous devons dénoncer de toutes nos forces. Toutes ces idéologies contre-révolutionnaires coïncident dans l’affirmation suivante : il faut et on peut changer le monde sans détruire le pouvoir du capital, sans faire de révolution sociale.
En guise de conclusion, nous aimerions souligner que les limites constatées dans la lutte du prolétariat en Argentine, sont identiques à celles qui existent dans le prolétariat, au niveau mondial[29], qu’on ne peut exiger du prolétariat de ce pays qu’il donne un autre saut de qualité révolutionnaire, sans que le prolétariat du monde entier ne sorte dans la rue et affirme son existence en tant que classe internationale. La meilleure solidarité avec la lutte du prolétariat en Argentine, c’est la lutte prolétarienne dans tous les pays, contre la bourgeoisie et l’Etat.
Aujourd’hui plus que jamais, reprenons le mot d’ordre du prolétariat en Argentine à la fin des années ’60 :
Ni coup d’Etat ! Ni élection ! Révolution !
A propos des luttes prolétariennes en Argentine
Troisième partie
Caractère de la lutte et question du pouvoir
(in Communisme n°56 – octobre 2004)
Nous publions ici quelques réflexions et discussions suscitées par la lutte du prolétariat en Argentine, dans la mesure où celles-ci dépassent le cadre strict de ce qui s’est déroulé dans ce pays et provoquent de toutes parts des positions antagoniques, décisives pour les luttes à venir. Nous nous concentrons plus particulièrement sur la question du pouvoir et de la révolution.
1/ Lutte révolutionnaire
Il nous semble important, pour continuer sur ce thème, de passer maintenant à l’analyse d’autres critiques formulées par des camarades. Ainsi, le camarade cité dans la deuxième partie (entre autre pour son éclaircissement sur les forces syndicales et les partis qui essaient de manipuler les piquets), nous interpelle sur une des questions clés contenues dans ce texte. Nous retranscrivons ici ses propos : « J’estime que le qualificatif de ‘violence révolutionnaire du prolétariat’ (utilisé par vous) est franchement exagéré. Surtout lorsque l’on sait qu’au même moment, il était à la mode de reprendre les mots d’ordre suivants : ‘Nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous sommes des rebelles sociaux’, ‘Nous ne voulons pas prendre le pouvoir, nous voulons construire un autre pouvoir, issu de la base…’ Sous-commandant Marcos. »
Ce à quoi nous lui avons répondu : « S’il fallait attendre que le prolétariat se soulève aux cris de ‘Dictature du prolétariat, destruction du capital’, pour pouvoir enfin appeler par son nom la violence de classe contre la propriété privée et l’Etat, jamais les révolutionnaires n’auraient d’occasion de le faire. Que ce soit durant la Commune de Paris ou pendant la révolution russe, ou lors de n’importe quel autre exemple historique de lutte révolutionnaire du prolétariat, jamais les mots d’ordre n’ont clairement exprimé ce que le prolétariat était alors en train de réaliser. Et nous n’allons pas énumérer ici la quantité de mots d’ordre carrément bourgeois qui étaient à la mode au sein de ces mouvements qui, malgré cela, ont constitué une expression concrète et internationale de la ‘violence révolutionnaire du prolétariat’. Ce sont précisément nos ennemis, et plus généralement l’opinion publique, qui envisagent les choses uniquement sur base de ce que les protagonistes disent ou s’imaginent (et qui sont invariablement et inévitablement les idées de la classe dominante). Les militants révolutionnaires, quant à eux, n’ont aucune crainte à affirmer le contenu réel du mouvement, à contre-courant et indépendamment de ce qu’en disent les protagonistes. Souviens-toi de Blanqui ou de Marx, lorsqu’ils affirmaient que le prolétariat en France luttait pour sa propre dictature, ou encore de Ricardo Flores Magón qui soutenait que la lutte du prolétariat au Mexique était une lutte pour l’abolition de la propriété privée, de l’église et de l’Etat. Ces affirmations à contre-courant du contenu du mouvement, émises par ces révolutionnaires du passé, constituent en outre un élément décisif de l’action révolutionnaire de direction. Le renversement de la praxis au sein du prolétariat s’opère précisément par cette pratique décisive, par l’organisation de ces affirmations en force de direction vers les objectifs réellement révolutionnaires. En ce sens, il nous paraît non seulement important de continuer à affirmer le caractère révolutionnaire du mouvement du prolétariat en Argentine, en 2001-2002, mais tout aussi crucial de dénoncer les mots d’ordre bourgeois, notamment ceux du fameux sous-commandant Marcos, comme nous l’avons fait dans notre texte, en dénonçant les courants gestionnistes qui sont précisément ceux qui développent cette idéologie antagonique à l’action révolutionnaire du prolétariat. »
En synthèse, on peut dire que la lutte du prolétariat est révolutionnaire par son contenu, parce qu’elle assume dans la pratique son antagonisme au capitalisme, et non pas en fonction de ce qu’en disent les protagonistes et encore moins sur base de ce que peuvent proclamer les fans de Marcos et compagnie (évidemment présents aussi en Argentine) qui, fondamentalement, ne font que reproduire l’idéologie de la bourgeoisie au sein du mouvement.
Pour éclaircir ce qu’entendent les révolutionnaires par lutte révolutionnaire, précisons d’abord, que contrairement à ce que théorise la social-démocratie (marxisme-léninisme, trotskisme, proudhonisme, gestionnisme libertaire inclus), il n’y a pas deux sortes de lutte, l’une économique, l’autre politique, l’une immédiate, l’autre historique, l’une revendicative et l’autre révolutionnaire. Rappelons ensuite que cette séparation idéologique constitue une arme redoutable aux mains de la bourgeoisie à l’encontre du prolétariat, arme qui a longtemps servi et sert encore à perpétrer ses pires horreurs : par exemple, pour faire bosser toujours plus les prolétaires et les payer toujours moins au nom de la révolution sociale et/ou du socialisme (aujourd’hui à Cuba comme hier en Russie), alors qu’en réalité, tout le monde l’aura compris, il s’agit d’augmenter le taux d’exploitation capitaliste, en totale opposition évidemment aux objectifs (immédiats et historiques) d’une révolution prolétarienne. Aucune véritable révolution prolétarienne ne peut se développer sur la base de cet antagonisme. Tout au contraire, la généralisation de la lutte pour les besoins immédiates détermine la révolution sociale : l’objectif invariant de la révolution prolétarienne est de travailler le moins possible et de vivre le mieux possible, objectif qui en fin de compte, est exactement le même que celui pour lequel luttait l’esclave quand il s’opposait à l’esclavage, il y a de cela 500 voire 3.000 ans. La révolution prolétarienne n’est pas autre chose que la généralisation historique de la lutte pour les intérêts matériels de toutes les classes exploitées de l’antiquité, sa nature n’est pas différente de cette généralisation historique de la lutte pour les intérêts immédiats, économiques du prolétariat, et c’est exactement pour cela qu’elle s’affirme comme une révolution essentiellement humaine, contre la déshumanisation historique de l’homme menée à son expression maximale par le capitalisme. Par conséquent, la lutte pour l’amélioration absolue des conditions de vie est révolutionnaire, vitale et elle ne réalisera ses objectifs que par l’affirmation de la révolution[30]. La lutte du prolétariat pour l’appropriation de la plus grande partie du produit social est donc inséparable de sa lutte pour la réduction de l’intensité et de l’extension de la journée de travail. C’est dans ce processus d’affrontement au capital et à sa concentration en force de domination (Etat) que le prolétariat s’approprie pas à pas tout ce qui est produit, et abolit le travail salarié et, en dernière instance, le travail tout court.
Le programme invariant du justicialisme de Perón à Menem
Menem : « Le justicialisme n’a jamais combattu le capital ; au contraire, il a fait en sorte que le capital arrive pour favoriser la croissance de la République. Et c’est ce que nous avons fait à partir de 1989. » Par ailleurs, Menem a toujours souligné le fait que Perón, dès 1944, déclarait : « Il faut laisser de côté le collectivisme en Argentine et rendre possible l’entrée de capitaux. Ici, nous ne voulons ni le collectivisme, ni le marxisme, ni le communisme. Nous aimons fondamentalement l’Argentine, et le justicialisme est la vérité en politique. »
En Argentine, le prolétariat entre en lutte parce qu’il n’a pas d’autre issue face à la détérioration brutale de ses conditions d’existence. Dans ce processus, il se retrouve inévitablement confronté aux différentes fractions bourgeoises et à l’Etat. Dans sa pratique, il liquide la fameuse séparation entre l’économique et le politique par le simple fait qu’il ne peut y avoir de solution économique sans « faire de politique », ou mieux dit, sans une opposition totale à toute la politique de la classe dominante. Cette affirmation n’est pas le fruit de quelques élucubrations proférées par l’un ou l’autre militant, elle peut être vérifiée par tous dans la pratique : c’est aux cris de « qu’ils s’en aillent tous » que s’est exprimée, en Argentine, la critique généralisée de la politique, présente dans la généralisation de tout mouvement révolutionnaire. D’aucuns prétendront pourtant que, pour certains prolétaires, voire même pour l’ensemble du prolétariat, la lutte ne se borne qu’à des préoccupations immédiates. Ce à quoi nous répondrons que, même s’ils ne croient se mobiliser que pour ces fameux intérêts immédiats (affirmation totalement absurde puisque le développement même de l’associationnisme prolétarien, en opposition à la propriété privée organisée, suppose toujours des éléments, même balbutiants, portant à la résolution de l’antagonisme de classe), la lutte elle-même révèle l’antagonisme historique. Indépendamment de la conscience qu’en ont les protagonistes, les faits mettent en évidence que la vie du capital rend toujours pires les conditions immédiates des prolétaires et démontre donc que le progrès du capital exige l’aggravation des conditions de la vie humaine. L’unité de l’immédiat et de l’historique n’est pas une question de conscience, mais d’antagonisme pratique vital. Comme le disait Marx : « Peu importe ce que tel ou tel prolétaire ou même ce que le prolétariat tout entier s’imagine être son but, momentanément. Ce qui importe, c’est ce qu’il est réellement et ce qu’il sera historiquement contraint de faire conformément à son être. Son but et son action historique lui sont tracés visiblement et irrévocablement, dans les circonstances mêmes de sa vie comme dans toute l’organisation de la société bourgeoise. »
Le caractère révolutionnaire de la lutte du prolétariat en Argentine ne surgit donc pas de la conscience qu’il aurait de ses objectifs, mais de sa pratique effective. Et précisément, ce que nous constatons c’est que le décalage, entre la pratique et les niveaux de conscience explicites[31], exprimé par le mouvement est encore plus considérable que ce qui en a été dit. Et s’il nous semble indispensable de souligner la force révolutionnaire de l’action du prolétariat, nous ne pouvons pas nous empêcher de pointer la faiblesse de conscience, de direction, qu’a affichée le mouvement.
Le mouvement révolutionnaire se voit encore cadenassé par un ensemble d’illusions qui le limitent quant à ses perspectives, et c’est à cela que se réfèrent les camarades lorsqu’ils disent que cette lutte n’est pas révolutionnaire. Mais ce point de vue est idéaliste car il s’appuie, non pas sur les déterminations contenues dans le mouvement, sur l’opposition objective entre deux projets antagoniques, mais sur les idées exprimées.
La principale faiblesse du mouvement, c’est justement l’illusion existant en son sein et consistant à penser qu’il puisse y avoir une solution non révolutionnaire à la situation sociale. Sa principale limite idéologique, c’est de partir des idées aberrantes de la majorité qui, même en plein milieu de la lutte, se figure pouvoir solutionner les problèmes qui nous affectent sans passer par la destruction des fondements mêmes de la société du capital. Ce décalage, dont nous avons déjà parlé, semble être une caractéristique qui se confirme dans les mouvements prolétariens actuels, et est sans doute produit par la contradiction entre la catastrophe de plus en plus visible du capital mondial et la totale inconscience de classe qui caractérise le prolétariat mondial : inconscience de constituer une classe, inconscience du projet historique communiste.
Dans les chapitres suivants, nous reviendrons sur cette contradiction particulière au développement de notre mouvement. Pour ce faire, nous allons débuter par l’énumération de quelques éléments de force, propres au type d’organisation territoriale caractéristique du mouvement en Argentine, non pas pour faire l’apologie de cette expérience particulière (les conditions qui ont produit ce mouvement existent aujourd’hui sous d’autres latitudes et tendront à se généraliser), mais dans le but d’entrer plus profondément dans l’analyse des caractéristiques des luttes de classes actuelles et de mettre en exergue les « nouveaux » éléments de force et de faiblesse qui, selon nous, ne constituent en aucun cas un « privilège » ou une « difficulté » particulière à ce pays mais, comme l’exprime très bien la « lettre ouverte au prolétariat argentin » publié dans la première partie (vosotros sois tan solo unos de los primeros, « vous, vous êtes seulement parmi les premiers »), indiquent le type d’affrontements de classe qui tendra à se reproduire[32].
2/ Forces
Il s’est rarement produit dans l’histoire de la lutte de classe de mouvement aussi général d’unification et de polarisation des classes. La constitution du prolétariat en organisations territoriales de lutte, son opposition ouverte à la propriété privée et à toutes les structures de l’Etat (non seulement au pouvoir exécutif, mais aussi au pouvoir législatif et judiciaire, aux appareils répressifs, aux partis, aux syndicats,…) constituent une affirmation révolutionnaire objective, malheureusement, à ce jour relativement exceptionnelle dans l’histoire. Si l’on excepte les grandes luttes révolutionnaires du 20ème siècle, Mexique (1910-17), Russie (1917-21), Allemagne (1918-21), Espagne (1934-37), et de façon moins marquée dans d’autres pays durant ces belles années de révolte généralisée (1917-21), les seuls exemples comparables sont ceux de l’Iran (1979), de l’Irak (1991) et dans une certaine mesure de l’Algérie (2001-2002) et… de l’Argentine 2001-2002. Cette énumération ne se prétend en rien exhaustive (car, comme nous n’hésitons pas à le répéter, une des grandes faiblesses de notre classe, c’est d’ignorer sa propre histoire). Ceci étant dit, la nature même de la question suppose une appréciation subjective puisqu’il s’avère impossible de pouvoir mesurer objectivement les niveaux pratiques d’autonomie. Mais malgré cela, il nous paraît fondamental d’apporter quelques réflexions, de souligner certains éléments qualitatifs concernant le caractère relativement exceptionnel de ces luttes prolétariennes en Argentine, en même temps qu’il nous semble indispensable d’en souligner les limites, comparativement à d’autres expériences de notre classe. L’essentiel de ce qui va être exposé par la suite ne réside pas pour autant dans l’évaluation, toujours discutable, des forces et faiblesses de la lutte de classe en Argentine. Ce qui, par contre, nous semble primordial, c’est l’analyse des conditions actuelles de la lutte du prolétariat, qui tendent à se manifester ailleurs, sous d’autres latitudes, et qui expriment tragiquement la contradiction actuelle entre la catastrophe de la société du capital (qui pousse le prolétariat à la lutte révolutionnaire, démontrant quotidiennement ce qu’il y a d’utopique et de réactionnaire dans les différents types de réformisme sensés résoudre les problèmes humains) et l’inconscience de classe du prolétariat, concrétisée par le manque d’organisation du prolétariat en parti, en force révolutionnaire mondiale.
Il est indispensable d’analyser cette contradiction parce que c’est en elle que s’insère la pratique révolutionnaire actuelle.
Inutile de préciser que les points soulignés ci-dessous sont, en réalité, des éléments inséparables et s’enchevêtrent les uns aux autres. Si nous les avons fragmentés de la sorte, c’est uniquement pour mieux nous faire comprendre.
• Le premier élément qualitatif se manifeste dans la constitution du prolétariat en classe[33], dans son organisation en assemblées territoriales, en opposition aux pouvoirs de l’Etat. Assemblées de piqueteros, ensuite assemblées de quartiers qui, dans bien des cas, centralisent ou au moins se coordonnent avec d’autres structures, telles les assemblées de certaines usines, d’imprimeries, de travailleurs en lutte, de comités de quartiers, de services (soulignons le fameux cas des motoqueros[34]), du secteur publics et organisent également des assemblées d’assemblées, appelées des Coordinadoras, etc. Ce niveau d’organisation revêt une importance primordiale dans la mesure où elle traduit une rupture non seulement avec les illusions individuelles et individualistes, dérivées directement du marché et de son image spectaculaire, mais aussi avec la planche de salut que pouvait encore représenter la profession ou la corporation. La catastrophe de la société capitaliste a réduit en poussières toutes les promesses d’avenir meilleur, et mis en évidence le fait que ce n’est qu’organisé en classe que le prolétariat peut aspirer à défendre ses intérêts les plus immédiats. Cette organisation du prolétariat en classe révèle non pas une conscience explicite de la nécessité d’agir comme force prolétarienne, mais traduit au moins une conscience implicite du fait que seuls, nous ne sommes rien, qu’il est vain de s’unir par catégorie professionnelle, et qu’exclus ou inclus (selon la séparation idéologique de la bourgeoisie), si l’on se s’unifie pas, on est foutu ! C’est précisément cette unification territoriale entre hommes et femmes, chômeurs, travailleurs, retraités, pensionnés, employés, étudiants,… qui confère un caractère exceptionnel à la lutte.
• Ceci détermine un second élément qualitatif qui se concrétise dans le fait que les structures associatives du prolétariat se sont directement constituées en assumant les problèmes globaux, concernant l’ensemble de la communauté entrée en lutte. La moindre revendication sectorielle, catégorielle, syndicale,… s’est avérée totalement absurde et ridicule, ce qui a sérieusement limité l’action contre-révolutionnaire des différents appareils de l’Etat (pouvoirs municipaux, partis, syndicats, institutions, ONG,…) destinés principalement à canaliser et endiguer légalement le mécontentement. Ou pour le dire autrement, comme la structuration du prolétariat en tant que classe du capital se base sur cette séparation (et que tous les appareils de domination sont prévus pour pouvoir répondre sur cette même base), l’unification territoriale implique toujours, historiquement, un saut de qualité dans l’organisation du prolétariat en tant que classe contre le capital.
• Cependant, cette généralité, cette globalisation n’est pas abstraite, comme c’est le cas pour l’unité démocratique formulée par un gouvernement, un parti ou la télévision qui, au nom du peuple ou de la nation, se fonde sur la renonciation consciente ou inconsciente de ses propres intérêts particuliers. Tout au contraire, à travers l’unité qui se développe dans l’action telle qu’elle s’est déroulée en Argentine, personne n’a renoncé à rien. Pour la première fois dans leur vie, beaucoup de prolétaires ont agi en fonction de leurs propres intérêts particuliers et c’est dans la partie qu’ils ont retrouvé la totalité, qu’ils ont trouvé les intérêts du prolétariat comme totalité ; dans la défense de leurs intérêts immédiats et particuliers, ils se sont ressentis organiquement, comme faisant partie du prolétariat en tant que totalité en lutte. Dans chaque quartier, dans chaque action de piqueteros, dans chaque entreprise, dans chaque usine occupée, on a ressenti la nécessité d’assumer l’action, le combat, la discussion… autour d’une lutte qu’on a vécu pour la première fois comme unique, dans chaque endroit on a commencé à vivre la lutte comme une totalité organique.
• La production matérielle en fonction de la lutte et des besoins de ceux qui luttent (boulangeries, potagers…), l’organisation de services au sein même des quartiers, totalement désertés par les structures de l’Etat et indispensables à la lutte (les services de santé, par exemple), la mise au service du mouvement de certaines usines occupées (les imprimeries), ont constitué une importante affirmation révolutionnaire du prolétariat, ébauchant, ne fut-ce qu’élémentairement et grossièrement, une société où ce ne serait pas le marché et le taux de profit qui dirigeraient tous les aspects de la production matérielle, mais la dictature des producteurs et de leurs besoins humains. Il est évident que ce type de pratique est extrêmement difficile à maintenir à longue échéance, surtout en dehors d’une période de lutte ouverte. Cette difficulté est encore accrue par l’importance actuelle de l’idéologie gestionniste en Argentine, idéologie qui, alliée aux idéologies en faveur du troc, de l’autogestion et de la « non-lutte pour le pouvoir », rend d’autant plus indispensable la critique permanente de la soi-disant possibilité de changer la société sans détruire la dictature marchande.
• Toutes ces structures, au travers desquelles le prolétariat s’affirme comme force sociale, sont assumées en opposition totale au pouvoir de la classe dominante et agissent en tant que telles. Agir et non déléguer, agir comme nécessité vitale et surtout agir en tant que force contre l’Etat, constitue l’axe unificateur. L’action directe apparaît ainsi comme une question de vie ou de mort, comme l’objectif explicite de toutes ces assemblées.
• Simultanément, ce passage à l’action passe par la discussion, par la réunion, par le fait d’assumer qu’il ne faut avoir confiance en personne sinon en « nous-mêmes ». Ceci implique un processus de négation de toutes les structures d’autorité et de gestion de la société bourgeoise, de toute la structuration de la domination démocratique. Le mécontentement généralisé se transforme dès lors en capacité d’agir et de penser collectivement et unitairement. Des forums, des discussions, des formations, des cours sont organisés dans les quartiers, des locaux et des biens sont occupés, la propriété privée se voit défiée, ainsi que les structures juridiques qui la protègent. Dans cette action théorico-pratique se trouve contenue l’ensemble de la critique implicite de la délégation, du parlementarisme, voire même les premiers balbutiements de la critique de la démocratie.
En raison du caractère contradictoire qu’ils contiennent, nous mentionnerons particulièrement les désirs d’horizontalité, de « démocratie directe », de lutte contre le verticalisme, de lutte de la base contre la direction, présents au sein du mouvement. Si, d’une part, la critique des syndicats et des partis va s’afficher ouvertement, et en ce sens, une rupture embryonnaire avec tout le spectre politique, de même que l’affirmation d’une structuration de la communauté de lutte recherchant les formes adéquates à son développement, on va retrouver, d’autre part, une fétichisation des formes de décision, vues comme garanties en soi. Signalons à ce propos que la fétichisation de la forme, l’idéologie de la démocratie de base, maintient encore, aux quatre coins du monde, les masses prolétariennes enchaînées à des formes horizontales de décisions, les empêchant de voir que l’importance réside dans le contenu de la décision et non dans sa forme. C’est la perspective et la direction du mouvement qui est importante, non le fait que la décision soit adoptée par une majorité ou par une minorité, ce qui n’a jamais constitué et ne constituera jamais une garantie en soi. C’est pourquoi, il s’avère indispensable d’analyser, ne fut-ce que sommairement, la face cachée de ces assemblées.
3/ La face cachée des assemblées
Les affirmations d’associationnisme prolétarien contre la dictature du capital ne s’assument jamais pour ce qu’elles sont, elles ne se placent jamais au centre de l’antagonisme capitalisme ou révolution sociale. Le manque de théorie communiste, de perspective révolutionnaire, de critique des bases mêmes de la société marchande, enferme le mouvement dans l’empirisme le plus plat, dans le concrétisme, l’immédiatisme, le réalisme, le possibilisme, l’apolitisme. Par manque de contenu, au sein des assemblées, le jusqu’où aller ? cède la place au comment y aller ? : la manière de décider est dès lors considérée comme une garantie meilleure que le contenu même de la décision. L’idéalisation du concret impose sa dictature sur la perspective : « Nous ne parlons pas de politique », « il faut faire des choses concrètes ». La déification de la démocratie directe et de l’horizontalité liquident le contenu des décisions au nom de la sacro-sainte forme de décision : l’important, c’est que « tous participent à la décision », « que chacun donne son avis »,… et le fait que « personne ne parle trop » garantit tout le reste.
Par ce biais, la critique des partis, des syndicats et autres structures de l’Etat est également réduite à une simple critique de la forme : on les critique pour leur bureaucratisme, leur corruption, mais rarement parce qu’ils représentent la classe ennemie, parce que ce sont des partis et des syndicats du capital, de l’Etat bourgeois. On ne voit pas que le pourrissement généralisé des fractions politiques, syndicales, judiciaires,… de la bourgeoisie argentine est l’expression même de la pourriture du système social capitaliste. Ce qui explique la recherche désespérée de garanties dans le contrôle politique citoyen. Les décisions prises à la base sont considérées comme une garantie en soi, oubliant ainsi le fait que le capitalisme s’impose aussi au moyen de décisions démocratiques prises par tous, que les impressionnantes conditions d’exploitation qu’impose le système ne peuvent être détruites qu’en s’attaquant aux bases mêmes de la production de marchandises.
Pire encore, prétendre opposer démocratie à bureaucratie, c’est ignorer que démocratie et bureaucratie ont toujours fonctionné de pair, que toute démocratie, même de base, produit de la bureaucratie, que le système électoral, basé sur l’individu démocratique, produit nécessairement l’individu bureaucratique. Demander à la démocratie de liquider la bureaucratie, c’est comme demander à l’entreprise capitaliste de sauver l’humanité et d’oublier son essence même : le profit.
La totalité de la critique antibureaucratique reste ainsi embourbée dans le cloaque démocratique, dans cette puante et misérable idéologie bourgeoise de l’individu contrôlant majoritairement ses représentants, du citoyen imbécile et impuissant luttant pour que ses dirigeants politiques ne pourrissent pas. L’absence de vision sociale fait triompher le formalisme politique. Faute de programme social ouvertement révolutionnaire, on tombe dans la solution politique : le démocratisme, le contrôle politique de tout et, en dernière instance, l’apologie de la base, de la majorité (ou de l’unanimité).
La démocratie, mode d’organisation de la société capitaliste et de la dictature du capital par excellence, dont la force réside en la dissolution, dans l’individu atomisé, de toute force ou projet historique antagonique, ne peut servir la lutte du prolétariat, ni comme méthode d’organisation, ni comme perspective (idéologies du socialisme démocratique).
A ce propos, ouvrons ici une petite parenthèse pour rappeler qu’il ne manque pas d’exemples historiques où des majorités, sous le contrôle de tous, ont adopté des décisions totalement contraires aux intérêts du mouvement, et où des minorités révolutionnaires ont assumé des décisions qui ont fait avancer l’ensemble du mouvement. Aucun mouvement révolutionnaire n’a pu avancer et ne pourra le faire, sans l’audace de minorités assumant organiquement les intérêts de la totalité, sans l’action de prolétaires d’avant-garde qui, sans consultation démocratique préalable, conspirent et s’organisent clandestinement, sans militants qui, à contre-courant, affirment le caractère prolétarien et révolutionnaire d’une lutte là où prédominent les illusions démocratiques, sans la présence de ceux qui, au sein des assemblées ou des soviets dominés par des idées de pacification sociale, ou au sein des assemblées constituantes, indiquent et assument la voie de l’insurrection.
L’idéologie de la démocratie de base, de la démocratie directe, du contrôle démocratique en assemblée, de l’horizontalisme (qui ne prédomine pas qu’en Argentine, mais aussi un peu partout dans le monde, y compris dans des moments de lutte), amène à prendre les décisions en fonction du plus petit commun dénominateur, qui est toujours bourgeois et réformiste, avec, pour résultat objectif, l’isolement des minorités en rupture avec l’idéologie dominante. Dans ce contexte démocrate, les positions révolutionnaires sont vues comme étant « trop théoriques », « trop abstraites », « trop politiques ». C’est le réformisme le plus plat qui prédomine, sous forme de gestion du quotidien. La soumission de la vie humaine à la dictature du capital et la nécessité de la révolution sociale qui en découle, questions centrales s’il en est, sont évacuées au nom de l’unité : il faut « être pratique », « il ne s’agit pas de prendre le pouvoir, mais de développer un contre-pouvoir », « il faut faire des choses concrètes et non discuter de politique ». Et comme toujours dans l’histoire, la théorie contre-révolutionnaire, exhibée comme une nouveauté, se concentre sur la liquidation de l’aspect le plus important de la perspective révolutionnaire : la question du pouvoir, la question de la révolution sociale.
Le lecteur comprendra donc que l’importance que nous donnons aux discussions sur la lutte de classes en Argentine, réside dans le fait que ces discussions transcendent, et de loin, ce qui s’est posé dans ce pays et qui se posera inévitablement et plus puissamment encore sous d’autres latitudes.
4/ La question du pouvoir
Il est évident que, dans tout ce processus, le prolétariat affirme un rapport de force, un pouvoir qui se situe en opposition à celui de la société bourgeoise. La question du pouvoir constitue, bien entendu, une question-clé de la lutte historique du prolétariat partout dans le monde. En Argentine, cette question a cristallisé l’ensemble des problèmes historiques de notre classe : le manque de théorie révolutionnaire, le manque de direction, l’absence de perspective.
Les conceptions dominantes servent toutes à camoufler, dévier, entraîner sur des voies de garage la puissance et la force développée par le prolétariat.
Contre la gauche bourgeoise (contre la social-démocratie, c’est-à-dire contre le léninisme, contre les staliniens et leurs variantes trotskistes, contre l’idéologie des groupes guérilleros marxistes-léninistes et/ou nationalistes), les communistes ont toujours affirmé qu’il ne s’agit pas de prendre le pouvoir de l’Etat mais de le détruire, qu’il ne s’agit ni d’occuper l’Etat bourgeois ni de gérer le capitalisme à l’instar des bolcheviks (pratique théorisée plus tard par le marxisme-léninisme), mais qu’au contraire il faut détruire l’Etat et le capital. Pour les révolutionnaires, la révolution du prolétariat n’est pas une révolution politique, visant à occuper l’Etat et à gérer le capital, c’est une révolution sociale qui s’affirme comme pouvoir, comme puissance sociale contre la société marchande et l’Etat capitaliste. Si la clé du capitalisme est la dictature de la valeur se valorisant, la clé de la transition révolutionnaire réside dans la dictature du prolétariat abolissant le travail salarié, autrement dit, dans la dictature des besoins humains contre toutes les lois marchandes, jusqu’à l’abolition même de la marchandise et l’instauration de la communauté humaine mondiale.
Bien sûr, certains autres secteurs de la gauche bourgeoise, qui hier s’autoproclamaient libertaires ou autonomes et s’affichent aujourd’hui comme post-modernes, markistes (du sous-commandant Marcos), alternatifs ou altermondialistes, n’hésitent pas à reprendre cet abc à leur compte. Mais ils ne le font pas pour affirmer la nécessité d’une révolution sociale qui détruise le capital et l’Etat, mais au contraire pour s’opposer à cette révolution au nom d’une rébellion qui n’a pas pour objet la destruction du pouvoir du capital. Ils font mine d’ignorer ou nient purement et simplement, que seul le développement de la force destructive révolutionnaire peut simultanément organiser une société nouvelle. Comme l’a résumé le camarade précédemment cité, la mode aujourd’hui est d’affirmer : « Nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous sommes des rebelles sociaux », « Nous ne voulons pas prendre le pouvoir, nous voulons construire un autre pouvoir, issu de la base… sous-commandant Marcos ».
Evidemment, cette théorie contre la révolution, comme tout ce que le capital produit matériellement et idéologiquement, est présenté comme nouveau (à l’instar des autres marchandises, la mode du nouveau étant inhérente à la phase actuelle du capital), en affirmant que désormais la « vieille » opposition entre réformisme et révolution est dépassée. Pas besoin d’être une lumière pour reconnaître, derrière ce soi-disant dépassement, la vieille théorie réformiste en putréfaction, utilisant pour l’occasion de nouvelles et attrayantes formulations. La clé du réformisme reste cependant identique, son essence n’a pas bougé d’un iota : la possibilité de changer le monde, petit à petit, sans révolution sociale, sans détruire le capital et l’Etat. En d’autres termes, le réformisme développe une propagande contre la révolution, qui, selon lui, n’est plus nécessaire pour « changer le monde ».
La théorie de ces contre-révolutionnaires (explicitement ou implicitement, c’est effectivement ce qu’ils sont) se manifeste aujourd’hui en affirmant que l’on peut « changer le monde, sans prendre le pouvoir », comme le défend le titre même de ce livre cité un peu partout, et dont l’auteur est un certain John Holloway. Ce courant de pensée soutient que la guerre de classes (qu’implicitement, ils nient) s’éteindra sans que la dictature du prolétariat, et donc la destruction de la dictature du capital, ne soit nécessaire. C’est donc en toute logique, l’entièreté de la social-démocratie qui sympathise avec ce courant incarnant ce que ce parti historique a toujours représenté. Ses principaux représentants se nomment Antonio Negri, Michael Hardt, John Holloway, le sous-commandant Marcos et ses disciples, de même que toute une série de groupes (comme le collectif Situaciones, déjà critiqué dans la première partie) aux quatre coins de la planète. Leur terminologie est la copie conforme de celle qu’utilisent les milieux autoproclamés alternatifs lorsqu’ils font leur show : autogestion, dignité, multitude, réseaux diffus, contre-pouvoir, économie alternative, horizontalité,… on en passe et des meilleures.
Il ne s’agit évidemment pas uniquement de théories ou d’idées dénuées d’importance, elles revêtent au contraire un réel poids social. En effet, au fur et à mesure que le prolétariat tente de rompre avec l’encadrement politiciste et populiste du gauchisme classique (marxisme-léninisme, trotskisme,…), comme on a pu le constater en Argentine et ailleurs, les vieilles théories réformistes, gestionnistes et libertaires sont remises au goût du jour (et donc appelées à jouer un rôle contre-révolutionnaire important) grâce à un efficace ravalage de façades (nouvelles formules, nouvelles phrases, nouvelles terminologies, rien que du neuf !) et à une solide dose de propagande internationale. Alors que, de leur côté, les révolutionnaires du monde entier sont persécutés, emprisonnés et coupés de toute forme de diffusion, ce genre de théories, qui clament que la révolution ne sera pas nécessaire pour changer le monde, jouit de toutes les condescendances possibles et imaginables auprès des grands médias, et les discours de leurs représentants sont diffusés par les télévisions nationales, ou à l’occasion de grandes conférences organisées dans les meilleures universités. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, on doit subir la croisade d’un idiot de l’acabit de John Holloway, qui parcourt le monde pour annoncer sa bonne nouvelle : « il est possible de changer le monde sans prendre le pouvoir ». Et, comme une horloge bien huilée, on va le retrouver dans les endroits considérés comme les plus chauds du point de vue de la lutte de classes : Colombie, Chiapas, Buenos-Aires,… distillant sa propagande en faveur de cette « nouveauté ». Le livre a même été présenté à Buenos-Aires, par l’auteur en personne, dans un local de piqueteros du MTD Solano (Mouvement des travailleurs au chômage) ! C’est dire l’importance de s’affronter à de telles positions ! Quand serons-nous capables d’escracher ce type de sujet ?
Invité au 180ème anniversaire de l’Université de Buenos-Aires, en juin 2001, John Holloway a déclaré à propos du Mouvement Sans Terre du Brésil et des zapatistes : « … Et ces mouvements, avec toutes leurs différences, ont en commun le fait qu’ils ne tentent pas de conquérir le pouvoir de l’Etat, ni militairement, ni électoralement. Ils ne conçoivent pas la violence comme un moyen de transformation du monde. Et bien que leurs actes ne soient pas clandestins, ils défient ouvertement le pouvoir. » Comme si la non-violence et la non-clandestinité constituait une vertu moderne, édulcorée, qui plus est, d’un clin d’œil au légalisme ! Comme si Bernstein n’avait jamais été critiqué ! Comme si concevoir la transformation du monde, sans la violence révolutionnaire était d’une quelconque originalité !
Les livres de ces auteurs à la mode ne traînent franchement pas sur nos tables de nuit et il nous en a coûté d’avaler l’immonde traité de conservation de la société produit par le Sieur Negri, afin d’en publier des commentaires et des extraits. Pour la même raison, aucun d’entre nous n’étant disposé à se dévouer pour lire cette autre merde qu’est le livre de John Holloway, nous avons décidé de reprendre une critique qui nous a semblé intéressante et valable. Nous la reproduisons ici, malgré certains problèmes et désaccords, sans en connaître ni la source, ni l’auteur[35].
Les veuves de la révolution – Raul Abraham
Tristement, avec l’apathie des vaincus, culminent les pages chaotiques du dernier livre à la mode au sein de la petite bourgeoisie bien-pensante et coupable : « Alors, comment changeons-nous le monde sans prendre le pouvoir ? » se demande-t-il. « A la fin du livre comme au début, on ne le sait pas ». Il ne manquait plus que cela. John Holloway commença son exposé à Rosario de façon assommante : « Le capitalisme est une merde », dit-il, et il reçut une ovation d’une claque de joyeux anticapitalistes. Y avait-il encore un doute ? Non, mais ce n’est pas parce qu’on le sait que ce n’est plus vrai. C’est toujours bien de le dire et – surtout – cela n’emmerde personne, et certainement pas les capitalistes qui cachent pudiquement les puissants orgasmes qui les transportent quand ils entendent les critiques éthiques adressées au capitalisme. Rien ne sonne mieux aux oreilles du capital qu’une critique de ce genre : le capitalisme corrompt, le capitalisme tue, le capitalisme est une merde. Cette immense accusation glisse sur les consciences aguerries de ceux qui effectivement corrompent et tuent. Cela les assimile à une force de la nature et cela les met au même niveau que n’importe quelle autre forme d’organisation sociale : l’esclavagisme ne fut (n’est) certainement pas beaucoup mieux.
Comme on pouvait le prévoir, Holloway passa sous silence (pas par ignorance, je l’affirme) le fait que le capitalisme freine le développement des forces productives, qu’il éjecte des travailleurs en les condamnant non pas à être séparés de leur production mais purement et simplement à revenir à des formes précapitalistes de production et – last but not least – que le capitalisme est en train de détruire les conditions matérielles de reproduction de l’existence de l’humanité, sciant la branche sur laquelle nous sommes tous assis : la planète Terre.
Sans doute Holloway apprécie-t-il peu cette façon de présenter les choses : on le sait, démontrer avec la rigueur des chiffres que la façon irrationnelle de produire et de s’approprier l’excédent mène à la barbarie prend beaucoup de temps, est très fastidieux et requiert de complexes études dans des disciplines aussi arides que l’économie ou d’autres tout aussi ennuyeuses. Il est bien plus rapide et bien plus efficace de nous révéler que « l’Etat ne danse pas, l’Etat ne rit pas ». Ce qui se réfère, bien évidemment, au fait que nous, les hommes, nous pouvons le faire. Remarquable constatation. Seules de longues années d’études dans de vénérables universités européennes peuvent conduire à de tels sommets de sagesse. Ou peut-être suffit-il d’écouter les profondes réflexions du sous-commandant Marcos qui a réussi à convaincre Holloway que « c’est en posant des questions qu’on avance ». Nous n’aurions rien à redire à cela. Malheureusement, notre savant irlandais, peut-être sous l’effet d’une surdose de mezcal, a écouté le sous-commandant mais n’a pas regardé aux alentours. Marcos – dont la production théorique est pour le moins superficielle – opère comme le grand-prêtre de la « nouvelle révolution » et – comme tout prêtre – il tente de sauver les âmes, même au prix de la sienne. De telle sorte qu’il préconise le vieux principe du « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Et qu’est-il en train de faire au Chiapas si ce n’est construire un appareil d’Etat ? Avec les particularités que chaque situation propose mais en tentant de répondre aux quelques questions fondamentales auxquelles doit répondre tout qui prétend construire pouvoir, contre-pouvoir ou anti-pouvoir : Qui organisera et comment s’organisera la production, la circulation et la distribution des biens et des services dans la société ?
Ces questions l’irlandais les ignore, ce qui est mal en soi, ou les méprise, ce qui est pire encore. Pour Holloway, tout se réduit au fait que les révolutionnaires du 20ème siècle – tous – se sont trompés. Parce qu’ils ont perdu. On pourrait aussi faire quelques inférences sur son échelle de valeur, mais tel n’est pas l’objectif de cette note. Le mépris de l’irlandais pour la force avec laquelle le capitalisme à écrasé les expériences révolutionnaires, sans cacher ses mensonges, Dieu nous en préserve, est olympien. Pour apaiser la douleur que l’échec des révolutions du siècle passé provoque en lui, Holloway tente des explications historiques abusives. Il est effectivement assez fallacieux d’oser suggérer un parallélisme possible entre les passages du féodalisme au capitalisme et une hypothétique construction du socialisme entre les « interstices » du mode de production capitaliste. Ces « lézardes » du système seraient ainsi susceptibles de s’élargir et de se transformer en grandes allées où – tôt ou tard – passera un homme nouveau, délivré des plaies individualistes. Serait-ce cela la « voie hollowayenne vers le socialisme » ?
C’est tout à fait adorable, et très bucolique même : une nouvelle Arcadie nous attend où le lion s’étendra aux côtés de l’agneau. Malheureusement, et sans prétendre à l’analyse marxiste, l’expérience indique qu’en général le lion bouffe l’agneau et si, à certain moment, il marque quelques hésitations, c’est juste parce qu’il choisit à quelle sauce l’accommoder. A ce sujet, il conviendrait peut-être de rappeler à Holloway la fable du scorpion et de la grenouille. « C’est dans ma nature », dit le scorpion tandis qu’il s’enfonce dans la rivière après avoir piqué le crédule batracien. Il ne serait sans doute pas superflu non plus que certains leaders politiques sud-américains, toujours prompts à triompher lors d’élections organisées par le système pour trouver une solution au rendement décroissant du taux de profit, réfléchissent là-dessus.
Peut-être que dans l’imagination de Holloway se cache une forme d’organisation sociale constituée de petites communautés, autosuffisantes, qui troquent des produits avec d’autres communautés semblables à elles, en toute égalité. Le puissant rayonnement de leur exemple agirait comme stimulant pour que de plus en plus de groupes humains s’organisent de cette manière et, au bout du compte, nous nous retrouverions face à un monde transformé sans avoir « pris » le pouvoir. Pour Holloway, depuis Saint-Simon et jusqu’à nos jours, il ne s’est rien passé, mais en cela il faut reconnaître qu’il n’est pas le seul : à force d’être à ce point post-modernes, certains philosophes, français en général, en sont devenus prémodernes et, à force de discours hermétiques – moins c’est compréhensible, mieux c’est – ils s’en prennent à la science et à sa sournoise idéologisation. En se déchaînant contre le néo-positivisme, ils prônent le retour des sorciers. Belle façon de jeter le bébé avec l’eau sale.
Il cache, ou travestit, beaucoup de choses, l’irlandais devenu chiapanèque. Mais s’il en est une qui n’est pas dissimulée, c’est sa prise de position dans le débat « Réforme ou révolution ». Alors qu’il nous affirme que la question est aujourd’hui dépassée parce que toutes deux étaient erronées, il prend parti pour la première. Il a droit de le faire – cela ne fait aucun doute – mais ce gros malin l’esquive et se dit révolutionnaire d’un genre nouveau, alors qu’il n’est rien d’autre qu’un triste réformiste de seconde main, si on lui concède l’honnêteté, chose qui est elle aussi discutable.
Non content de « démystifier » le savoir révolutionnaire, Holloway s’en prend au fétichisme du capital, il nous rappelle la séparation entre le producteur et son produit, l’aliénation que suppose pour le travailleur le fait de ne pas dominer les moyens de production et il décrit pour nous l’aliénation que ce divorce forcé implique pour l’âme humaine : merci !
Enfin non, pas tant que ça finalement, puisque les conclusions que tire Holloway sont perverses : il suppose que c’est dans les espaces laissés libres par le mode de production capitaliste que nous pourrons résoudre la tension intrinsèque entre la forme de production – sociale – et l’appropriation de l’excédent, individuel. S’il y a bien quelque chose de clair chez l’irascible philosophe de Trêves, c’est bien le caractère tranchant de ses arguments qui ne sont pas en demi teintes : l’humanité a l’opportunité de remplacer un mode de production irrationnel et antiscientifique par un autre dans lequel la planification nous évitera le spectacle honteux de la faim, de la guerre, des maladies et d’autres fléaux évitables puisqu’il ne s’agit pas de phénomènes naturels, et ce du point de vue scientifique. Mais cette possibilité, seul le développement colossal des forces productives provoqué par la globalisation capitaliste commencée au 16ème siècle nous l’offre. Ce n’est que depuis cette formidable accumulation de richesse produite par le capitalisme qu’on peut penser à la construction d’un mode de production rationnel. Mais quelqu’un croit-il par hasard que le créateur de l’armée rouge pariait sur le triomphe de la révolution en Allemagne pour de simples sympathies personnelles envers les spartakistes ? Il est certain que le capitalisme a démontré une capacité de survie supérieure à celle espérée du temps de Marx et que les expériences de construction du socialisme ont échoué. C’est comme cela ! Tant pis ! Le chemin sera plus difficile et la récompense plus douce, et cela en dépit de tous ceux qui ne se sont pas remis de la commotion cérébrale causée par les blocs de maçonnerie tombés du mur de Berlin mais qui, durant des années, refusèrent de voir que l’existence du mur (et non sa chute) était l’aberration de la pensée révolutionnaire. Le capitalisme ne tombera pas parce que quelqu’un l’affirme – ni sous l’effet de ces quelques lignes – mais encore moins parce que quelqu’un propose d’organiser des carnavals qui revendiquent l’hédonisme.
Ce n’est pas du volontarisme pur que sortira quelque chose de positif, mais bien de l’étude des conditions objectives de la formation économique sociale qui nous occupe, de l’appréciation correcte du rapport de force de chaque moment, de la force qu’on applique sur les maillons pourris du système et – fondamentalement – de notre capacité à fédérer toutes les forces antisystème et à nous approprier la richesse que le développement actuel des forces productives permet de générer. Pour ce faire, tous les acteurs sociaux impliqués dans la lutte contre le capital devront unir leurs efforts, articuler les alliances de classe nécessaires et – de façon critique – dicter un programme d’organisation de la production et de la distribution des biens à toute la société.
A moins que quelqu’un n’imagine que le capitalisme permettra que la propriété des moyens de production changent de mains sans lutte, ou que la création de « phalanstères » au 21ème siècle finira par faire tomber un système qui corrompt, avilit et assassine.
Toutes ces positions, opposées à la lutte pour le pouvoir, se basent sur la théorisation des faiblesses du prolétariat. Comment opère-t-on ? Eh bien, par exemple, on prend la critique ébauchée par le prolétariat en Argentine à propos de la démocratie représentative et répressive et la critique des organisations gauchistes qui la défendent (et prônent l’assemblée constituante et autres réformes démocratiques comme perspective), et on constate que dans cette lutte on ne parle pas explicitement de la destruction révolutionnaire du capitalisme. Que font ces messieurs ? Au lieu de critiquer cette faiblesse, ils font l’apologie du manque de perspective que cela génère, comme si le « contre-pouvoir » de la rue était en soi une alternative !
Que ce soit bien clair, le contre-pouvoir, s’il n’est pas réduit à un simple jeu de mots, n’existe que s’il agit CONTRE LE POUVOIR du capital, s’il s’y oppose pratiquement et insurrectionnellement. Son objectif doit être la destruction du pouvoir du capital, autrement dit, la dictature de ce contre-pouvoir détruisant pratiquement la société bourgeoise. Dans le cas contraire, les rapports marchands d’une part, et l’inefficacité politique de tout gestionnisme populaire face à l’Etat capitaliste d’autre part, finissent inévitablement par détruire ce contre-pouvoir, par le dissoudre pratiquement dans la société civile. C’est au moment où le prolétariat doit opérer un saut de qualité que le rôle de ce genre de théories, qui veut « changer le monde sans prendre le pouvoir » (ce qui revient pratiquement à dire sans destruction révolutionnaire du pouvoir du capital), montre toute l’ampleur de sa force contre-révolutionnaire.
Ce qu’il y a de plus désolant là-dedans, c’est le manque de critiques et de dénonciations de ces positions contre-révolutionnaires (et nous ne considérons pas comme critiques dignes de ce nom celles qui émanent du parlementarisme ou de ceux qui ne jurent que par l’assemblée constituante), ce qu’il y a de plus triste, c’est la voie royale offerte au gestionnisme et à tout ce discours à la mode sur le « pouvoir de base » en Argentine qui, nous le répétons, s’oppose à l’indispensable révolution sociale. L’absence de conscience explicitement révolutionnaire, le manque de minorités révolutionnaires, pèsent terriblement sur notre mouvement. De ce point de vue, le mouvement du prolétariat en Argentine, en 2001-2002, est effectivement moins profond que beaucoup d’autres mouvements prolétariens du 20ème siècle, non seulement en regard de la grande vague révolutionnaire de 1917-21, mais également en ce qui concerne les mouvements des années 1966–73, période durant laquelle la question de la révolution sociale s’est ouvertement posée, et des minorités plus ou moins claires mais avec une incidence sociale certaine ont tenté de la mener à bien dans certaines villes des Etats-Unis, de Chine, d’Italie, de France, d’Espagne, du Pérou, du Mexique, du Chili, d’Uruguay, en Argentine également, tout comme, quelques années plus tard, dans bon nombre de pays du Moyen-Orient.
Même si nous ne nions pas la conscience implicite du mouvement, qui a rendu possible tout ce que le prolétariat a affirmé et que nous avons déjà souligné, il nous faut pourtant constater combien l’inconscience de classe du prolétariat est profonde, combien sa méconnaissance du programme révolutionnaire, le manque de critiques ouvertes et explicites de la société marchande (reflété par toutes les illusions sur l’économie alternative) et, plus particulièrement, le manque de présence de la théorie révolutionnaire concernant la destruction de l’Etat sont criants. C’est d’autant plus manifeste lorsque les discussions dominantes restent coincées entre une théorie réformiste qui prône la prise du pouvoir et une théorie réformiste qui prône la non-prise du pouvoir, sans que jamais ne s’affirme face aux deux, la théorie révolutionnaire sur la destruction du pouvoir bourgeois.
L’université des Mères au service de la rentabilité des entreprises
Les Mères de la Place de Mai, maintenant consultants d’entreprises, offrent des consultations gratuites en marketing et en commerce à des usines autogérées. Elles ont démarré sur base d’une demande d’ex-employés de Cerámicas Zanón. Actuellement elles forment des ex-travailleurs de Bruckman et des supermarchés Tigre.
« Il y a trois principes que tout projet économique doit respecter : être rentable, productif et efficace ». La définition ne provient pas d’un cadre de multinationale ou d’un consultant d’entreprise, mais de Sergio Schoklender, le mandataire légal des Mères de la Place de Mai qui, il y a quelques mois, a commencé à conseiller les usines autogérées par le biais d’une association baptisée Rebeldía y Esperanza (« Révolte et Espoir »).
Comme s’il s’agissait d’un consultant en affaires, mais tout à fait gratuitement, l’association offre aujourd’hui un service complet d’assistance à ce type d’usines. Ses services vont du marketing à la comptabilité en passant par un service de consultation pour le développement industriel et le dessin des marques et des logos. Ce type de services est offert par l’ensemble des professionnels qui composent le corps enseignant de l’Université Populaire des Mères de la Place de Mai et travaillent totalement « ad honorem ».
« Nous avons commencé par hasard, à partir d’une demande émanant de l’usine de Cerámicas Zanón, gérée aujourd’hui par les ouvriers. Ils nous ont contacté parce qu’ils avaient besoin de placer leurs produits et n’avaient ni couverture légale ni structure administrative pour les facturer », dit Schoklender.
Le premier pas accompli par Rebeldía y Esperanza, constituée en association sans but lucratif, fut d’accorder la possibilité à Zanón de facturer les comptes et les ordres de payements de l’entité et, grâce à cela, l’usine de céramique a pu retrouver quelques-uns des canaux traditionnels de commercialisation.
« L’opération la plus importante que nous avons réalisée est l’accord pour fournir, via un distributeur, la chaîne Easy », soutient Schoklender. « L’accord conclu porte sur la vente de 140.000 m2 de céramiques, ce qui représente 1,5 million de dollars par mois et, chose importante, c’est la première fois qu’une usine autogérée place ses produits dans une multinationale », ajoute-t-il. Pour revenir sur les marchés et s’y imposer, Zanón a lancé deux nouvelles lignes de produits : Piedras del Sud et Fasinpat (Fabrica sin Patrones – Usines Sans Patrons) et son prochain objectif est de commencer à exporter une partie de sa production. « Nous sommes en train de faire les premiers pas dans cette direction, en utilisant le réseau de contacts internationaux dont disposent les Mères », reconnaît Schoklender.
Le mandataire légal de Rebeldía y Esperanza a assuré que le prochain projet, sur lequel il travaille déjà afin de lever la saisie conservatoire à laquelle l’usine est soumise par la pression des créanciers, consistera à élaborer une proposition à présenter devant la Justice afin d’alléger la pression des créanciers que traîne l’usine en justice.
Schoklender signale également qu’en plus de Cerámicas Zanón, l’association travaille sur d’autres projets d’assistance patronale, tous soumis à une unique condition : être des usines autogérées ou sous contrôle ouvrier.
« Nous collaborons, avec les travailleurs de Bruckman, au réaménagement de certaines machines tombées en désuétude et nous assistons les ex-employés du Supermarché Tigre qui tentent de rouvrir le magasin », dit Schoklender.
Alfredo Sainz, de la rédaction du journal LA NACION
Bien entendu, les décennies de contre-révolution internationale, la rupture de la relation organique et théorique avec les mouvements révolutionnaires du passé, les dizaines de milliers de militants massacrés par la terreur d’Etat ou détruits par l’isolement qui a suivi « le retour à la démocratie », pèsent profondément sur le mouvement du prolétariat en Argentine. C’est pourquoi les préoccupations portent plus sur la meilleure façon de gérer l’usine occupée que sur la meilleure façon de faire la révolution, et il n’est pas jusqu’à l’Université des Mères de la Place de Mai de s’interroger sur la façon de rendre les usines autogérées rentables ! Quels que soient les arguments utilisés pour justifier cette soumission aux lois despotiques du capital, à nos yeux ils ne font que confirmer le caractère profondément réactionnaire de ces idéologies pro-économie alternative et « contre-pouvoir ». Si les besoins d’extension et de radicalisation du mouvement contre la dictature du capital ne parviennent pas à s’imposer, ces soi-disant « espaces de liberté » finissent par se soumettre à cette dictature et l’ensemble des rapports humains retombe sous le joug de la loi de la valeur. La boucle est bouclée et l’autogestion montre sa véritable et invariante fonction historique : freiner le processus révolutionnaire, au moment même où l’Etat bourgeois est désorganisé, contribuer aux moments décisifs de la bataille, à faire diversion au sein des secteurs radicaux du prolétariat, l’épuiser dans une activité productive qui, tôt ou tard, se soumet à la dictature de la valeur, isoler les fractions radicales du prolétariat, facilitant ainsi la réorganisation de l’Etat bourgeois et sa répression sélective.
5/ Autres tactiques de l’Etat contre le mouvement
Pour liquider le mouvement, l’Etat utilise simultanément et de façon complémentaire d’autres tactiques. Il est indispensable de parler ici de la signification réelle de l’annulation récente des lois d’impunité approuvées lors des gouvernements précédents (ainsi que des efforts de l’Etat pour supprimer les escraches, les piquets,…), car ce point va nous permettre d’éclaircir tous les autres.
Seuls les complices de nos tortionnaires et des assassins de nos frères peuvent ne pas se réjouir de la suppression des lois d’impunité. Et ici déjà, il faut immédiatement stopper toute spéculation sur la plus ou moins grande complicité des personnages de l’Etat (Menem, Alfonsin, Kirchner, De la Rua,… viennent de la même fosse à purin) et savoir que le responsable, c’est l’Etat bourgeois : c’est lui qui a perpétré les massacres et c’est encore lui qui a voté et approuvé l’impunité. Certains nous diront : « c’est notre lutte qui les a annulées ! ». Et c’est vrai, la lutte contre l’impunité, et en particulier la force des escraches, a obtenu ce résultat. Mais même si l’Etat a annulé l’impunité parce qu’il ne pouvait pas faire autrement, cela reste malgré tout lui qui décide de formaliser ce résultat. Bien entendu, il ne le fait pas pour nier sa fonction essentielle de domination, mais au contraire pour reprendre le contrôle de la situation et le monopole de la violence : seul l’Etat peut juger et pardonner. C’est lui qui formalise juridiquement le rapport de force que les escraches sont parvenus à imposer dans la pratique. Il espère de cette manière regagner l’autorité qu’il a perdue dans la rue. L’objectif de l’opération juridique est de canaliser la rage au sein des appareils de l’Etat, d’affaiblir l’action directe que développe la condamnation sociale et, en fin de compte, de liquider ce qui fait le plus peur : les escraches. Pour y parvenir, l’Etat continue en même temps d’affiner les mécanismes de répression de ce type d’action prolétarienne. Une fois de plus, la carotte et le bâton cherchent à liquider l’action directe.
Au sein du mouvement, si tout le monde exprime sa joie, parce qu’il nous paraît juste à tous qu’un tortionnaire, qu’un assassin pourrisse au fond d’une tôle, nous sommes néanmoins nombreux à nous méfier de ces réjouissances, à douter qu’on les laisse longtemps croupir en prison et à appeler à la vigilance et à la continuité des escraches. Cela nous a fait chaud au cœur, lors de différentes discussions camarades, de constater la force des positions sur la question, qu’elles proviennent de camarades de HIJOS ou de camarades issus des commissions des escraches des assemblées de quartiers : « Il est évident qu’on se réjouit à l’idée qu’ils aillent au trou, mais nous ne luttons pas pour cela, nous luttons pour la condamnation sociale et continuerons à lutter pour elle. » Ce que les tortionnaires et les responsables des disparitions craignent le plus, c’est l’isolement social, le mépris exprimé à leur encontre dans les lieux publics, la répudiation par leur propre famille à qui ils ont toujours caché leur puante fonction sociale, ils paniquent à l’idée du scandale et de la honte qui leur pend au nez, à l’idée de devoir tout vendre pour déménager loin et vivre dans la crainte d’un prochain escrache, ils redoutent de finir dans un asile de fous, sont terrifiés à l’idée que ne ressorte, dans les moindres détails, l’étendue de leurs crimes, et finalement ils en arrivent à avoir peur de tout être humain… Pour certains d’entre eux, la condamnation juridique ressemble à une délivrance dans la mesure où elle est délimitée et précise tant sur la durée que sur le type de châtiment (la prison). Châtiment qui, lui aussi, correspond à l’idéologie dominante, à la religion et aux objectifs du pouvoir judiciaire : expier ses péchés, accomplir sa peine pour se laver de ses fautes. Tout comme la disparition de nos frères, la condamnation sociale que la lutte impose, n’a quant à elle, aucune limite : ni oubli, ni pardon, ni faute expiée, ni grâce divine. Par cette condamnation sociale, le prolétariat développe sa force, en mobilisant un grand nombre de personnes (quartiers, voisins, amis,…), ce qui le renforce socialement et rend cette puissance plus destructrice encore par l’élimination de cette immonde vie de tortionnaire caché. En ce sens, la continuité de la lutte contre les bourreaux d’hier établit avec les organes de répression actuels de l’Etat un rapport de force qui empêche ces derniers d’agir en toute impunité. Les bourgeois les plus lucides savent pertinemment que cela sape les forces répressives d’Argentine et d’ailleurs ce qui, en dernière instance, pourrait contribuer à leur déstructuration et, finalement, à leur liquidation révolutionnaire.
Et réciproquement, dans les pays où la lutte contre l’impunité n’a pas atteint une telle force, comme dans l’actuelle Espagne postfranquiste, les escadrons de la mort et les diverses formes de répression en général, n’ont eu de cesse de se développer démocratiquement et continuent de le faire, sous la férule de gouvernements socialistes et populistes : l’appareil répressif du franquisme, resté intact, continue à se moderniser, les social-démocrates, de leur côté, ont organisé des escadrons de la mort et les prisons espagnoles d’aujourd’hui, avec leurs terribles FIES, équivalent des Quartiers de Haute Sécurité en France, sont considérés par les prisonniers comme de véritables centres d’extermination.
La lutte contre l’impunité, les escraches en Argentine, ont servi d’exemples au prolétariat de nombreux pays. Si le gouvernement de Kirchner abroge les lois qui octroyaient l’impunité, c’est parce que, grâce à cela, non seulement la bourgeoisie, les flics, les militaires argentins pensent pouvoir dormir sur leurs deux oreilles (même si certains pourront être condamnés), mais également parce que, de cette manière, il espère arrêter la généralisation et l’internationalisation des escraches, pour que d’autres bourgeois, d’autres répresseurs,… ailleurs dans le monde, puissent dormir tranquilles. Sinon, pourquoi les médias internationaux, toujours complices de la répression et du terrorisme d’Etat, mèneraient-ils une telle propagande autour de cette abrogation et applaudiraient-ils à tout rompre ce cheminement vers « la solution démocratique » ?
Pour en revenir à l’Argentine, signalons encore que c’est ce moment précis que va choisir le gouvernement, comme par hasard, pour sortir son plan de pacification sociale, qui inclut la répression des prolétaires conséquents, le dénigrement des escraches et des piquets. Il ne faut donc pas s’étonner si la bourgeoisie argentine considère maintenant que le droit humain le plus fondamental soit le droit à la libre circulation et si, sans honte, elle traite les piquets de fascistes. Rien d’étonnant non plus à ce qu’elle considère, une fois les responsables des tortures et des disparitions condamnés (juridiquement), que les escraches soient antidémocratiques, que la justice de la rue soit, par essence, fasciste et qu’il faille faire confiance à la justice démocratique. Au fait, Bush ne dit rien de très différent pour justifier les massacres aux quatre coins de la planète !
6/ Futur du mouvement en Argentine
Tout concourt à empêcher la continuité, la radicalisation et l’extension de la lutte du prolétariat :
• Le terrorisme de l’Etat démocratique à l’encontre des piquets, des escraches, combiné aux tactiques de formalisation judiciaire, à la décision de rendre illégal et de réprimer les prolétaires les plus conséquents.
• La négation idéologique du caractère classiste du mouvement en Argentine, par des organisations de ce pays et du monde, qui ont établi un véritable cordon sanitaire international pour isoler le mouvement.
• La perte d’autonomie de classe de toutes les organisations de lutte et leur récupération par les syndicats et les partis.
• La propre inconscience de classe du prolétariat incapable de voir qu’il ne s’agit pas d’un problème local mais d’une question à vocation toujours plus historique et internationale.
• Le politicisme et la capacité de la social-démocratie à canaliser le mouvement vers des réformes politiques, comme ce fut le cas avec cette soi-disant fin de l’impunité, mais aussi à travers le parlementarisme, l’assemblée constituante, etc.
• Le marché capitaliste, ses lois et les idéologies autogestionnaires.
• Le poids du réformisme à la Marcos, Negri, Holloway & Cie et les illusions qu’ils colportent sur la possibilité d’une transformation du monde sans révolution sociale.
• L’illusion de croire que les problèmes rencontrés soient typiquement argentins, fruits de la corruption, au lieu de les considérer comme des problèmes à validité internationale : l’antagonisme entre les classes, l’affrontement entre la préservation de l’ordre bourgeois et sa destruction révolutionnaire.
• Et, par-dessus tout, l’aspect le plus caricaturalement réactionnaire, à savoir, le poids du nationalisme et des ridicules petits drapeaux argentins.
Ce que le mouvement du prolétariat en Argentine a apporté à la lutte internationale est incommensurable. Il ne fait aucun doute que l’associationnisme territorial, les piquets, les différentes formes d’escraches seront les principales caractéristiques des luttes les plus conséquentes qui ne vont pas manquer de se développer ailleurs dans le futur.
Mais, comme nous avons pu le constater tout au long de ce texte, les problèmes rencontrés sont énormes, les tactiques liquidatrices variées et complexes, et la conscience implicite dont a fait preuve le prolétariat en Argentine bien insuffisante pour assurer la continuité et le développement du mouvement.
• Le prolétariat s’est organisé en force, mais sans réelle conscience de classe et en ignorant son projet historique.
• Le prolétariat a défié la propriété privée, mais sans affirmer socialement que l’humanité ne peut survivre qu’en détruisant la propriété privée.
• Le prolétariat a défié l’Etat et lutté ouvertement contre lui, mais n’a pas proclamé socialement la nécessité de le détruire.
• Le prolétariat s’est opposé pratiquement aux formes démocratiques et a imposé sa force antidémocratiquement (piquets, occupations d’usines, escraches,… ne respectent évidemment aucune lois démocratiques), mais la critique de la démocratie en tant que dictature du capital brille par son absence.
• Le prolétariat est descendu dans la rue et a imposé sa force contre la marchandise et la loi de la valeur, ce qui constitue une brutale affirmation révolutionnaire, mais n’a pas conçu de direction qui revendique le contenu de cette action et qui proclame ouvertement la nécessité de la dictature contre le marché et ses lois.
• Le prolétariat a affirmé son mouvement révolutionnaire contre toute la société du capital, mais ne l’a fait qu’implicitement, sans affirmer ouvertement et socialement la nécessité de la révolution sociale.
Eclaircissons quelque peu cette question de la conscience implicite et explicite. Dans sa pratique contre le capital et l’Etat, le prolétariat a fait preuve d’une conscience qui ne parvient pas à s’exprimer avec la force nécessaire pour permettre de généraliser et d’approfondir son mouvement. Le mot d’ordre « Qu’ils s’en aillent tous, qu’il n’en reste plus un seul ! » constitue, cependant, un mot d’ordre qui va bien au-delà de la politique, notamment comme critique de la démocratie ; il est bien plus clair que les mots d’ordre que l’on peut retrouver dans des mouvements insurrectionnels nettement plus puissants, y compris celui d’octobre 1917 en Russie où « Pain et Paix » représentaient les mots d’ordre centraux. Plus claire aussi est la conscience implicite qu’a le mouvement dans les mois précédant décembre 2001 sur le fait qu’il faille abattre le gouvernement, qu’il faille généraliser la révolte prolétarienne non seulement contre tel ou tel politicien pourri, mais contre le système dans sa totalité, contre la démocratie qui est une dictature. C’est ce qu’exprime le groupe de rock Bersuit (dès 2000) dans ses chansons : « C’est l’explosion, c’est l’explosion… de ma guitare, de ton gouvernement,… et s’il te venait le moindre doute, viens la prendre, vois comme elle est dure, si ça c’est pas une dictature, alors c’est quoi ?… ». Ou encore lorsqu’il dénonce : « tous », « ceux qui ont le pouvoir et vont le perdre », « ce sont tous des narcotrafiquants » et « qu’ils aillent tous se faire foutre », « les démocrates de merde et les capotes pacifistes », « élections, re-élections, pour moi, c’est quand même la merde, fils de pute »,… « et si tout ce merdier, ce n’est pas le système, c’est quoi alors ? c’est pas le système, c’est quoi alors ?… ».
Les carences dont nous avons parlé auparavant pèsent néanmoins lourdement sur le mouvement. Les drapeaux de la révolution sociale ne sont pas clairement brandis. Il est dramatique de constater que, malgré la force révolutionnaire du mouvement, la dénonciation de la propriété privée et de la société marchande ait été si faible, que la dénonciation de tel ou tel fils de pute[36] ou même de « tous les fils de pute » n’ait pas été élargie au système social qui les a engendrés, qu’on n’ait pas suffisamment gueulé que c’est la propriété privée des moyens de production qui assassine aux quatre coins de la planète. Il est tragique que nos cris n’aient pas eu la force d’imposer l’évidence : si nous n’abolissons pas la société marchande, c’est elle qui abolira l’espèce humaine. Il est profondément conservateur qu’au lieu de parler de la révolution, on prétende changer la vie quotidienne sans détruire la société. Il est tragique de constater le peu de dénonciation de la dictature du capital, de la dictature de la valeur, et du fait qu’il est impossible d’accommoder la vie à cette dictature. Il est catastrophique de voir, qu’au lieu de tout cela, c’est la contre-révolution qui réapparaît, dans chaque cercle prolétarien, dans chaque usine occupée, conduisant de toutes les façons possibles, à se soumettre à la dictature de la rentabilité. Le manque de théorie communiste est criant, tout comme est flagrante la méconnaissance, y compris de la part des minorités les plus actives du prolétariat, du projet social de notre classe.
L’isolement du prolétariat en Argentine est fondamentalement un problème idéologique, un manque d’affirmation théorique : les protagonistes n’ont même pas conscience de l’unité qui existe dans l’action qu’ils ont développée. Il ne fait pourtant aucun doute que, dans toute la région sud-américaine, la lutte du prolétariat s’est radicalisée depuis le début de ce 21ème siècle. En Bolivie, au Pérou, en Equateur, au Paraguay et, dans une moindre mesure, dans d’autres pays de la région (Brésil, Chili, Uruguay), le prolétariat a développé le même type de luttes (routes bloquées, piquets, manifestations violentes, escraches) et combattu les mêmes ennemis (mêmes bourgeois, mêmes entreprises, mêmes plans du FMI, mêmes forces de police, coordonnées par le même centre impérial, mêmes discours syndicaux et mêmes épouvantables pacificateurs social-démocrates). Mais, de toute évidence, cette réelle unité d’action, cette communauté de lutte pratique et la communauté d’objectifs révolutionnaires qu’elle implique, n’ont pas été explicitées au sein du mouvement, pas plus que n’y eut de véritable affirmation théorique des objectifs révolutionnaires communs à tout le mouvement.
Le chauvinisme argentin, assorti d’une espèce de complexe de supériorité raciste développé depuis toujours par la bourgeoisie locale vis-à-vis du prolétariat originaire d’autres pays de la région (le mépris à l’égard de l’« indien », qu’il soit bolivien, péruvien, paraguayen ou même argentin, jouit de la puissance d’un préjugé socialement admis, et les divers gouvernements – y compris celui de Menem – n’ont jamais éprouvé la moindre gêne à les exploiter et ainsi diviser), le fait d’imputer la faute à tel ou tel « fils de pute » (les interprétations des partis politiques et des syndicats présentent la misère comme le fruit de la corruption ou de la putréfaction, considérée comme une spécialité argentine, pour masquer, qu’en réalité, il s’agit de l’expression inévitable de la catastrophe de cette société dirigée par le profit) sont toutes des idéologies qui séparent le prolétariat en Argentine de ses frères, et le prolétariat en général de la révolution sociale.
7/ Et malgré tout… il n’y a qu’une seule perspective : la révolution sociale !
Il n’y a pourtant qu’une seule et unique solution : la révolution. Comme toujours (et aujourd’hui plus que jamais), l’affirmation, à contre-courant, de la perspective révolutionnaire du prolétariat constitue un élément décisif de la pratique révolutionnaire. Contre toutes les alternatives gestionnistes et/ou politicistes, il s’avère indispensable de lutter consciemment et volontairement pour l’organisation et la centralisation des forces prolétariennes, la direction du mouvement actuel vers l’unique alternative possible : la dictature du prolétariat pour détruire la société marchande et le travail salarié.
Affirmer cette perspective, diriger le processus d’affirmation prolétarienne jusqu’à l’organisation du prolétariat en classe, en parti, en force révolutionnaire, voilà la tâche des révolutionnaires du monde entier.
[1] Piquete signifie piquet de grève. Piquetero est un néologisme castillan créé par le mouvement pour exprimer la continuité historique de la lutte prolétarienne qui a conduit les prolétaires du piquet de grève devant l’usine (entrave à la « liberté de travail ») au barrage routier (entrave à la « libre circulation des marchandises »).
[2] Saqueos signifie à la fois assaut, pillage et réappropriation.
[3] Nous mettons le mot entre guillemets car ce serait une insulte envers les sauvages de prétendre que le capitalisme serait « sauvage ». Soulignons au passage que cette invention est une arme de ceux qui voudraient un capitalisme « civilisé », comme si ce qu’on endure n’était pas suffisamment civilisé.
[4] Il serait totalement impossible d’en donner la liste exhaustive. Il y en a vraiment trop.
[5] Ou, comme disait Marx, « Dans la société du régime capitaliste de production, l’anarchie de la division sociale du travail et le despotisme de la division du travail dans la manufacture se conditionnent réciproquement » K.Marx, Le Capital, tome I.
[6] L’exemple du yaourt est tiré d’une étude faite en Allemagne et qui, selon les auteurs, est valable dans bien d’autres pays. Voir « L’énergie au futur » de l’Association pour le développement des énergies renouvelables.
[7] Il s’agit d’un plan d’urgence de l’Etat qui octroie un subside (misérable) en échange de la réalisation de certains travaux.
[8] Corralito signifie petit enclos et désigne la séquestration des comptes bancaires.
[9] Tiré de l’article « Quelques commentaires sur les assemblées de quartier » signé par des Camarades de la Bibliothèque Populaire José Ingenieros. Nous soulignons que cette théorie absurde et réactionnaire (très courante chez les libertaires) qui imagine que la majorité de la population des grandes villes fait partie de la « classe moyenne » et non du prolétariat, est, dans les faits, une apologie du capital selon laquelle la société bourgeoise, plutôt que d’avoir polarisé les classes sociales, plutôt que d’avoir exacerbé la richesse et la misère et aiguisé toutes les contradictions (tel que cela se passe dans la réalité), développerait précisément, dans les grands centres urbains, une classe intermédiaire, majoritaire, qui, bien entendu, jouerait le rôle de tampon social et assurerait une vie éternelle à cette société.
[10] Vendepatria est le terme par lequel les nationalistes désignent ceux qu’ils accusent de manque de patriotisme.
[11] Firmenich : ex-dirigeant des Montoneros, organisation péroniste « radicale » dont la fonction sociale a été d’empêcher la rupture prolétarienne et de canaliser des secteurs radicaux de la classe au service de l’appui « critique » à l’Etat.
[12] Comme nous l’avons déjà signalé à d’autres occasions, la lutte révolutionnaire, pour une société sans Etat, pour l’anarchie est depuis toujours l’objectif de la lutte révolutionnaire de tous les vrais socialistes, communistes,… C’est la social-démocratie qui, au nom du socialisme et de l’anarchisme, a réussi à morceler et diviser le mouvement en « communistes et anarchistes ». Au début du siècle, il était courant, non seulement en Argentine mais dans le monde entier, que les révolutionnaires, en opposition aux deux écoles social-démocrates, s’appellent eux-mêmes indistinctement communistes et anarchistes ou anarchistes communistes.
[13] Qui, et cela vaut la peine de le souligner, fut fondée par des sociétés anonymes de différents pays.
[14] Les différentes citations des porte-parole de Solano sont extraites de Situaciones n°4, MTD-Solano.
[15] Situaciones n°2, article intitulé « La militance du contre-pouvoir ».
[16] Il faut se rappeler que le livre auquel il est fait référence ici : « Le gauchisme, maladie infantile du communisme » fut écrit contre ceux qui s’opposaient à l’opportunisme et au social-démocratisme de l’Internationale Communiste.
[17] Publié dans Pensamiento libre n°39-40.
[18] Etant donné les difficultés à comprendre certaines nuances géographiques qui ont une incidence sur les discussions politiques, il est important de distinguer la Capitale Fédérale du Grand Buenos Aires. La Capitale Fédérale fait référence à la partie centrale et administrative de la ville, qu’on pourrait comparer à tout ce qui se trouve à l’intérieur du périphérique de Paris. Le Grand Buenos Aires lui, fait référence à ce qu’on peut appeler la Capitale, mais en plus, à tout ce qui se trouve à l’extérieur du périphérique de Paris : la banlieue, une série de quartiers et de villages résidentiels, mais aussi des quartiers pauvres, des bidonvilles. Si nous insistons sur cela, c’est parce que le phénomène des assemblées de piqueteros a surgi de la province et dans les banlieues du Grand Buenos Aires, tandis que le phénomène des cacerolas et assemblées de quartiers est plutôt associé à la Capitale Fédérale. C’est sur cette base que nos ennemis ont établi leur fameuse théorie : piquetes, saqueos = lumpenprolétariat, tandis que cacerola = petite-bourgeoisie. A Paris, cela reviendrait à dire qu’à l’intérieur du périphérique n’habiteraient que des petits-bourgeois.
[19] Si nous citons ici le CCI, c’est parce que ce groupe constitue un exemple, somme toute assez banal et eurocentriste, de ce que peut représenter le pire en matière de manipulation idéologique.
[20] Le fait que le CCI ne reconnaisse pas la présence du prolétariat dans les pays qu’il nomme comme faisant partie du tiers-monde, et plus particulièrement dans les pays bombardés par les Etats-Unis et l’Europe, est tout à fait symptomatique de l’euro-racisme et du social-impérialisme propre à cette organisation. Que ce soit en Afghanistan ou en Irak, jamais le CCI ne dénonce le terrorisme qui s’opère à l’encontre du prolétariat. C’est tout au contraire à propos des attentats du 11 septembre 2001, à New-York, qu’il va parler de « terrorisme contre le prolétariat » ! Rien d’étonnant donc qu’en ce qui concerne les grèves des fonctionnaires en France, cette organisation ait jugé bon de parler de luttes prolétariennes, alors que pour les mêmes fonctionnaires, en Argentine cette fois, le CCI ne décèle que l’œuvre de la classe moyenne : tout leur est bon lorsqu’il s’agit de nier l’unicité de la lutte prolétarienne. Les textes du CCI que vous venez de lire sont extraits de leur Revue Internationale N°109.
[21] Villa miseria littéralement signifie « quartier misérable », nous traduirons dorénavant ce terme par bidonville.
[22] C’est une lapalissade que d’affirmer que le gouvernement Duhalde devait, par-dessus tout et à la demande expresse, non seulement de la bourgeoisie argentine, du FMI, mais aussi du capitalisme mondial, tenter par tous les moyens possibles de liquider le mouvement du prolétariat et en particulier, sa colonne vertébrale : les piquets et les assemblées. C’est pour cela que « depuis l’arrivée de Duhalde à la Casa Rosada et jusqu’au massacre de Avellaneda, le souci de coordonner les forces répressives a été au premier plan ». Le 10 janvier, le journal Clarín informe : « La Police Fédérale, la Police de Buenos Aires, la Gendarmerie et la Préfecture Navale, c’est-à-dire toutes les forces de sécurité qui couvrent les juridictions de la Capitale Fédérale et de la périphérie, ont commencé à travailler ensemble pour affronter la vague d’insécurité a-t-on annoncé hier. Les porte-parole du Secrétariat à la Sécurité de la Nation ont assuré qu’il ne s’agirait pas d’une simple déclaration, qu’une zone spéciale serait créée pour s’occuper de la coordination. »
[23] Cette façon bourgeoise de considérer l’être humain en fonction de son activité professionnelle nous semble profondément insultante. Car pour nous, la profession n’est rien d’autre que la forme par laquelle l’être humain est rendu, à vie, utile au capital. Ce qui met en évidence que la vie, pour l’exploité, n’a d’autre fonction que celle de produire de la plus-value. Si malgré cela, nous effectuons cette énumération, c’est justement pour combattre ceux qui prétendent que, en tant qu’êtres humains, ils peuvent avoir des intérêts différents, et pour mettre en évidence que l’énorme majorité de ceux qui composent les assemblées ne sont pas propriétaires des moyens de production, mais au contraire, des prolétaires.
[24] Le fait de se reconnaître aujourd’hui en tant que classe se situe totalement à contre-courant et est dramatiquement minoritaire. La grande majorité des prolétaires ne se reconnaît plus comme faisant partie d’une seule et même classe. C’est un des problèmes majeurs que rencontre la révolution dans son avancée et cela démontre à quel point la théorie de nos ennemis fonctionne comme idéologie de contention sociale et agit comme force contre-révolutionnaire.
[25] Le vandorisme (du nom du leader syndicaliste Vandor) continue de représenter aujourd’hui le modèle hégémonique de l’action syndicale en Argentine, modèle fort similaire à celui des autres pays d’Amérique, d’Europe ou/et du Japon, et qui correspond aux caractéristiques générales du syndicalisme fasciste ou stalinien.
[26] Trucho signifie faux, mensonger, pâle imitation de la réalité.
[27] Trouvé sur Internet : « A 6 mois de la boucherie : nous serons comme Dario et Maxi ; Freinons la répression ».
[28] « A un an des massacres du pont Avellaneda : nous serons comme Darío et Maxi » (28/06/03), écrit par Domingo Scandella.
[29] Soit dit en passant, nous emmerdons tous ceux qui énumèrent les éléments de faiblesse politique présents dans les drapeaux levés par les prolétaires en Argentine, sans se sentir en même temps responsables, au même titre que les prolétaires des pays où ils vivent, et sans agir en conséquence, en luttant contre la bourgeoisie de « leur propre pays ».
[30] Il est certain que la lutte du prolétariat actuel se différencie de celle de l’esclave de l’antiquité (non pas de celle de l’esclave actuel qui est lui aussi un prolétaire !) par l’universalité du capital qui détermine le prolétariat comme classe mondiale, porteur d’un projet social pour l’ensemble de l’humanité. Bien souvent, les différences entre prolétaire et esclave ont été exagérées en insistant sur le fait que ce dernier pouvait seulement espérer « faire tourner la roue de l’histoire à l’envers ». On admet tout au plus que cette lutte pouvait lui permettre de se libérer, lui, ou de se reconstituer en communautés de lutte caractérisées par des luttes isolées et, plus généralement, par d’interminables luttes contre les esclavagistes et, plus tard contre le capital (quilombos, palenques, etc.). On a nettement moins insisté sur le fait que cette possibilité, malgré ses limites, était profondément humaine et déterminée par les intérêts matériels de ces êtres humains. On a systématiquement occulté (c’est toute la force de la conception progressiste de l’histoire : ces esclaves en lutte s’opposaient au sacro-saint progrès et à la civilisation !) le fait que la lutte du prolétariat n’a pas hérité ses déterminations de la classe « révolutionnaire » et progressiste que fut la bourgeoisie, mais bien de la lutte historique de toutes les classes exploitées, dont il nous reste encore beaucoup à apprendre (manque de mémoire historique).
[31] Toute opposition entre pratique et conscience peut être critiquée et doit être relativisée. La pratique du prolétariat, l’affirmation du prolétariat dans les rues en Argentine, implique un niveau de conscience qu’il nous paraît important de souligner, comme nous le ferons plus loin, ce qui nous oblige à opérer une distinction entre conscience implicite et conscience explicite. Si nous nous voyons ici obligés d’opérer cette distinction, c’est dans le but de mieux nous faire comprendre. Il ne faut donc pas prendre cette distinction relative comme une nouvelle invention conceptuelle, ou quoi que ce soit de ce genre, chose que nous détestons faire, et nos lecteurs le savent. Nous ne trouvons simplement pas d’autre façon d’exprimer ce que nous voyons de particulier dans la phase actuelle de la lutte du prolétariat, et cela nous dérange encore plus de devoir en rester au réductionnisme simpliste et dualiste pratique/conscience, qui affirme que la pratique est classiste alors que la conscience ne le serait pas encore. D’autre part, ce schéma s’avère totalement insuffisant au moment où il faut mettre en évidence les niveaux de rupture et de conscience qu’implique l’action même du prolétariat.
[32] Au moment de rédiger ces lignes, le mouvement d’octobre 2003, en Bolivie, n’avait pas encore eu lieu. Ce mouvement confirme donc ce qui est écrit ici.
[33] Nous pourrions insister sur le caractère relatif de cette constitution en classe par le fait qu’elle ne s’exprime pas de façon consciente, ni ouverte et qu’il n’existe pas de véritable constitution du prolétariat en parti. Nous pourrions d’ailleurs le faire pour chacun des points qui vont suivre, en relativisant immédiatement tout ce que nous affirmons, mais notre objectif, et nous insistons là-dessus, est d’analyser globalement cette contradiction.
[34] Tous les services d’envois express sont assurés en Argentine par des entreprises privées. Les prolétaires sous-payés qui y sont employés utilisent des motos pour distribuer le courrier. Compte tenu de la situation sociale, ce genre d’emploi a proliféré ces dernières années. Les travailleurs de ce secteur, grâce notamment à leur moyen de locomotion, se sont effectivement mis à la tête du mouvement, soit en s’organisant en force mobile, facilitant la circulation des informations au sein du mouvement, soit en s’impliquant directement dans les affrontements.
[35] A titre d’exemple, et dans la mesure où cela traduit des conceptions différentes, signalons que l’affirmation selon laquelle nous retournerions à des formes précapitalistes de production est un non-sens (il s’agit au contraire du capitalisme le plus pur), que pour nous la révolution n’implique aucune alliance de classe, mais exactement le contraire.
[36] Ne pas trouver d’autres formes que « fils de pute » pour insulter nos ennemis est évidemment une limite idéologique importante. C’est la misère qui pousse à la prostitution, et ce sont des préjugés machistes et bourgeois qui définissent cette situation comme la pire situation humainement ou socialement acceptable. De notre point de vue de classe, il est bien plus humiliant d’être le fils d’un tortionnaire ou d’un de ces salauds d’ingénieurs cravatés qui gagnent du fric en concevant et vendant des armes, des prisons, des systèmes de surveillance,… Fils de flic, fils de patron, fils de fabricant d’armes, fils de bureaucrate, fils de riche… constituent des insultes certainement plus ciblées politiquement que ce lourd et très masculin « fils de pute ». De toute manière, nous sommes certains que le mouvement révolutionnaire ne s’empêchera pas, le moment venu, de promotionner un type d’offense autrement plus percutant à l’adresse des bourgeois, et que le rejet profond de ceux qui gèrent ce système pourri sera l’objet d’une créativité dans l’insulte qui portera bien plus loin que ces très limités « fils de ».